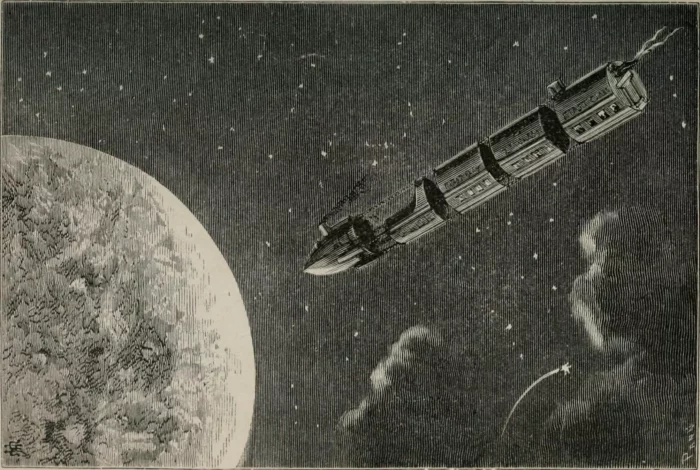par Yazan Alloujami
paru dans lundimatin#418, le 4 mars 2024
Parmi les choses diverses et variées qui peuvent empêcher un historien de dormir la nuit, j’en nommerais deux : Sur le concept d’histoire de Walter Benjamin, et Gaza.
Le premier, ce n’est pas tant son contexte d’écriture, en soi suffisamment perturbant —Benjamin l’a écrit peu avant son suicide en 1940 sur les frontières franco-espagnoles à l’approche des Vichystes — que la radicalité de son postulat : l’Histoire, dit le philosophe allemand marxiste, ne se laisse pas saisir dans les narrations linéaires et positivistes d’évènements, mais uniquement lorsqu’une image surgit du passé dans un moment de danger pour venir à l’aide du présent, fusionnant avec lui et révélant sa vérité. Cette énigmatique « image dialectique », comme il l’appelle, avait longtemps guidé mes recherches sur des artistes contemporains syriens, libanais et palestiniens hantés par toutes sortes d’images du passé moderne, et dont beaucoup — comme moi — sont exilés en Europe. C’était en allant voir deux d’entre eux en Allemagne au cours de l’été 2022 que je me suis pris, c’est le cas de le dire, une image dialectique dans la gueule.
C’était dans un train qui venait de quitter Gare de l’Est pour Francfort, pour aller ensuite à Cassel, lieu de la 15e édition de la Documenta. Je suivais depuis un moment l’hystérie xénophobe déchaînée contre cette exposition internationale qui accueillait pour la première fois une majorité d’artistes du Sud global. L’accusation peu informée d’antisémitisme, lancée par un bloggeur local contre une œuvre antisioniste, a suffi pour inaugurer une chasse nationale aux sorcières : censures, vandalismes, ventes annulées, artistes retirés, diabolisation médiatique. Tout artiste non-blanc, lié ou non à la Palestine, était devenu suspect. L’image qui m’est venue dans le train était la suivante : Alfred Barr, jeune historien de l’art américain dans un train pour Stuttgart en 1933, allant rechercher une minorité d’artistes modernes, dont beaucoup de Juifs, exactement au moment où les agressions nazis contre cet art traité de « dégénéré » devenaient systématiques.
A rebours, cette identification, esthétiquement insensée, entre l’art moderne de l’entre-deux-guerres et l’art global d’aujourd’hui me paraît d’autant plus évidente que le rôle joué dans ce dernier par les réseaux transeuropéens diasporiques, notamment arabes, est suffisamment analogique à celui joué par les Juifs au sein du modernisme occidental, et que dans les deux cas, le monde de l’art aurait été le sismographe de la catastrophe à venir, pré-annonçant les présupposés idéologiques qui la rendent possible. Un an plus tard, en novembre 2023, l’Allemagne décuple ses aides militaires à Israël, déjà armé jusqu’aux dents, afin d’accélérer l’extermination des Palestiniens de Gaza — plus de 30 000 morts à jour — déclarant à la CIJ que les accusations de génocide contre Israël sont « infondées ». En parallèle, ses établissements culturels mènent une purge inédite qui atteint des figures internationales aussi bien palestiniennes (Emily Jacir, Adania Shibli) que juives antisionistes (Masha Gessen, Eyal Weizman). Il suffit d’avoir signé une pétition pour Gaza ou tweeté contre la ségrégation raciale en Cisjordanie pour avoir son exposition annulée ou sa bourse de recherche retirée. Les échos se répandent à Paris avec l’annulation de plusieurs évènements co-organisés par Tsedek, le collectif juif décolonial, ou encore à Londres avec l’annulation par le Barbican d’une conférence de l’écrivain indien Pankaj Mishra sur la Shoah, entre autres. On essaie de faire front : la page Archive of Silence recense les actes de discrimination anti-palestinienne pendant que le mouvement StrikeGermany, appelant au boycott des institutions culturelles allemandes, a déjà un millier de signataires dont Annie Ernaux, et a causé des retraits importants notamment de la Berlinale et de la soirée d’ouverture du festival CTM au Berghain, deux emblèmes de la supposée inclusivité tant vantée de la capitale.
Fin octobre, j’ai contacté Sami, un des artistes syriens ayant participé à la Documenta. « La situation à Berlin est très effrayante » disait-il, « il y a une réactivation de comportements des années 1930 : distribuer des questionnaires à nos enfants à l’école demandant l’opinion politique de leurs parents ; les escouades militaires qui parcourent Sonnenallee [1] ». Ni lui ni moi n’étions les premiers à avoir ce genre de déjà-vu. Comparer l’extermination des Palestiniens à celle des Juifs d’Europe est devenu un lieu commun peuplé aussi bien par des instagrammeurs juxtaposant des images de Gaza et de Dachau que des universitaires armés de notes de bas de pages et de compteurs millimétrés de morts, savamment jugeant la comparaison tenable ou toujours pas devant des salles de conférence semi-vides. Or la question n’est pas de savoir si l’identification est historiquement légitime mais plutôt pourquoi elle est ressentie en tant que telle aujourd’hui, et par qui, question qui concerne moins le conflit israélo-palestinien que le fondement épistémique même de l’Europe (néo)libérale telle qu’il a pris forme après la chute du mur.
Dans Subcontractors of Guilt. Holocaust Memory and Muslim Belonging in Postwar Germany [Sous-traitants de la culpabilité : la mémoire de l’Holocauste et l’appartenance musulmane en Allemagne d’après-guerre], récemment publié par l’Université de Stanford, l’anthropologue Esra Özyürek examine les paradoxes d’un contrat social allemand basé, depuis la réunification, sur le partage de la culpabilité de l’Holocauste comme « garant essentiel de la stabilité de l’ordre allemand libéral-démocrate » selon le chancelier Gerhard Schröder. Contrat qui de facto exclut les migrants arrivés après le crime fondateur mais grâce auxquels — l’ironie est là — la stabilité économique du pays fut possible. La solution depuis les années 2000 : construire l’Allemand d’origine arabe/musulman comme le nouvel antisémite et élaborer des programmes de rééducation destinés à lui apprendre son propre antisémitisme (à travers des épisodes obscures du passé ottoman, par exemple), pour qu’il puisse ensuite le désapprendre et accomplir le rituel de rédemption nécessaire pour devenir allemand. Or, Özyürek rappelle, 90% des crimes antisémites en Allemagne sont aujourd’hui commises par l’extrême droite blanche.
S’aveugler devant l’évidence, maintes fois soulevée [2] d’une continuité structurelle entre ce bouc-émissairisme islamophobe et celui antisémite d’autrefois n’est qu’une partie de la tragédie des établissements culturels européens, notamment allemands, qui en étouffant les voix pro-palestiniennes perpétuent une vieillie tradition européenne ; l’autre partie c’est qu’ils le font en croyant sincèrement s’en absoudre devant les spectres mémoriels qu’ils s’étaient créés eux-mêmes. Et si cette comédie circulaire d’auto-félicitation tient, c’est parce que « Juif » et « Arabe » y apparaissent toujours à la troisième personne, en tant qu’essences ethniques transhistoriques, transmissibles par le sang et hiérarchisables a priori, d’où par exemple la pathétique déclaration de la ministre de la culture allemande qu’en applaudissant à la Berlinale la coproduction israélo-palestinienne No Other Land elle applaudissait uniquement le réalisateur israélien et non pas son collègue palestinien (il s’agissait du seul et même film !). Cette essentialisation est fondatrice aussi bien du sionisme, donc d’Israël, que du concept de sémitisme dans ses deux volets pratiques l’antisémitisme et le philosémitisme, sur lequel l’Europe est négativement fondée. Or la grande leçon du marxisme et après lui des pensées postcoloniales et féministes queer, c’est que « bourgeois » « noir » ou « femme » sont avant tout des fonctions dans une construction sociale donnée susceptible de bouger voire même de s’inverser dialectiquement (s’il faut apprendre Hegel aux Allemands), d’où l’hostilité de beaucoup de Juifs d’Europe marxistes vis-à-vis l’idée d’Israël : Rosa Luxemburg, Eric Hobsbawm, Arno Mayer, et Benjamin lui-même qui refusait d’immigrer en Palestine, dénonçant l’« idéologie raciale » du sionisme [3]. S’indigner donc que « les descendants d’un génocide puissent en perpétrer un autre » (Edgar Morin récemment, par exemple) est fort sympathique, mais la présupposition qui sous-tend telles remarques, à savoir qu’une conscience historique est censée s’hériter par descendance -idée bien bourgeoise- est précisément le problème. C’est ici que l’anti-essentialisme radical de Benjamin est utile pour re-instituer les termes du débat. Il est une « tradition des opprimés », dit-il, qui s’oppose à l’historiographie bourgeoise, et selon laquelle une oppression passée ne révèle son sens que lorsque les opprimés d’aujourd’hui arrachent son image à toute causalité généalogique pour l’incarner eux-mêmes. « Je suis le dernier intellectuel juif », disait le penseur palestinien exilé Edward Saïd [4]. L’état israélien, dernier ersatz du colonialisme de peuplement européen, a beau revendiquer l’héritage des Juifs d’Europe biologiquement, mais historiquement, dans une conception benjaminienne, seuls ceux qui dans la configuration globale actuelle occupent leur position d’autrefois accèdent à leur vérité historique, qu’ils le sachent ou pas (mais ça c’est encore une autre tragédie). Seule Gaza porte l’héritage du ghetto de Varsovie. L’échec de l’Europe à rendre compte de cela, en permettant matériellement et culturellement le génocide des Palestiniens initié en 1948, est son échec renouvelé à comprendre le véritable sens historique de son propre antisémitisme.
Yazan Alloujami
[1] le quartier arabe de Berlin
[2] Enzo Traverso en fait un résumé magistralement contextualisé dans La fin de la Modernité Juive. Histoire d’un tournant conservateur, Paris, La Découverte, 2016 [2013], p. 122-125.
[3] Gershom Scholem, Walter Benjamin : histoire d’une amitié, Paris, Les Belles-Lettres, 2022.
[4] Edward Said, « My Right of Return » [2000], republié dans Gauri Viswanathan (éd.), Powers, Politics, and Culture : Interviews with Edward W. Said, New York, Vintage Books, 2001, 443-458.