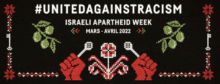19 novembre | Tareq Baconi pour The New York Review of Books | Traduction CG pour l’AURDIP, Traduction SF pour l’AURDIP | en English
Un consensus croissant s’est formé autour du terme — non comme une comparaison rhétorique avec l’Afrique du Sud, mais pour décrire un système de domination construit sur la partition de la Palestine.
Les historiens du futur pourraient bien distinguer 2021 comme l’année où le vent a tourné en faveur de la lutte palestinienne — même si c’était difficile de le voir venir. Les derniers mois de 2020 ont été parmi les plus sombres depuis des décennies, l’administration américaine s’attachant à encourager la vision expansionniste de droite d’Israël qui vise à démanteler, morceau par morceau, les préoccupations centrales composant la cause palestinienne : le droit des réfugiés à retourner dans les maisons dont ils ont été expulsés en 1948, le statut de Jérusalem comme capitale de la Palestine et le droit à l’auto-détermination sur des terres actuellement occupées par Israël. A la fin de l’année, le coup de grâce est arrivé lorsque plusieurs États arabes ont tourné le dos à la Palestine, en normalisant les relations diplomatiques et économiques avec Israël malgré son assujettissement persistant des Palestiniens. Le peuple palestinien a paru vaincu, pendant qu’Israël poursuivait son annexion du territoire occupé.
Mais des percées inattendues ont eu lieu. En janvier 2021, B’Tselem, la principale organisation de défense des droits humains en Israël, a publié un rapport intitulé sans ambiguïté « Un régime de suprématie juive du Jourdain à la Méditerranée : c’est un apartheid ». Dans ce rapport, les auteurs arguaient que le mandat de leur organisation depuis sa fondation en 1989 — éclairer les violations israéliennes des droits humains dans les Territoires occupés — n’était plus adéquat. « La situation a changé », expliquait le rapport. « Ce qui arrive dans les Territoires occupés ne peut plus être traité séparément de la réalité dans la région entière sous contrôle israélien ».
La puissance de ce rapport n’était pas dans l’accusation, portée par une organisation israélienne, qu’Israël pratiquait l’apartheid ; Yesh Din, une organisation israélienne de défense des droits humains engagée dans la protection des Palestiniens vivant sous le régime militaire d’Israël en Cisjordanie, avait formulé cette accusation six mois plus tôt, ainsi que plusieurs importantes personnalités israéliennes. De fait, de nombreuses voix israéliennes et internationales ont averti depuis des années que les pratiques israéliennes, si on les laissait incontrôlées, reviendraient à un système d’apartheid. Ce qui était différent dans l’analyse de B’Tselem était sa contestation d’un mythe généralisé, celui auquel souscrit la majeure partie de la communauté internationale, à savoir que le régime militaire d’Israël dans le territoire palestinien occupé peut être traité d’une certaine façon séparément de l’État d’Israël. L’organisation, au contraire, a caractérisé Israël comme un unique « régime qui gouverne la totalité de la région ».
Trois mois plus tard, Human Rights Watch, la principale organisation mondiale de défense des droits humains, a fait écho à ces résultats en publiant un rapport exhaustif, dont une analyse juridique étendue, qui concluait de manière accablante qu’un seuil historique avait été franchi : les autorités israéliennes commettaient des crimes contre l’humanité, sous la forme d’un apartheid et d’une persécution du peuple palestinien. Par-delà l’origine sud-africaine du terme, l’apartheid est universellement interdit selon la Convention internationale pour la suppression et la punition du crime d’apartheid de 1973 et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998, qui interdit aussi le crime de persécution.
Pour justifier leur assertion sur le seuil historique, B’Tselem et Human Rights Watch citaient plusieurs développements : l’annexion continue de facto du territoire palestinien par Israël ; les lois à statut constitutionnel à l’intérieur d’Israël, qui consacrent la suprématie juive ; l’enracinement du système de contrôle d’Israël sur les Palestiniens ; la mort du processus de paix ; et les efforts des États-Unis pour ratifier et formaliser cette réalité sous le masque d’un engagement nominal à une solution à deux États. Pour les deux organisations, comme pour beaucoup d’autres analystes, militants et responsables politiques, la convention de traiter comme temporaire l’occupation par Israël de la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est et la Bande de Gaza —et donc comme une question qui pourrait potentiellement être résolue en dehors des confins et du contrôle de l’État d’Israël —n’était plus une description exacte de la réalité. Il n’y avait aucune indication d’autre chose que la permanence de l’emprise d’Israël sur « la totalité de la région », comme l’a écrit B’Tselem.
Alors, en mai, a éclaté le soulèvement que les Palestiniens ont fini par surnommer « l’Intifada de l’unité », déclenché par l’expulsion planifiée par Israël de plusieurs familles palestiniennes, chassées de leurs maisons dans Jérusalem-Est. Dans l’espace de quelques jours, Israël a été confronté à des manifestations populaires de Palestiniens dans Jérusalem et en Cisjordanie, une mobilisation de masse dans les cités israéliennes contre la violence approuvée par l’État et des manifestations parmi les communautés des réfugiés palestiniens et de la diaspora. Alors que la répression par la police israélienne à Jérusalem s’intensifiait en violence et en étendue, des militants dans la Bande de Gaza contrôlée par le Hamas lui ont offert une résistance armée, en envoyant des salves de roquettes plus loin en Israël qu’ils n’avaient fait dans les conflits précédents ; cette escalade a conduit inévitablement à une réponse militaire disproportionnée de la part d’Israël. Avant qu’une trêve ne soit déclarée, au moins 248 Palestiniens de Gaza avaient été tués, dont soixante-six enfants ; une douzaine d’Israéliens avaient péri, dont deux enfants.
Le point zéro du soulèvement, le quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem, en a émergé tout à la fois comme un symptôme et comme un symbole du régime identifié par B’Tselem et Human Rights Watch : un réseau tentaculaire d’institutions juridiques, militaires et économiques, à la fois de l’État et de ses substituts, dont l’objectif premier était de consolider l’appropriation de la terre en vue d’installations juives en dépossédant les Palestiniens. En une nuit, Sheikh Jarrah est devenu emblématique de ce que le sionisme a forgé en Palestine pendant plus d’un siècle, et le soulèvement dans tout le pays a proclamé le rejet des efforts du régime, depuis des décennies, pour diviser et fragmenter l’unité palestinienne.
Comprendre Israël-Palestine ni comme un conflit, ni comme une crise, mais comme un système d’apartheid, est une représentation plus exacte de ce que les Palestiniens ont longtemps décrit comme étant leur expérience. La correction nécessaire, maintenant en cours, a mis longtemps à venir, menée principalement par la mobilisation palestinienne. Souvent, l’accusation d’apartheid est faite par analogie à l’Afrique du Sud d’avant 1994, et est présentée de manière historique et comparative. De plus en plus, cependant, et de manière importante, il y a un élan puissant pour comprendre l’apartheid israélien dans ses propres termes. Le rapport de Human Rights Watch est une contribution cruciale à cet égard, parce qu’il argumente juridiquement en mettant en lumière l’apartheid comme un crime basé sur l’intention d’Israël de maintenir la domination d’un groupe ethnique sur un autre. La généalogie de ce schéma de domination en Palestine date de plus d’un siècle et a ses propres caractéristiques historiques et géographiques spécifiques, qui ont été effacées dans les machinations politiques du prétendu processus de paix. La tâche de définir les caractéristiques de l’apartheid israélien est un prérequis pour une solution politique juste en Palestine.
*
Les rapports de B’Tselem et de Human Rights Watch sont les marqueurs à la fois d’un nouveau commencement et de la conclusion du travail des Palestiniens et de leurs alliés. Il y a quelque vingt ans, pendant la deuxième Intifada, les organisations palestiniennes de défense des droits humains al-Haq, Badil, et Adalah ont participé en 2001 à la Conférence mondiale de Durban contre le racisme, qui a lancé une campagne mondiale anti-apartheid pour mettre fin au « type israélien d’apartheid ». Les presque huit cents organisations présentes ont publié une bilan de la conférence qui déclarait Israël « un État raciste d’apartheid » et appelait à une « politique d’isolement complet et total d’Israël en tant qu’État d’apartheid comme dans le cas de l’Afrique du Sud ». Après cela, en 2005, des militants palestiniens et pro-palestiniens ont initié l’Israeli Apartheid Week [Semaine contre l’apartheid israélien], qui est devenue traditionnelle sur les campus universitaires en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Une année plus tard, « inspirée par le mouvement anti-apartheid sud-africain », une coalition d’organisations palestiniennes dans les Territoires occupés a lancé le mouvement de Boycott, Désinvestissement et Sanctions sous la bannière d’une campagne pour la liberté, la justice et l’égalité. Ensuite, en 2007, le rapporteur spécial des Nations Unies pour les Territoires occupés, John Dugard, a présenté un rapport au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies notant que l’occupation prolongée d’Israël incluait des éléments de colonialisme et d’apartheid. Son intervention a été reprise par le Conseil de la recherche en sciences humaines d’Afrique du Sud, qui a mené sa propre enquête juridique, concluant qu’Israël « est devenue une entreprise coloniale qui met en oeuvre un système d’apartheid » dans les Territoires occupés.
Le Tribunal Russell à Cape Town, une commission d’enquête juridique indépendante créée par des personnalités connues représentant des pays variés pour surveiller les violations des droits sur lesquelles la communauté internationale ne voulait ou ne pouvait pas enquêter, a conclu en 2011 que « la domination d’Israël sur le peuple palestinien, où qu’il réside, revient collectivement à un unique régime intégré d’apartheid ». En 2014, Richard Falk, dans son rapport final comme rapporteur spécial des Nations Unies pour les Territoires occupés, a informé les Nations Unies que les mesures israéliennes contre les Palestiniens « revenaient à un apartheid ». Falk a poursuivi en 2017 lorsque, avec sa co-autrice Virginia Tilley, il a publié un autre rapport influent, « Israeli Practices towards the Palestinian People and the Question of Apartheid » [Pratiques israéliennes envers le peuple palestinien et la question de l’apartheid], publié par la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie occidentale. Celui-ci a conclu qu’Israël avait établi un régime d’apartheid sur le peuple palestinien par un système juridique à étages et une politique de fragmentation stratégique. Ensuite, en 2019, une coalition d’organisations de défense des droits humains, palestiniennes, régionales et internationales, a soumis un rapport « sur l’apartheid israélien » au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (un organisme des Nations Unis sous l’égide du Bureau du Haut-Commissaire aux droits humains) ; celui-ci identifiait globalement un régime systématique de domination sur les Palestiniens, y compris les citoyens d’Israël et les réfugiés à l’étranger à qui le droit de retour a été refusé depuis 1948.
Tout ce travail a été largement redevable aux décennies de mobilisation palestinienne pour obtenir une reconnaissance plus vaste de l’apartheid israélien. Reconnaître cet effort sous-jacent soulève une question : pourquoi fallait-il la ratification par des organisations israéliennes et internationales, réitérant ce que les Palestiniens ont dit depuis longtemps à quiconque prêt à l’entendre, pour faire les gros titres dans les principaux médias occidentaux ? Néanmoins, cette réserve ne détourne pas de la puissance de ce moment : l’émergence d’un large consensus qui a rendu bien plus difficile de dénier tant le caractère singulier du régime israélien que l’unité essentielle du peuple palestinien. Cette réalisation menace la conviction de près d’un siècle qu’une partition de la Palestine, le pays s’étendant du Jourdain à la Méditerranée, est la meilleure façon de résoudre les aspirations juives et palestiniennes à l’auto-détermination. Ce qui est devenu de plus en plus clair est que l’adoption d’une partition comme « solution » au conflit — loin d’être la base d’un accord juste et durable — a permis à Israël d’avancer pendant des décennies des politiques qui ont conduit à la réalité de l’apartheid d’aujourd’hui.
L’approche par partition était la conclusion de la Commission Peel de l’Empire britannique de 1937, commission qui a noté tardivement — vingt ans après que la Déclaration de Balfour a contribué à créer le problème en ratifiant unilatéralement l’établissement d’une patrie juive en Palestine — qu’ « un conflit irrépressible est né entre deux communautés nationales dans les limites étroites d’un petit pays … leurs aspirations nationales sont incompatibles … Aucun des deux idéaux nationaux ne permet une combinaison dans les services d’un état unique ». En conséquence, une décennie plus tard, l’Assemblée générale des Nations Unies a promulgué la Résolution 181, qui appelait à la création d’« États arabe et juif indépendants » (ainsi qu’un « régime international spécial pour la cité de Jérusalem »).
Alors que la majorité des États asiatiques et africains étaient encore sous un régime colonial, la partition a été proposée à l’Assemblée générale des Nations Unies nouvellement formée. Comme Fayez A. Sayegh, un intellectuel palestinien de premier plan, l’a remarqué dans sa monographie de 1965 intitulée « Colonalisme sioniste en Palestine », « un État étranger devait être planté dans une terre reliant l’Asie et l’Afrique sans le libre consentement d’aucun pays voisin, africain ou asiatique ». Personne ne rechercha non plus le consentement des Palestiniens : le peuple et ses dirigeants rejetèrent le plan de partition, le voyant comme un outil néocolonial pour justifier l’imposition d’une entité étrangère sur leurs terres, analogue aux pratiques de partition colonialistes de l’Empire britannique partout ailleurs.
L’opposition palestinienne, cependant, était considérée comme insignifiante. La Ligne verte, définissant la frontière établie par l’armistice qui a mis fin aux hostilités entre Israël et les États arabes voisins en 1949, a codifié la partition dans le droit international, alors même que les Nations Unies avaient à cette date interdit l’acquisition de territoire par la force et reconnu le droit à l’auto-détermination palestinienne dans ce territoire. Les États-Unis et d’autres pays, principalement occidentaux, ont embrassé l’État indépendant d’Israël, légitimant — par l’obtention de la bénédiction des Nations Unies — la colonisation sioniste de plus des trois quarts de la terre de Palestine.
En dépit de toutes les allégations qu’il en serait autrement, cette partition s’est avérée ne pas être du tout un accord durable. Après la nouvelle flambée des hostilités en 1967, qui résultait de la conquête et de l’occupation par Israël de territoires palestiniens, syriens et égyptiens, une fausse distinction a été faite entre « Israël proprement dit », la nation dans les frontières de 1948 — devenue à cette date un membre à part entière de la communauté internationale — et son entreprise coloniale s’étendant au-delà de la Ligne verte. Cette séparation imaginaire efface la réalité historique que le projet de colonies au-delà de la Ligne verte, vieux de plusieurs décennies, est une continuation de l’assujettissement des peuples autochtones, essayé, testé et poursuivi en deçà jusqu’à ce jour.
Pour les Palestiniens, donc, le prétendu tournant que B’Tselem et Human Rights Watch ont identifié n’est pas un tournant du tout, mais une étape dans un continuum. Avant que l’occupation d’Israël n’ait même commencé, les Palestiniens avaient accusé l’État de pratiquer l’apartheid contre leur peuple. Dans sa monographie de 1965, Sayegh avait écrit : « alors que les apôtres afrikaners de l’apartheid en Afrique du Sud proclament insolemment leur péché, les praticiens sionistes de l’apartheid en Palestine envoûtent par leurs protestations d’innocence ! » Au moment où il écrivait, les citoyens palestiniens d’Israël, que Sayegh décrivait comme « les vestiges du peuple arabe palestinien qui sont restés obstinément derrière, dans leur patrie, malgré tous les efforts pour les déposséder et les chasser », vivaient sous droit militaire. Israël a mis fin au régime militaire pour les Palestiniens à l’intérieur d’Israël en décembre 1966, mais pour imposer virtuellement le même système de l’autre côté de la Ligne verte tout juste un peu de plus de six mois plus tard. Le calvaire de ces Palestiniens abandonnés, traités comme une cinquième colonne dans l’état qui les gouvernait, était un baromètre pour Sayegh, indiquant comment Israël allait traiter les Palestiniens sous son contrôle.
Pour les Palestiniens, l’idée qu’ « Israël proprement dit » pouvait être séparé de son entreprise sur le territoire entier a toujours été un sophisme, ce qui est la raison pour laquelle la lutte palestinienne s’est focalisée sur la libération de toute la Palestine. Comme la charte de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), fondée en 1964, le proclamait : « La Palestine, dans ses frontières de l’époque du Mandat britannique, est une unité territoriale indivisible … La partition de la Palestine en 1947 et l’établissement de l’État d’Israël sont entièrement illégaux … La Déclaration Balfour, le Mandat pour la Palestine et tout ce qui a été basé sur eux, sont nuls et non avenus. » Au milieu des années 1970, cependant, la lutte de libération de l’OLP avait échoué à réaliser des gains stratégiques et sa direction a commencé à considérer des voies de compromis : accorder la reconnaissance d’Israël et, avec elle, l’installation sioniste sur trois quarts du pays natal des Palestiniens, dans un marché pour gagner une légitimité auprès de la communauté internationale et pour paver le chemin vers un accord diplomatique qui verrait leur auto-détermination dans un croupion de la Palestine historique. Dans ce quid pro quo, les citoyens palestiniens d’Israël — les « vestiges » de Sayegh —seraient nécessairement exclus de l’architecture du prétendu processus de paix qui commençait dans les années 1980. Car, à ce moment, la logique de la partition a déterminé que le conflit israélo-palestinien existait seulement en dehors des frontières d’Israël de 1948.
C’est la partition qui a ainsi façonné la quête ultérieure pour la solution à deux états. Les citoyens palestiniens d’Israël en sont venus à être considérés comme une question israélienne interne, un groupe minoritaire confronté à des lois discriminatoires d’un type malheureux (bien qu’il ne soit certainement pas inconnu dans les démocraties coloniales ailleurs), plutôt que comme membres d’une communauté nationale unifiée qui étaient les victimes de l’apartheid. La partition a aussi signifié que les réfugiés palestiniens et leurs descendants, qui atteindraient un nombre de plus de sept millions de personnes, ne pouvaient exercer de manière réaliste leur droit au retour dans des maisons d’où ils avaient été expulsés. Par l’usure graduelle de négociations prolongées, le droit au retour des réfugiés a été balayé au service d’un engagement à maintenir Israël comme un État ethnique avec une majorité juive en Palestine. De fait, la demande des Palestiniens a été repoussée dans les marges si efficacement qu’elle a finalement été diabolisée comme équivalente à de l’antisémitisme, puisque les acteurs dominants de la communauté internationale en sont arrivés à la considérer comme synonyme d’un appel à la destruction d’Israël comme État juif.
A la poursuite de la partition, l’industrie pacificatrice post-1967 a découpé des constituants cruciaux du peuple palestinien : ceux expulsés de Palestine en 1948-49 et ceux qui restaient en Israël, laissant seulement les entre-deux, ceux qui, depuis la guerre de 1967, ont été gérés par le régime militaire d’Israël dans le territoire occupé de Cisjordanie et de Gaza. Un tel compte sélectif a été justifié par le désir de créer une patrie juive au Moyen-Orient, en accord avec l’engagement colonial que l’Empire britannique a consacré dans sa Déclaration Balfour de 1917, qui continue à former la colonne vertébrale de la position de la communauté internationale vis-à-vis d’Israël, particulièrement après l’Holocauste. Pour réaliser cet objectif, l’approche des pacificateurs à la résolution du conflit a dû embrasser la même logique de manipulation démographique. Elle implique aussi l’acceptation par la communauté internationale, au fil du temps, du droit unilatéral d’un côté, celui d’Israël, à changer la ligne de facto de partition en expropriant le territoire occupé et en construisant dessus des colonies. Comme beaucoup en viennent maintenant à le reconnaître, s’opposer à la chimère de la partition signifie tourner l’objectif vers Israël lui-même, pour prendre en compte enfin les racines coloniales et le présent apartheid de l’État.
*
La partition est, en fait, une pierre angulaire de l’apartheid. En Afrique du Sud, des euphémismes variés — « bon voisinage » et « développement séparé » —ont été déployés pour reformuler la ségrégation comme un système bénéfique. Le gouvernement sud-africain a même invoqué le concept d’« apartheid positif », une ligne de pensée propagée entre autres par Werner Eiselen, secrétaire des affaires autochtones du Premier ministre Hendrik Verwoerd au début des années 1950, pour justifier la ségrégation sous la domination d’une minorité blanche comme un moyen de permettre aux Noirs de maintenir leurs cultures et leurs modes de vie, à l’intérieur des foyers prétendument tribaux connus sous le nom de bantoustans. Des notions similaires prévalent en Israël et dans les territoires palestiniens, où la partition est souvent formulée comme bénéfique parce qu’Israéliens et Palestiniens ont des sentiments nationaux forts et que chaque peuple mérite son propre État. Cette orthodoxie s’est avérée persistante — elle a étayé le plan pour le Moyen-Orient de l’administration Trump, qui s’est concentrée sur le fait de rendre les bantoustans palestiniens plus durables grâce à des incitations économiques et l’approche de l’Union européenne qui a subventionné des institutions et le gouvernement d’un pseudo-état sous occupation, l’Autorité palestinienne (AP).
Dès la Conférence de Bandung de 1955, un bloc de pays africains et asiatiques uni aux Nations Unies s’est emparé de l’apartheid comme d’un terme qui « exemplifie les maux jumeaux du colonialisme et du racisme statutaire ». Par leurs propres expériences des luttes d’indépendance nationale, beaucoup de ces mouvements anticoloniaux du tiers monde ont compris les régimes d’apartheid avant tout comme un produit du colonialisme ou du colonialisme d’occupation et un fléau à éradiquer. L’Afrique du Sud avait déjà, avant Bandung, commencé à codifier l’apartheid comme un système de ségrégation raciale et de domination qui est devenu un archétype internationalement notoire. A partir de 1948, les gouvernements successifs du Parti national dominé par les Afrikaners ont favorisé des législations comme la Loi d’éducation bantoue de 1953 qui établissait l’autorité des bantoustans sur les écoles, dans un effort paternaliste pour conférer un vernis de légitimité au système par l’objectif apparent de préserver les différences culturelles.
Il est difficile de rater les résonances avec l’Autorité palestinienne. Les Accords d’Oslo qui l’ont établie ont transféré l’administration de la santé, de l’éducation et de la police aux Palestiniens à Gaza et dans des zones restreintes de la Cisjordanie, institutionnalisant la vision israélienne de remplacer la demande palestinienne de souveraineté en leur accordant une autonomie limitée. Cela a créé une impression d’auto-détermination qui a camouflé la structure plus vaste de la domination. L’engagement des dirigeants palestiniens à cultiver cette autonomie à l’intérieur de leurs enclaves majoritairement urbaines est, bien sûr, un prérequis pour maintenir le régime d’apartheid israélien. De même, en Afrique du Sud, l’apartheid n’aurait peut-être pas duré aussi longtemps sans l’acceptation de quelques dirigeants sud-africains noirs qui avaient un intérêt dans le contrôle des bantoustans.
Des comparaisons plus poussées avec l’Afrique du Sud deviennent évidentes dès qu’on voit Israël–Palestine non à travers l’illusion de la partition mais comme un seul territoire, une Palestine colonisée. En Afrique du Sud, la Loi sur les autochtones (Abolition des passes et coordination des documents) de 1952, plus communément connu sous le nom de Loi des passes, a régulé les conditions sous lesquelles les Noirs pouvaient rester dans des zones blanches, afin de contrôler le flux du travail (lui-même un produit de la Loi sur les terres autochtones de 1913, qui a joué un rôle central dans la dépossession des Sud-Africains noirs autochtones de leurs terres). Cet instrument juridique a un analogue dans les permis dont ont besoin les Palestiniens des Territoires occupés pour passer à travers les checkpoints israéliens. Le confinement des Palestiniens à la zone A de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza reflète de même le modèle bantoustan sud-africain. L’infrastructure tentaculaire des autoroutes et des colonies construites pour l’usage exclusif des Israéliens — même lorsqu’elles traversent des zones palestiniennes — évoque le modèle sud-africain des espaces « pour Blancs seulement ». Les similarités s’étendent à la protection de l’apartheid sur la scène internationale. Pendant les années 1980, les États-Unis et le Royaume-Uni ont été deux des acteurs les plus influents pour soutenir le régime d’apartheid d’Afrique du Sud aux Nations Unies, y compris par leur opposition aux sanctions et aux boycotts, et leur protection contre eux.
Raser les quartiers et déplacer des millions d’Africains noirs et « colorés » en Afrique du Sud pour façonner des enclaves urbaines pour les Blancs seulement a été un aspect essentiel de l’apartheid, enraciné dans un impératif ségrégationniste. Le District 6 de Cape Town est peut-être la plus notoire de ces localités. De même les dépossessions historiques en Israël ont pavé la voie pour que l’apartheid se construise dans la gouvernance même de l’État. Les camps de réfugiés au Liban, en Syrie, en Jordanie et dans les Territoires occupés, dans lesquels les Palestiniens ont été systématiquement exilés pour faire place à l’État juif, représentent un transfert de population comparable. Et c’étaient ces concitoyens qui étaient exclus du processus de paix.
Les comparaisons, pourtant, sont imparfaites. Comme avec toutes ces analogies historiques, il y a autant de différences que de similarités. Les caractéristiques démographiques des bénéficiaires de l’apartheid et ses victimes n’ont aucune relation directe entre elles : les Blancs — comprenant principalement deux populations distinctes, une de lignée anglaise, l’autre hollandaise — étaient une petite minorité en Afrique du Sud (à peu près 15%), alors que Juifs et Palestiniens sont en gros à parité numérique entre le fleuve et la mer. L’économie de l’apartheid sud-africain dépendait largement du travail autochtone, contrairement à celle d’Israël. Malgré une ségrégation brutale, les Sud-Africains noirs avaient des droits nominaux en tant que contribuables. Et dans ses dernières décennies, les périodes d’immigration de l’Empire britannique et de colonisation hollandaise, celles des premiers temps de l’Afrique du Sud de l’apartheid, étaient passées depuis longtemps, alors la colonisation sioniste se porte bien, grâce à la Loi du retour qui continue à encourager l’immigration juive du monde entier en Israël.
Pour beaucoup de militants pro-palestiniens, l’attrait de mettre en lumière les similarités repose largement dans le désir de faire de l’histoire sud-africaine un exemple pour mobiliser le soutien international en faveur des Palestiniens et d’inspirer de l’espoir, dans la perspective de mettre fin à l’apartheid. L’apartheid israélien, cependant, doit être compris dans ses propres termes, comme un système qui a évolué à travers plusieurs étapes depuis 1948 et se reconstitue de manière cohérente sous différents déguisements et des gouvernements variés (bien que tous engagés dans la consécration de la suprématie juive en Palestine). Il n’est pas possible d’atteindre une compréhension de l’apartheid israélien simplement en notant les exemples de gouvernance raciste ou les pratiques de ségrégation quotidienne, au lieu du système plus large qui les organise : la barrière qu’Israël a construite pendant la deuxième Intifada pour séparer Jérusalem du reste de la Cisjordanie, et auquel les Palestiniens se réfèrent comme au Mur de l’apartheid à cause de la manière dont il limite leur liberté de mouvement et facilite la colonisation de leur terre, est seulement une manifestation de l’apartheid israélien ; de la même manière, les lois discriminatoires auxquelles sont confrontés les citoyens palestiniens en Israël et le système juridique à étages qui s’applique aux Palestiniens (des citoyens en Israël aux résidents permanents à Jérusalem et aux sujets sans état des Territoires occupés) sont les phénomènes superficiels d’une structure sous-jacente. L’apartheid israélien fonctionne comme un appareil global de manipulation territoriale et démographique, un appareil enraciné dans la colonisation sioniste de la Palestine avant 1948.
Soutenir Israël comme un État juif — la priorité ultime du soutien occidental — n’a été possible qu’en dépeuplant la Palestine et en empêchant les réfugiés de revenir. Il ne pourrait y avoir de participation palestinienne à la Knesset en tant que groupe minoritaire, une participation que ses supporters vendent comme preuve de la nature prétendument démocratique d’Israël en partie pour détourner l’accusation d’apartheid, sans le nettoyage ethnique original du peuple palestinien de cette terre. Et Israël ne pourrait pas non plus maintenir sa majorité juive sans imposer un blocus sur la Bande de Gaza, où deux tiers de ses deux millions d’habitants palestiniens sont des réfugiés aspirant au retour.
Israël ne persiste aujourd’hui comme patrie juive en Palestine qu’à travers des systèmes de contrôle et de fragmentation bâtis pour empêcher toute inversion de la Nakba. La partition a donc été, et est, un pilier central de l’architecture de séparation démographique d’Israël, qui étaye sa logique d’apartheid, comme un moyen de sauvegarder un état juif et de perpétuer la Nakba.
Comprendre l’apartheid israélien à la fois dans ses formes historiques et actuelles en Palestine, c’est comprendre que le sionisme est une idéologie raciste. Sayegh a expliqué qu’en tant que colonie de peuplement dédiée à l’autodétermination juive en Palestine, trois caractéristiques vitales sont intrinsèques à l’État sioniste : son caractère ethnocentrique et sa conduite raciste, son addiction à la violence et son idéologie expansionniste. Le racisme, selon Sayegh, n’est pas fortuit, « c’est congénital, essentiel et permanent. Parce que ce racisme est inhérent à l’idéologie même du sionisme et de la motivation fondamentale à la colonisation sioniste et à l’étatisation ». En 1975, l’Assemblée Générale de l’ONU a voté la résolution 3379 assimilant le sionisme au racisme et l’identifiant comme une idéologie visant à maintenir la domination raciale d’un groupe sur un autre. La race, dans cet exemple, est, selon les conventions de l’ONU, comme fondée sur « la base de l’ascendance et de l’origine nationale ou ethnique”. Construite sur la base de résolutions antérieures, dont la Résolution1904 (de 1963) qui déclarait que « toute doctrine de différenciation raciale ou de supériorité est scientifiquement fausse, moralement condamnable, socialement injuste et dangereuse, la Résolution 3379 établissait que, à l’instar d’Israël, « les régimes racistes du Zimbabwe et d’Afrique du Sud… (sont) organiquement liés dans leur politique orientée à la répression de la dignité et de l’intégrité de l’être humain ». La résolution fut votée, mais ultérieurement révoquée après un lobbying intense de la part des États-Unis et d’Israël, accusant notamment d’antisémitisme ceux qui soutenaient la résolution.
La controverse n’a pas pris fin. Elle est revenue en 2001 avec encore plus de force – et pour sûr en Afrique du Sud – à la conférence mondiale contre le racisme de Durban, que l’Assemblée Générale de l’ONU avait décidé en 1997 de tenir comme « un repère dans la lutte pour l’éradication de toutes les formes de racisme ». La Déclaration de Durban, ainsi qu’elle est connue, a appelé à la restitution de la Résolution 3379 ; cela a provoqué une violente réaction des soutiens d’Israël et a poussé les États-Unis et Israël à se retirer et à rejeter l’ONU comme anti-Israël. (À cette même conférence, les États-Unis ont aussi condamné l’inscription dans la même déclaration d’un appel à des réparations pour l’esclavage). Plusieurs itérations de cette même controverse ont eu lieu dans les décennies depuis Durban. En 2005, par exemple, à la conférence mondiale contre le racisme qui a rassemblé 166 organisations non gouvernementales du monde entier, Israël a de nouveau été labellisé État d’apartheid ; la conférence a aussi recommandé la restauration de la Résolution 3379, qu’Israël et les États-Unis ont de nouveau condamnée comme antisémite.
Les soutiens d’Israël ont appuyé cette réclamation sur le fait que mettre sur un pied d’égalité le sionisme et le racisme désignait à l’opprobre le droit à l’autodétermination d’un seul groupe particulier, le peuple juif. Ces critiques ont défini l’antisionisme comme le « nouvel antisémitisme », la dernière itération des formes historiques de la haine antijuive, masquée désormais en critique d’Israël. Dans ce scénario, le droit à l’autodétermination du peuple juif était une cause éminemment juste, à côté de laquelle la Nakba palestinienne était regrettable, mais inévitable et finalement acceptable comme dommage collatéral. Voici les mots du journaliste israélien Ari Shavit, qui écrivait dans le New Yorker sur les Israéliens qui ont massacré des Palestiniens à Lydda en 1948 :
« Je ne condamnerai pas le commandant de la brigade ni le gouverneur militaire, ni les soldats du troisième bataillon. Au contraire. Si nécessaire, je soutiendrai les condamnés parce que je sais que sans eux, l’État d’Israël ne serait pas né. Sans eux, je ne serais pas né. »
Du point de vue de Shavit, le meurtre de centaines de Palestiniens par les combattants juifs et l’expulsion de plus de 70 000 de leurs maisons – dans ce qui a été appelé la Marche de la Mort de Lydda – a été tragique mais nécessaire : « Ils (les auteurs juifs du massacre) ont fait le sale travail qui permet à mon peuple, ma nation, ma fille, mes fils, et moi de vivre ».
En dépit de la violence et des expulsions de Palestiniens largement répandues qui avaient accompagné l’indépendance d’Israël, le sionisme à ses débuts paraissait encore tenir la promesse des idéaux socialistes et démocratiques de nombre de ses fondateurs. En 1961, Israël a voté à l’ONU la condamnation de l’apartheid sud-africain, incitant le premier ministre Hendrick Verwoerd, l’architecte en chef de l’apartheid, à répliquer : « Israël n’est pas cohérent dans sa nouvelle attitude anti-apartheid. Ils ont enlevé Israël aux Arabes après que les Arabes y ont vécu pendant mille ans… Israël, comme l’Afrique du Sud, est un État d’apartheid ». Malgré la pertinence de cette déclaration, le point de vue dominant et largement progressiste dans le monde à la fois en Israël et parmi les puissances occidentales a accueilli la possibilité d’un sionisme différent qui faisait apparaitre la comparaison avec l’apartheid et l’accusation de racisme grossières et réductrices. Golda Meir, la femme politique travailliste qui fut la première ministre d’Israël de 1969 à 1974, a incarné cette dissonance en insistant sur l’opposition d’Israël à l’apartheid sud-africain et en alignant Israël sur les mouvements anticoloniaux d’Afrique. À la création d’Israël en 1948, la gauche internationale ne le vit pas majoritairement comme un projet de colonisation de peuplement mais plutôt comme un projet socialiste et anti-impérialiste, au moins jusqu’au commencement de l’occupation en 1967. Ils furent alors peu nombreux à voir dans les douleurs de l’enfantement de l’État sioniste un problème moral ou politique, si même ils en voyaient un du tout.
Au cours des années, l’érosion électorale et politique du bloc travailliste de Meir a ouvert la voie à l’évolution à droite d’Israël jusqu’à ce qu’il devienne un fervent soutien du régime d’apartheid d’Afrique du Sud. Cela amena une implication dans l’extension de l’assistance militaire à cette république voyou et dans la collusion avec ses représentants officiels sur la recherche du meilleur moyen d’échapper aux sanctions économiques et à la pression diplomatique qui gagnaient du soutien en Occident. La relation était impuslée autant par d’impitoyables intérêts de politique étrangère que par une affinité politique et idéologique. Les deux colonies de peuplement trouvèrent une cause commune en se voyant elles-mêmes comme des avant-postes frontaliers européens menant une bataille civilisationnelle dans de mauvais endroits et toutes deux s’identifiaient avec la nécessité de répondre à un impératif de maintien du contrôle ethnique dans leurs États respectifs. Comme le dit un ancien chef d’état-major israélien à un congrès étudiant à l’université de Tel Aviv en 1987, quelques années avant l’effondrement du régime d’apartheid :
« Les Noirs en Afrique du Sud veulent prendre le contrôle sur la minorité blanche, tout comme les Arabes ici veulent prendre le contrôle sur nous. Et nous aussi, comme la minorité blanche d’Afrique du Sud, nous devons agir pour les empêcher de prendre le dessus. »
Aujourd’hui le sionisme est très éloigné de l’idéal socialiste, démocratique que beaucoup de ceux qui soutiennent Israël ont toujours espéré qu’il devienne et il est désormais plus difficile de l’approuver, même pour des libéraux ayant précédemment justifié ses crimes, ou pour d’autres qui s’y sont accrochés comme à une idéologie représentant un collectif juif, indépendamment de la façon dont il s’est effectivement manifesté sous la forme de l’État d’Israël. Pour les Palestiniens, cette trajectoire était inéluctable et les mots de Sayegh de 1965 sur un État engagé dans l’expansion et la violence apparaissent prémonitoires. Les simples faits sont ceux-ci : Israël a désormais près de 700 000 colons vivant illégalement sur un territoire occupé, dont une quantité de plus en plus importante est annexée et déclarée partie intégrante d’Israël ; depuis le début de la deuxième Intifada, en septembre 2000, les forces de sécurité israéliennes et des civils ont tué plus de 10 000 Palestiniens ; et en 2018, la ségrégation raciale et la suprématie juive ont été inscrites dans la Loi Fondamentale d’Israël sous la forme de la Loi de l’État-Nation du peuple juif, qui établit que les Juifs ont un droit unique à l’autodétermination en Israël, qui est « l’État-nation du peuple juif ». La loi a été défendue par la Cour suprême et célébrée par les acteurs et institutions politiques israéliens – le Premier ministre d’alors, Benjamin Netanyahou, déclarant Israël « l’État national, non de tous ses citoyens, mais seulement du peuple juif ».
La Résolution 3379 peut être apparue comme prématurée en 2001. Mais, à la lumière de la poussée plus rude de l’État d’Israël dans les années récentes pour maintenir les populations palestiniennes sous son contrôle dans des enclaves de type bantoustans, les épisodes précédents de la conférence de Durban semblent avoir présagé du débat qui se déroule maintenant sur l’apartheid israélien. En tandem avec ce débat, est venue une nouvelle résistance contre l’évocation instrumentalisée de l’antisémitisme pour verrouiller la critique légitime de ce qui a été forgé au nom du sionisme. Le changement signalé par la reconnaissance à la fois par Human Rights Watch des États-Unis et par B’Tselem d’Israël de ce que les Palestiniens avaient depuis longtemps affirmé sur l’apartheid israélien, est remarquable. Israël étant maintenant dirigé par un Premier ministre qui a été un leader de colonie et qui s’est fièrement engagé à abolir la Ligne verte, la description de la situation comme apartheid ne peut que difficilement être controversée. Cela n’a pas empêché des efforts redoublés pour supprimer cette terminologie. De nombreux soutiens d’Israël ont une conscience aiguë de la façon dont une vaste perte de légitimité aux yeux de la communauté internationale serait dévastatrice pour le projet sioniste.
En 2016, une organisation intergouvernementale appelée l’Alliance Internationale pour la Mémoire de l’Holocauste a publié un document qui met en avant des exemples de ce qui constitue l’antisémitisme contemporain. Ces exemples incluent « le fait de nier le droit du peuple juif à l’autodétermination, par exemple en prétendant que l’existence de l’État d’Israël est une entreprise raciste ». Avec un soutien significatif d’entités israéliennes officielles, l’IHRA a rapidement gagné en attractivité : des institutions publiques ou éducatives dans le monde ainsi que plusieurs gouvernements ont adopté cette définition comme la norme à partir de laquelle se mesure le comportement antisémite.
Certaines communautés juives à l’extérieur d’Israël ont manifesté leur opposition ; ces critiques voient un danger pour les Juifs de la diaspora à porter des accusations d’antisémitisme de la façon intéressée qu’ont eue les gouvernements israéliens successifs en la matière. Leur inquiétude est qu’en utilisant la définition de l’IHRA comme, en fait, un outil du « soft power » israélien, ils seront conduits à des erreurs dans l’identification du véritable antisémitisme, pouvant ainsi mettre en danger la vie des Juifs en dehors d’Israël. Cela complique aussi le désir d’identification à un collectif juif non impliqué dans les violations israéliennes des droits humains et du droit international. Ce recul est visible par exemple, dans la Déclaration de Jérusalem sur l’Antisémitisme (JDA), signée par plus de trois cents spécialistes majeurs de l’histoire juive, des études sur l’Holocauste et des études sur le Moyen-Orient, qui ont proposé une nouvelle définition de l’antisémitisme dont les lignes directrices apportent plus de clarté et distinguent clairement l’antisémitisme de la critique d’Israël et du sionisme. Ces lignes directrices permettent de même des critiques valides d’Israël en tant qu’État colonial de peuplement ou État d’apartheid, plutôt que d’amalgamer automatiquement cette critique à la haine antijuive.
*
La mobilisation palestinienne qui a étayé ces changements a été menée de façon prédominante par des groupes locaux en Palestine et dans la diaspora. La désignation par le gouvernement israélien, cinq mois après l’Intifada de l’Unité, en octobre 2021, de six des groupes palestiniens humanitaires les plus connus, y compris ceux qui font avancer la procédure juridique contre Israël de la Cour Pénale Internationale (CPI) « d’organisations terroristes » témoigne du pouvoir et de l’effectivité d’une telle action de la société civile. Ces groupes ont gagné en influence en dépit d’une absence de direction stratégique et démocratique du mouvement national palestinien officiel.
Le 8 juin 2021, après un mois d’Intifada palestinienne de l’Unité, l’OLP a publié son propre rapport, « C’est un apartheid : la réalité de l’occupation coloniale de la Palestine par Israël ». Bien qu’elle reconnaisse les pratiques d’apartheid contre le peuple palestinien du fleuve à la mer, l’étude de l’OLP a limité sa recherche aux pratiques israéliennes d’apartheid au sein de l’État nominal de Palestine (c’est-à-dire le Territoire occupé de Cisjordanie, dont Jérusalem et la bande de Gaza), qui en 2012 s’était vu attribuer le statut d’observateur non-membre à l’ONU. Cela va dans le sens de la décision historique de l’OLP de représenter les Palestiniens des territoires occupés et les réfugiés, sans parler au nom des Palestiniens d’Israël (qui forment au total un cinquième de la population du pays) ; cette décision peut avoir eu du sens dans la perspective d’un État palestinien, mais c’est une omission criante maintenant que le dit État semble extrêmement improbable. Selon cette analyse, dans ce territoire que l’OLP considère comme un futur État-nation, l’apartheid se manifeste dans le système juridique dual qu’Israël maintient en Cisjordanie (l’un pour plus de 700 000 colons juifs et l’autre pour les sujets palestiniens éparpillés dans 168 enclaves) et dans l’isolement et la séparation de Gaza, qu’Israël maintient sous un blocus militarisé presque total. En limitant son focus au régime militaire d’Israël dans le territoire [occupé], le rapport de l’OLP est le dernier en date d’une longue série d’efforts pour condamner l’apartheid israélien tout en maintenant la logique de la partition.
Cette tentative a commencé en 2012, lorsque la Convention Internationale de l’ONU sur l’élimination de la discrimination raciale (CIEDR) a averti Israël en lui disant de prendre immédiatement des mesures pour interdire et éradiquer la politique d’apartheid ou les pratiques de ségrégation raciale dans les Territoires palestiniens occupés en violation de ses articles. Deux ans plus tard, la Palestine a intégré la convention, ce qui a marqué le point de départ de la recherche d’une remédiation juridique internationale aux pratiques d’apartheid d’Israël sur son territoire. Puis, en 2015, après que la Palestine a accédé au Statut de Rome qui a mis en place la CPI, le bureau du procureur de la CPI a entamé une enquête préliminaire sur la suspicion de crimes de guerre dans l’État de Palestine. Bien qu’il se soit centré sur les colonies de Cisjordanie et sur les hostilités à Gaza, le bureau du procureur de la CPI a remarqué qu’il avait commencé à recevoir des informations sur « la prétendue installation d’un régime institutionnalisé de discrimination systématique » dans l’État de Palestine. Le bureau du procureur de la CPI a conclu cette enquête préliminaire en 2019 et, pus tôt cette année, il a ouvert une enquête formelle. Cette année également, la CPI a décidé qu’elle est compétente sur de graves crimes internationaux commis en Palestine, des offenses pouvant inclure l’apartheid. Dans son soutien aux efforts de la CPI, l’organisation palestinienne de premier plan de défense des droits civils et humains Al-Haq a constamment argumenté contre la notion qu’une critique de l’apartheid israélien pouvait être limitée aux territoires occupés. Pour elle, cette erreur ne servirait qu’à aggraver la ségrégation raciale et la discrimination systémique en approuvant tacitement la fragmentation du peuple palestinien – en d’autres termes la logique de partition.
La poursuite par la direction palestinienne d’une stratégie d’État-nation limitant son attention à l’apartheid israélien dans les Territoires occupés a involontairement aidé cet enracinement. Les Palestiniens en Israël, toujours tenus à l’écart du processus de paix, répètent souvent que la décision historique de l’OLP de reconnaître Israël et d’accepter la partition consistait à approuver une entente sur l’apartheid qui les traitait différemment de la façon dont étaient traités les Palestiniens dans les territoires occupés – bien que, de part et d’autre, ils fussent dans un même système. Un avocat palestinien important m’a dit que l’OLP « légitimait le sionisme » en acceptant la partition et il a ajouté que « ceux de 48 (les citoyens palestiniens d’Israël) sont le seul groupe palestinien qui… défie la judaïté de l’État ». La résistance à la discrimination institutionnalisée à l’intérieur d’Israël est la lutte principale contre le sionisme, disent ces Palestiniens, alors que la stratégie de l’OLP se fonde sur l’acceptation de la conquête sioniste de la Palestine comme un fait accompli et sur l’action au sein de ce cadre de compromis pour assurer quelques restes de leurs droits, loin d’une véritable autodétermination.
Une acceptation pragmatique de la partition a prévalu parmi les Palestiniens ordinaires comme parmi leurs dirigeants. Même s’ils reconnaissent la réalité du projet de colonisation de peuplement et du régime d’apartheid d’Israël, de nombreux Palestiniens consentent en pratique à la partition comme voie vers une autonomie limitée, étant donné qu’elle offre la séparation et donc un certain soulagement, par rapport au fait de vivre sous le regard de leurs oppresseurs. Après des décennies de discrimination et d’occupation, de nombreux Palestiniens, y compris parmi ceux qui défendent un État unique, admettent souvent ouvertement leur incapacité à accepter de vivre dans les mêmes quartiers que ceux qu’ils voient inévitablement comme les acteurs de leur oppression ; il leur semble préférable de préserver un écosystème exclusivement palestinien. La partition et la solution fugace à deux États ont offert l’illusion de cet apaisement.
C’est le paradoxe que beaucoup de Palestiniens endossent quand ils insistent sur la responsabilité face à l’apartheid israélien. Le seul représentant officiel du peuple palestinien, l’OLP, est investi des pouvoirs diplomatiques et légaux qui lui ont été accordés seulement après son acceptation de la partition et sa reconnaissance de l’État d’Israël. Le prix de l’admission à la communauté internationale pour l’OLP a été de souscrire au même ordre géopolitique auquel avait souscrit d’emblée la colonisation sioniste de la Palestine. Les choses sont restées en l’état jusqu’à ce que l’OLP retrouve un potentiel, significativement contraint, pour fournir des accusations à la CPI sur l’apartheid israélien. Pour un des membres de cette direction palestinienne, inverser le cours des choses et contester la partition est non seulement impensable mais serait « suicidaire » ; pour un autre, ce serait « (la) chose la plus dangereuse… Nous perdrons tout… Quid des résolutions de l’ONU ? »
Le résultat est une paralysie politique – et un statu quo désastreux soutenu par la perspective chimérique d’une solution à deux États à laquelle presque personne ne croit plus. Le système du droit international sur lequel l’OLP a placé ses espoirs et que les Palestiniens invoquent constamment pour souligner les violations israéliennes de leurs droits, offre cependant des outils importants, telle la Résolution 3236 de l’ONU qui affirme le droit des Palestiniens à « l’indépendance nationale et à la souveraineté » et le droit au retour des réfugiés. Pour autant, du même coup, elle agit comme un carcan, conditionnant la reconnaissance internationale des aspirations palestiniennes à un État à la légitimation du colonialisme de peuplement israélien. En d’autres termes, l’OLP est fortement incitée à écarter toute reconnaissance de la façon dont l’ensemble fonctionne comme système d’apartheid. Il en résulte une élite palestinienne corrompue, collaboratrice et autoritaire qui accepte ce système plutôt que de proposer une stratégie de libération qui puisse fonctionner à travers cette complexité.
Le démantèlement de l’apartheid israélien – simple manifestation d’une histoire de colonialisme de peuplement qui a préparé 1948 – n’est qu’un aspect d’un processus de décolonisation dans lequel sont engagés les Palestiniens. Ce projet, complexe, multiforme et très mal compris, contient des tensions pouvant paraître insolubles. Pour les dirigeants de l’OLP, une de ces tensions vient de la peur de ne pouvoir mener simultanément la lutte contre l’occupation et contre l’apartheid. Cette pensée est inutilement binaire ; ce qui est encore plus important, c’est qu’elle est trop déférente vis-à-vis de la jurisprudence internationale et de la doctrine de l’ONU sur la Palestine (incarnée dans différentes résolutions de l’ONU comme la 242 qui affirme l’illégalité des colonies israéliennes) qui ont toutes les deux des imperfections, des contradictions intrinsèques et sont marquées de l’empreinte du colonialisme. On peut insister sur l’illégalité de l’installation territoriale d’Israël dans les Territoires occupés comme voie légale pour tenir Israël responsable, quel que puisse être finalement l’engagement dans la partition. Un mouvement palestinien efficace peut s’opposer à l’occupation et à l’apartheid comme à deux éléments d’une stratégie globale qui doit comporter un plaidoyer pour l’égalité et pour le droit au retour. En d’autres termes, il revient aux Palestiniens de casser la mainmise du paradigme de la terre-contre-la-paix, qui tient la direction officielle sous son emprise, parce que c’est la logique de la partition qui a fait obstacle à la quête de leurs droits universels.
Une autre incompréhension, souvent visible chez les Israéliens et leurs soutiens progressistes à l’étranger, est que l’objectif de démantèlement de l’apartheid et de la recherche de l’égalité vise à assurer une pleine égalité à tous les Palestiniens en Israël. J’ai entendu un nombre incalculable de fois de la part d’acteurs politiques israéliens et de représentants officiels qu’il est compréhensible que les Palestiniens recherchent l’égalité avec les Israéliens étant donné qu’Israël offre une meilleure qualité de vie que celle que pourrait offrir un État palestinien. Assez étrangement, les dirigeants palestiniens admettent – sans toutefois de connotations paternalistes – que rechercher l’égalité c’est viser la citoyenneté en Israël. Un dirigeant de l’OLP m’a dit avec passion : « Je ne veux pas être israélien. Je ne veux pas qu’ils prennent la Palestine avec mon approbation ». Comme toujours, ce point de vue est tellement attaché à une solution fondée sur la partition, qu’il échoue à saisir un mouvement anti-apartheid comme élément crucial d’un processus plus large de décolonisation. « Reddition » a été le mot qu’un Palestinien en Israël a employé pour me décrire la recherche de citoyenneté en Israël, avant de clarifier le terme de décolonisation : « Nous avons besoin d’être citoyens, non pas d’Israël » a-t-il dit, « mais d’un État complètement différent ».
L’enjeu d’une décolonisation effective d’un régime largement plus puissant, des points de vue tant économique que diplomatique et militaire, est vraiment énorme. Le seul moyen, pour les Palestiniens, de démarrer, c’est une stratégie politique de décolonisation qui apporte une argumentation claire en rejetant la partition comme une impasse destructrice. Reconnaître ce fait ne signifie pas que les Palestiniens aient à renoncer aux principes du droit international qui ont donné lieu à cette partition, mais plutôt qu’une nouvelle stratégie doit être suffisamment intelligente pour utiliser ces outils, aussi émoussés et limités soient-ils, au service d’un élan plus vaste pour la décolonisation de la Palestine.
L’appréhension de la direction palestinienne officielle mise à part, la question n’est pas de savoir si les Palestiniens devraient ou non adopter ce nouveau cadre – car le mouvement est déjà en vitesse de croisière, dirigé non pas par le sommet mais par la base. La Grande Marche du Retour de Gaza en 2018-2019 a été un exemple puissant de la mobilisation populaire palestinienne reprenant le langage des droits et s’éloignant de l’étroitesse de la partition. Cette campagne ne s’est estompée que lorsque le Hamas a affirmé son contrôle de la résistance, tandis que la communauté internationale a largement détourné le regard lorsqu’Israël a usé d’une violence létale indiscriminée pour la réprimer. Plus récemment, l’Intifada de l’Unité en mai a produit un Manifeste de la Dignité et de l’Espoir qui s’est positionné contre la fragmentation de la « prison d’Oslo », ainsi qu’il a nommé les accords du processus de paix. Le manifeste a affirmé que l’intifada « réunit la société palestinienne dans toutes ses différentes parties ; et réunit notre volonté politique et nos moyens de lutte pour nous confronter au sionisme dans toute la Palestine ».
Il y a plusieurs années, avant le réalignement de B’Tselem et de Human Rights Watch, j’ai demandé à un diplomate de l’UE si son pays continuerait à soutenir Israël s’il y avait une large reconnaissance que c’était un État d’apartheid. Sa réponse est révélatrice de sa franchise :
« C’est déjà de l’apartheid. Lorsque les Palestiniens mèneront vraiment une lutte anti-apartheid, je ne sais pas. Israël a maintenu un système de fait à deux vitesses depuis cinquante ans et les relations UE-Israël s’approfondissent encore. À quel point faut-il que l’apartheid devienne tellement flagrant que cela embarrasse les gouvernements de l’UE ? La situation est très élastique ; le mensonge peut tenir encore longtemps. »
Pour les Palestiniens, les enjeux ne sont pas simples quant à savoir quelle stratégie pourrait finalement réussir ; ce sont des enjeux de survie. Le but de la colonisation sioniste de la Palestine apparaît clairement : ce n’est pas l’approfondissement de l’apartheid mais la dépossession à venir des Palestiniens et la consolidation de la terre offerte à l’établissement juif. Quand des voix de la droite israélienne appellent à des transferts de population dans des termes de plus en plus explicites, de même que lorsque les Conseils des colonies accueillent favorablement des transferts dans les territoires occupés pour faire de la place aux exercices militaires comme « une autre façon d’accroître la gouvernance et le contrôle sur un espace ouvert », nous devrions les croire. Ce à quoi ont appelé leurs prédécesseurs, et qui naguère pouvait sembler farfelu et extrême, a fini par triompher. La Nakba n’a jamais pris fin – et elle pourrait encore entrainer une autre expulsion massive.
Les événements de mai nous ont rappelé que nous, Palestiniens, sommes un peuple uni dans l’opposition à un même régime. Dans cette unité, il y a une grande diversité de tactiques, d’idéologies et de sentiments. Notre mouvement doit être suffisamment large pour inclure l’ensemble, mais il doit aussi y avoir une vision singulière de ce que veut dire l’émancipation : l’abolition du régime colonial de peuplement en Palestine.
Tareq Baconi est l’auteur de Hamas Contained : The Rise and Pacification of Palestinian Resistance (2018) (le Hamas maîtrisé : Croissance et pacification de la résistance palestinienne). Anciennement analyste en chef de l’International Crisis Group sur Israël-Palestine, il a été en 2012 chercheur invité, associé au Centre de recherches en sciences humaines de l’Université du Cap Ouest et a été nommé président du directoire de Al-Shabaka, le réseau palestinien de politologie.