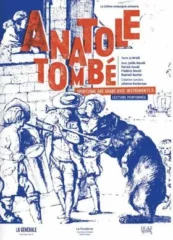Lecture performée d’une suite de textes qui, sous le titre Anatole Tombé – spiritisme marrane font revivre un mort ancestral pour l’interroger sur un présent fou, marqué de l’empreinte coloniale.

4 DATES : le 23 novembre à 20h au Mans, à La Fonderie, les 29 et 30 novembre à 19h30 et le 1er décembre à 20h, à la Parole errante, 9 rue François Debergue, 93100 Montreuil
Anatole Tombé, Spiritisme juif arabe avec instruments. Lecture performée. Texte de Jo Mrelli. Par Colline Cie.
La tâche d’attiser dans le passé l’étincelle de l’espoir ne revient qu’aux artistes qui en sont intimement persuadées : si l’ennemi triomphe, même les morts ne seront pas en sûreté. Et cet ennemi n’a pas cessé de triompher.(D’après Walter Benjamin)
Le texte
Anatole Tombé. Spiritisme poétique avec instruments est une création à partir d’une suite de textes qui, sous le titre Anatole Tombé – spiritisme marrane font revivre un mort ancestral pour l’interroger sur un présent fou. Quelles sont les effets persistants, dans le présent des corps vivants, de la folie coloniale ? Quelles procédures de désenvoûtement faut-il inventer pour dissiper les traces qu’elle laisse non seulement chez les descendants des colonisés mais aussi et plus généralement dans les mondes duels enfantés par la colonie ? Quelles alliances secrètes ou manifestes, quels compromis faut-il tisser, à quels esprits s’adresser pour « sortir de la grande nuit », selon le mot repris à Césaire par Achille Mbembe ? Qui est Anatole Tombé et que fait-il dans cette histoire de juifves arabes ?
Une femme cherche à élucider la folie familiale en enquêtant sur son proprepatronyme, ayant l’intuition qu’une clé se trouve dans la défiguration de la géographie des noms. Au hasard de la rencontre d’un rebouteux de village suisse, elle se trouve embarquée dans les procédures du New Age européen, pâles répliques des méthodes traditionnelles de dialogue et de tractation avec l’invisible. Comment retrouver l’efficace des protocoles de traitement de la souffrance en Afrique ? Comment retrouver l’Afrique elle-même, dont cette femme est une pas si lointaine rejetonne, par-delà les dénis de l’histoire ?
L’itinéraire s’ouvre sur un constat d’impasse, celle de l’enquête sociologique. Après quoi les allers et retours temporels prennent appui sur une succession de séjour hivernaux d’abord en Suisse, puis en Normandie, au cours desquels l’aïeul – celui que les « séances », maqâmat en arabe, sont chargées de ramener à la vie, ce grand-père colonisé qui embrassa autrefois, dans son inconscience, la puissance coloniale – finit par apparaître sous la forme d’un ours – un ours andalou, un ours d’Afrique – surgi d’un récit de Heinrich Heine. D’autres rencontres impossibles, secrètes et fantomatiques ont lieu : avec Baldwin, avec Fanon, avec Kateb Yacine, qui font émerger peu à peu la vérité douloureuse du grand-père. Celui-ci finit par déposer, en cadeau, un ouvrage d’Ibn Khaldoûn qui révèle enfin ce qui se cachait sous le3 palympseste patronymique. D’inconscience à inconscient, comment la honte refoulée d’avoir trahi, puis la blessure d’avoir été trahi à son tour par les bénéficiaires de sa trahison, a-t-elle tissé la folie familiale que les séances sont chargées de dénouer ?
L’écriture oscille entre prose coupée et une forme poétique asyntaxique et agrammaticale, à travers laquelle la protagoniste de cette fiction finit par prendre conscience du rôle que la langue française et la littérature française, soft-power pas si soft des temps coloniaux, jouèrent dans la fusion amoureuse entre le grand-père, qu’elle n’a pas connu, et la grand-mère, « carnassière de pacotille » qui sauva l’enfance.
Le projet artistique
Anatole Tombé. Spiritisme poétique avec instruments cherche à rendre compte de la tentative de faire parler un mort ancestral en l’interrogeant sur des formes persistantes de folie qui renvoient à un passé colonial inscrit dans l’inconscient des formes de la vie collective comme dans la texture des existences individuelles.
À travers la recherche fictionnelle de procédures de désenvoûtement qui se départiraient des leurres aseptisés du New Age comme de l’enquête sociologique ou génétique, se défait peu à peu toute certitude sur ce qui délimite les identités collectives, comme sur la valeur même de la rationalité et de la sécularité modernes, complices de l’assujettissement colonial. À travers l’incertitude du « qui parle », l’identité individuelle ellemême devient flottante. Les textes veulent interroger sur ce que c’est qu’une vie qui vaut :
jusqu’où peut-on aller pour (se) prouver qu’on a raison d’être en vie ? Et comment échapper à la perversion de l’universel (dans les deux sens de cette formule : l’universel dans sa dimension potentiellement perverse et la perversion de l’idéal universaliste, dans sa dimension vitale) ?
Nous voulons reprendre pour nous, artistes, la tâche assignée à l’historien par W. Benjamin : « faire surgir du passé l’étincelle de l’espoir » pour éviter que l’ennemi ne triomphe, car alors « même les morts ne seront pas en sûreté ». Il faut prendre au sérieux l’injonction à protéger les morts de l’effet corrosif des récits qui trafiquent et instrumentalisent le passé, conduisant à la folie des vivants. Nous nous souvenons d’Artaud, contemporain du personnage du grand-père : « Nous avons surtout besoin de vivre et de croire à ce qui nous fait vivre et que quelque chose nous fait vivre. » La poésie et le plateau sont le lieu où les vivants rendent aux morts la parole grâce à laquelle, en retour, les morts rendent les vivants à la vie. Ils sont aussi le lieu où peuvent être interrogés les présupposés mortifères de la rationalité séculariste qui réduit la terre et les esprits au silence (David Abram). Artaud encore : « Nous ne sommes pas libres. Et le ciel peut encore nous tomber sur La tête. Et le théâtre est fait pour nous apprendre tout cela. »
Le travail musical et vocal sur la langue poétique des textes est en lui-même une procédure de désenvoûtement. Nous croyons qu’il faut ressusciter « l’art perdu de la conversation » (Benjamin encore, et Laurie Anderson) et ne pas craindre de le mettre en œuvre, dans nos rapports avec les morts. Et dans nos rapports entre nous, dans le travail de création.
Deux pupitres, deux micros, peut-être un tulle derrière lequel passe une ombre. Une voix, parfois deux, un baryton d’outre-tombe. Les textes sont matière à improvisation entre voix, accordéon électronique et contrebasse, avec peut-être des incursions d’autres instruments, au gré d’invitations impromptues. L’approche mêle lecture performée, chant, improvisation.
L’univers sonore de Laurie Anderson, avec sa narrativité habitée, est l’une de nos plus profondes inspirations. Il y a aussi les musiques noires d’Afrique et des Amériques (Paul Robeson vient ainsi hanter l’espace sonore comme une autre figure de grand-père), et arabes (par exemple Nass el-Ghiwane). Des échos de la musique populaire française, avec sa gouaille, nous visiteront peut-être discrètement pour nous offrir, divine surprise, le meilleur de ce qu’il est convenu d’appeler « intégration ». L’accordéon électronique déploie des paysages tantôt sombres, tantôt lumineux, des ponctuations drôlatiques, des importations instrumentales (percussions, violons). De son côté, la contrebasse apporte des accents plus sobres, des lignes plus abstraites et plus méditatives, un dialogue et une déposition. Tour à tour, l’un et l’autre portent, accompagnent, nourrissent et contextualisent les voix qui font l’opération poéticospirite.