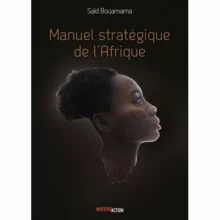La vague de manifestations populaires qui secoue la planète et l’hexagone en réaction à l’assassinat de Georges Floyd est certes exceptionnelle mais pas surprenante, inattendue en terme d’ampleur et de propagation mais pas imprévisible, donneuse de puissance mais également confrontée à un déni systémique. Concernant la France, elle souligne à la fois les progrès immenses obtenus par la mobilisation militante depuis plusieurs décennies et l’ampleur du chemin qui reste à parcourir.
Elle met en exergue l’importance des conscientisations qui se sont accumulées au cours des luttes passées et leur accélération dans la dernière période [caractérisée par la généralisation à des « blancs » de pratiques banalisées pour les « colorés » des quartiers populaires]. L’assassinat de Georges Floyd fait en conséquence fonction de déclencheur révélant une cause plus profonde. Comme les révoltes des quartiers populaires de novembre 2005 une digue saute, une goutte fait déborder un vase, une accumulation quantitative de colères populaires débouche sur une transformation qualitative. Comme celles-ci le mouvement actuel ébranle l’ordre de l’injustice mais suscite aussi immédiatement des stratégies visant à modifier à la marge cet ordre pour mieux le préserver et le reproduire.
Une colère politique qui vient de loin
Quatre facteurs sont, selon nous, à prendre en compte pour saisir les forces de notre mobilisation collective actuelle mais aussi les menaces qui pèsent sur lui. Ils se sont cumulés progressivement avec chacun leur dynamique propre et leur temporalité spécifique pour créer les conditions de possibilité de la mobilisation. Ni résultat d’un amalgame ou d’un mimétisme avec la situation états-unienne comme le serinent officiels et « chroniqueurs » des grands médias, ni mouvement spontané produit par l’effet magique des réseaux sociaux, le mouvement de protestation actuel émerge de la dynamique de coagulation de ces quatre facteurs créant la rencontre entre une structure d’opportunité politique et une révolte ancienne en recherche d’un canal d’expression. La prise en compte de cette base matérielle et de ses effets sur les subjectivités et les consciences est incontournable pour comprendre la situation et en conséquence continuer la lutte.
Tout le monde l’a compris, manifestants comme gouvernement ou représentants de l’institution policière, l’enjeu du mouvement actuel est fondamentalement politique et la nature de celui-ci est entièrement politique. En témoigne à la fois l’insistance des manifestants sur la dimension systémique des violences policières et le déni généralisé sur une quelconque cause institutionnelle de la part du gouvernement et des syndicats de policier. Ce caractère politique vient contredire l’image encore trop fréquente des quartiers populaires comme « désert politique 1 ». En dépit de multiples difficultés [précarité des habitants et des militants, diabolisation de ceux-ci comme « communautaristes », répression directe ou indirecte 2 [par la coupure de subventions, le non accès aux équipements publics ou les poursuites judiciaires usantes] des associations et collectifs, une transmission des savoirs et des expériences des luttes antérieures a quand même eu lieu. Cette transmission est éparpillée, non systématique, partielle et incomplète, inégale selon les lieux, etc., mais constitue néanmoins le premier facteur explicatif de l’ampleur du mouvement de contestation. Les chanteurs de Rap, les initiatives des associations militantes et des collectifs contre les violences policières, la multiplication des pratiques de transmission de la mémoire [sur les réseaux sociaux en particulier], etc., ont inscrit les violences policières dans le processus de socialisation des nouvelles générations des quartiers populaires. Complétée par la confrontation quotidienne aux pratiques policières, cette transmission, aussi insuffisante et partielle soit-elle a été un levier de la prise de conscience que nous n’avions pas à faire à des « bavures » mais aux résultats logiques de choix politiques.
Ce premier facteur s’inscrit en outre dans une séquence historique précise marquée d’une part par la dégradation massive des conditions d’existence dans les classes et quartiers populaires et par d’autre part un éloignement progressif de la période de la guerre d’Algérie et plus largement de la colonisation. Cette séquence historique est selon nous le second facteur explicatif. La massification et la paupérisation a en effet touché massivement l’ensemble des jeunesses des quartiers populaires, les discriminations racistes venant ajoutées pour les jeunes « racisés » des inégalités supplémentaires significatives. Or même si les processus de ségrégation tendent à produire une répartition colorée des espaces d’habitation, les quartiers populaires restent habités par une population multiple en termes d’origine. Les jeunes « blancs » et « blanches » des quartiers populaires ont eu comme amis et amies d’enfance et d’adolescence des Mohamed et des Babakar, des Aminata et des Malika. Ils et elles ont été témoin des discriminations et des pratiques policières qu’ils et elles subissaient et du traitement médiatique et politique de celles-ci.
L’éloignement progressif de la période coloniale pour sa part ne fait pas disparaître entièrement les représentations sociales racistes qui lui été liées mais en atténue inévitablement l’ampleur et les effets. La guerre d’Algérie ne fut pas seulement un moment d’affrontement armé mais également une séquence de guerre idéologique intense et multiforme qui eut un effet de socialisation politique sur une partie non négligeable de la jeunesse de l’époque. Si une partie de la jeunesse hérite de cette « socialisation de guerre » une orientation anticolonialiste [mai 68 et son anti-impérialisme est à cet égard en filiation avec la guerre d’Algérie], une autre sort de la guerre imbibée de représentations sociales racistes, d’images essentialistes sur les anciens colonisés [leurs « altérités », leurs cultures, leurs religions et essentiellement l’Islam]. Certes ces représentations sociales racistes ont continuées à être produites et reproduites après les indépendances par de multiples canaux mais dans une intensité inévitablement moindre et sous une forme moins directe que pendant les 8 années de guerre. S’il y a eu tant d’effervescence politique ces dernières décennies pour réactiver idéologiquement ces représentations [multiples débats sur le foulard depuis 2004, discours sur l’Afrique non entrée dans l’histoire, loi sur l’œuvre positive de la colonisation] c’est justement parce qu’elles s’amenuisaient sans disparaître entièrement. Ce second facteur expliquait déjà en 2004 qu’une partie non négligeable de la jeunesse « blanche » des quartiers populaires s’est tenue à distance de l’hystérie politique sur le foulard 3. Elle explique aujourd’hui la présence remarquée de cette jeunesse dans le mouvement. Ce n’est pas toute la jeunesse « blanche » qui est aujourd’hui plus fortement mobilisée contre les violences policières mais une partie de celle issue des classes populaires [classe ouvrière et fraction inférieure de la petite-bourgeoisie] qui a vécu des espaces-temps de socialisation communs avec leurs pairs racisés. Nous disons sciemment une partie car une autre composante de cette jeunesse tourne son regard en direction de l’extrême-droite.
Le troisième facteur est également de nature sociologique et se situe dans le développement de la négrophobie qui pour être ancienne et durable n’en connaît pas moins une intensification importante. Au fur et à mesure que s’intensifiait l’enracinement de cette « nouvelle » immigration se développait la prise de conscience non seulement de cette négrophobie mais également de sa négation par les discours politiques et médiatiques de gauche comme de droite. « Les immigrés originaires d’Afrique subsaharienne n’étaient que 20 000 en France au moment du recensement de 1962, contre 570 000 en 2004, soit une multiplication par 27 en un peu plus de 40 ans 4 » indiquent les données statistiques disponibles. Ce n’est qu’avec le nouveau siècle qu’émerge une génération quantitativement importante de descendant de cette immigration subsaharienne c’est-à-dire une génération née française et socialisée en France. Avec elle [et comme précédemment dans la décennie 80 pour les descendants de l’immigration originaire d’Afrique du Nord] se déploie une exigence d’égalité et un refus des places subalternes assignées qui se concrétise par de nombreuses associations et initiatives militantes. Encore plus invisibilisée du fait de son caractère plus récent, cette jeunesse était confrontée de front à la négrophobie et aux politiques de contrôles policiers des quartiers populaires. Les conditions d’une « colère noire 5 » grandissait d’autant plus qu’elle était niée par l’essentiel de la classe politique à droite comme à gauche. Cette « colère noire » s’exprime fortement dans la mobilisation actuelle mais a des racines beaucoup plus profondes. L’incapacité à prendre la mesure de cette colère [qui s’ajoute à celle des autres racisés et à la colère populaire en général] explique les discours actuels sur l’amalgame erroné que feraient les manifestants avec les USA. Un tel discours n’a aucun effet sur les premiers concernés mais peut en revanche en avoir un sur le reste de la population habitué au processus de construction médiatique des quartiers populaires visant à les rendre impopulaires.
C’est à ce niveau que se situe le quatrième facteur explicatif c’est-à-dire la modification de la structure d’opportunité politique. Le mouvement des Gilets jaunes a suscité un vent d’inquiétude certain pour la classe dominante. En dépit de la puissance de ses appareils idéologiques pour invisibiliser les effets catastrophiques de ses choix néolibéraux, les Gilets jaunes mettaient en mouvement, non pas seulement les militants et les syndicalistes qui n’ont jamais cessés leur mobilisation, mais des anonymes habituellement silencieux. La vitesse de la propagation du mouvement, ses formes de luttes, sa popularité, etc., ont conduit la classe dominante à tenter une gestion uniquement répressive de la contestation. Le résultat a été la visibilisation des violences policières qui s’échappaient ainsi du seul territoire des quartiers populaires pour mutiler, éborgner et gazer, des milliers de citoyens. Le spectacle de cette violence policière quotidienne ne pouvait pas ne pas modifier le regard sur cette autre violence policière, raciste celle-ci, qui endeuillait régulièrement les quartiers populaires.
Cette tendance à une mutation des regards fut encore amplifiée par le choix stratégique de certaines associations des quartiers populaires à soutenir le mouvement des Gilets Jaunes (comité Adama, FUIQP, etc.) tout en y apportant leurs revendications spécifiques liées à leur oppression particulière. Le réel social s’imposait et brisait le voile jusque-là efficace des appareils idéologiques d’Etat qui pendant des décennies avaient isolés les quartiers populaires. Dans la même séquence historique l’attentat contre la mosquée de Bayonne rendait impossible la négation dominante de l’existence d’une islamophobie grandissante. Ici aussi la réalité sociale s’imposait aux consciences obscurcies par le déni idéologique. Enfin le mouvement contre la réforme des retraites, qui a subi la même violence que les Gilets jaunes, a renforcé encore la conscientisation à la fois des missions confiées à l’institution policière, de l’impunité qui en découle et de la fascisation de cette institution dont un des indicateurs antérieur était le vote d’extrême-droite grandissant. L’ensemble de ces mutations suscite une tendance à la transformation de la structure d’opportunité politique, desserrant l’isolement des quartiers populaires et de leurs habitants, sans pour autant le faire disparaître entièrement.
L’action des quatre facteurs rapidement décrit ci-dessus explique l’ampleur prise par le mouvement actuel déclenché par l’assassinat de Georges Floyd. L’ampleur du mouvement ne peut se réduire à la seule dimension quantitative. D’autres initiatives ont mobilisées dans le passé des dizaines de milliers de personnes [de la marche pour l’égalité de 1983, déjà contre les violences policières, à la manifestation contre l’islamophobie en novembre 2019 en passant par les mobilisations massives du comité Adama depuis plusieurs années au moment de l’anniversaire de l’assassinat]. Elle tient à la composition des manifestants dont les caractéristiques peuvent, selon nous, se résumer comme suit : présence massive d’une nouvelle génération, présence d’un nombre important de non racisés, présence de représentants et de militant du mouvement syndical, social et politique. Elle tient également à la dissémination des mobilisations dans l’ensemble des grandes villes et des villes moyennes. Elle tient enfin à une médiatisation nouvelle de la question des violences policières tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Les associations et militants [et en particulier le MIB puis les multiples comités de familles de victimes sur la question spécifique des violences policières] qui ont pendant des décennies pris en charge le travail ingrat, couteux et usant de poser les questions qui fâchent [violences policières, discriminations systémiques, racisme d’Etat, etc.], de dénoncer l’occultation de certaines oppressions et exploitations spécifiques (islamophobie, négrophobie, racisme antitsigane, etc.) de rappeler les dimensions du réel absentes des programmes politiques et des agendas revendicatifs, etc., constituent la base matérielle historique du succès indéniable du mouvement actuel.
La contre-offensive idéologique et politique
Notre satisfaction actuelle ne doit pas nous rendre aveugle sur les difficultés qui nous attendent. Après quelques jours d’hésitation liée à l’incertitude sur l’ampleur que prendra le mouvement, la contre-offensive idéologique a d’ores et déjà commencée. En témoigne les réactions gouvernementales et institutionnelles au mouvement de contestation actuel. Celles-ci laissent apparaître six « éléments de discours » [pour reprendre le vocabulaire néolibéral] qui cumulés convergent pour nier le caractère systémique des violences policières et bâtir un « consensus » sur une réforme de façade de l’institution policière.
Le premier élément repérable est le discours sur l’amalgame. Emportés par l’émotion d’une part et par l’instrumentalisation de certains « radicaux » d’autre part, les manifestants feraient un amalgame injustifié entre la situation états-unienne et la situation française. C’est tout simplement oublier que la mobilisation actuelle en France [comme ailleurs] ne peut se limiter à un écho aux mobilisations états-uniennes. La force du mouvement actuel est justement l’articulation d’une dimension d’universalité [la compréhension, même partielle et intuitive, de la fonction systémique du racisme et de l’institution policière à l’ère du néolibéralisme] et d’une dimension de particularité [la figure d’Adama comme symbole des centaines de victimes en France, celle des aborigènes en Australie, etc.]. Là où les manifestants constatent des analogies liées au caractère systémique des différentes violences policières nationales, les pouvoirs publics les accusent d’affirmer l’existence d’une similitude. Une émotion manipulée et instrumentalisée par des radicaux sécessionnistes, tel est le résumé des quelques minutes que Macron a daigné consacrer aux mobilisations massives actuelles dans sa dernière allocution : « Nous serons intraitables face au racisme, à l’antisémitisme et aux discriminations, déclare-t-il […] mais ce combat noble est dévoyé […] quand il est récupéré par les séparatismes 6 ». Des dizaines de milliers de manifestants sont ainsi réduits soit en « manipulés » soit en séparatistes. Le message gouvernemental est double et vise deux publics : Discours de menace en direction des manifestants et discours visant à produire une défiance vis-à-vis du mouvement actuel pour le reste de la population.
Le second élément de discours idéologique est lié au premier et en découle, se situe, dans la posture du déni de l’existence d’un racisme institutionnel dans la police produisant des violences policières de nature systémiques. On veut bien reconnaître l’existence d’un problème systémique aux USA mais pas dans l’hexagone, pas dans le « pays des droits de l’homme ». La force du mouvement contraint certes à reconnaître l’existence de « bavures » [qui étaient elles-mêmes niées jusqu’à présent] et d’un « problème » mais c’est pour immédiatement en nier le caractère systémique. Réduire le racisme ou la violence policière à une dimension individuelle est une vieille ficelle des logiques de la domination qui est le cœur de ce que Stokely Carmichael et Charles V Hamilton 7 ont justement nommé « racisme institutionnel » il y a plus d’un demi-siècle. Il s’agit donc de circonscrire le diagnostic à la seule sphère individuelle c’est-à-dire d’exclure du champ du débat les choix sécuritaires effectués, les objectifs donnés à l’institution policière, la militarisation de l’armement policier, les contrôles au faciès systématisé, la création de corps policiers d’exception comme la BAC, les modes d’intervention militaires dans les quartiers populaires 8, etc. La réaffirmation permanente du caractère « républicain » de la police est présentée comme preuve de l’impossible existence d’un racisme institutionnel et de violences systémiques en son sein. Pourtant c’est une police « républicaine » qui en octobre 1961 massacre des centaines d’Algériens à Paris. De même se sont 2495 personnes qui ont été blessées par cette police « républicaine » au cours du mouvement des Gilets jaunes selon les propres chiffres du ministère de l’intérieur d’octobre 2019. Imposer une grille de lecture individualisante des violences policières est le véritable objectif du déni.
Le troisième élément de la contre-offensive idéologique consiste à lancer des « débats-écrans » c’est-à-dire des débats visant à détourner l’attention publique de l’institution policière. La porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye, propose ainsi de rouvrir « de manière apaisée et constructive le débat autour des statistiques ethniques 9 ». Cette proposition est faite le 13 juin au journal Le Monde c’est-à-dire le même jour que la grande manifestation appelée par le comité Adama. Les articles et émissions se sont, sans surprise, succédés sur le sujet, les « spécialistes » et « chroniqueurs » ont été mobilisés, les militants ont été sollicités pour se positionner sur cette question, les leaders politiques de tous les partis ont pris la parole, etc., dans cette tentative de détourner l’attention publique de la question initiale posée par la colère populaire. Ceux qui classiquement nient l’existence même de discriminations liées à l’origine [au travail, au logement, dans l’accès à l’éducation et à la formation, etc.] les invoquent aujourd’hui comme réponse au mouvement social. Ici aussi rien de nouveau sous le soleil. La même réponse a été apportée aux révoltes des quartiers populaires de novembre 2005. Bien entendu les violences policières systémiques sont en lien avec ce sous-bassement qu’est le traitement inégalitaire en fonction de l’origine et de la couleur. Les missions confiées à la police sont aussi fonction de ce sous-bassement et du besoin de prévenir les révoltes sociales qu’il peut potentiellement susciter. Cependant le mettre en avant au moment même où s’expriment une colère précise contre une institution précise relève de la logique du « noyer le poisson dans l’eau ».
Le quatrième élément de réponse consiste à tenter de situer l’État comme étant au-dessus de la mêlée, comme médiateur de composantes de la société en opposition entre elles. L’objectif est, bien entendu, de découpler les pratiques policières des choix politiques effectués en matière de politique sécuritaire. Les manifestations de policiers de ces derniers jours offrent ainsi une opportunité au gouvernement pour légitimer cette « médiation » prenant en compte simultanément « l’émotion des manifestants » et la « colère des policiers », articulant la nécessité de la fermeté « antiraciste » dans l’institution policière et la réaffirmation simultanée d’une irréprochabilité de celle-ci. L’image d’un face à face entre deux acteurs permet d’invisibiliser l’acteur étatique qui reste le donneur d’ordre. Les policiers qui ont manifestés pour exiger le maintien de la clef d’étranglement [c’est-à-dire objectivement du droit de tuer] ne s’y trompent pas. Il s’agissait de faire pression sur l’acteur décisionnel : l’État. S’il existe bien des responsabilités policières, elles ne sont possibles dans une telle fréquence et une telle durée que parce que l’État les autorise.
Le cinquième discours consiste à légitimer médiatiquement des interlocuteurs posés comme « raisonnables » venant faire contrepoids aux irresponsables [séparatistes ] qui s’échinent à parler de racisme systémique dans l’institution policière. Ainsi a-t-on vu ré-émerger médiatiquement la LICRA [qui depuis des décennies contribue par ses déclarations à construire les quartiers politiques comme espaces de déliquescence, de radicalisation islamiste, de foyers de « racisme anti-blanc », etc.] comme dénonciatrice de certaines pratiques policières. De même on assiste à une tentative de recyclage de « SOS Racisme 10 » qui n’hésite pas à « radicaliser » son expression pour acquérir une nouvelle crédibilité. L’objectif ici n’est, rien de moins, que de marginaliser une nouvelle fois les représentants des organisations autonomes des descendants de l’immigration et des quartiers populaires, qui en dépit de leurs faiblesses et de leurs difficultés, ont rendues possibles l’émergence du mouvement social actuel.
Enfin le dernier élément de la réponse idéologique est la très efficace politique de la peur : Susciter une peur sociale afin de rendre intouchable l’institution policière ayant mission de nous protéger. Opportunément les affrontements « entre bandes rivales » [expression de la plupart des articles et émissions] à Nice et à Dijon sont mis en scène politiquement et médiatiquement comme expression d’une « guerre ethnique ». Marine Le Pen compare la situation au Liban et dénonce une « une guerre ethnique, arme automatique à la main ». Le ministre de l’agriculture dénonce le communautarisme et le séparatisme : « Voilà où nous mène le communautarisme, voilà où nous mène le séparatisme dont a parlé le président de la République. » Le républicain Bruno Retailleau exprime explicitement le processus de re-légitimation par la peur de l’institution policière : « Quand je pense que certains voudraient désarmer les policiers, y compris le ministre de l’intérieur ! » 11
Au passage nous avons été les spectateurs d’une essentialisation de haute intensité concernant les citoyens d’origine Tchétchène. Communautarisme, séparatisme, guerre civile, barbarie culturelle Tchétchène, bandes rivales en conflit à l’arme lourde, etc., nous sommes bien en présence d’une tentative de produire une peur sociale conduisant à faire corps avec la police. Le chercheur en sciences politiques Robin Corey a largement analysé cette technique idéologique et la résume comme suit : « La première étape consiste à identifier un objet dont le public devra avoir peur, la deuxième à en interpréter la nature et à expliquer les raisons de sa dangerosité afin, en dernier lieu, d’y faire face, telle manœuvre en trois temps représente une source intarissable de pouvoir politique 12. »
Nous sommes bien en présence d’une contre-offensive idéologique visant à clore une parenthèse de contestation sans modifier, si ce n’est en apparence, les causes réelles des violences policières et du racisme institutionnel de la police. La question de l’organisation des quartiers populaires et des descendants de l’immigration pour prendre en charge le combat pour l’égalité est, plus que jamais, posée sous peine de voir se rééditer régulièrement des luttes exemplaires suivies de silenciations décourageantes. Elle est certes complexe mais incontournable. Faute d’une telle organisation nos victoires et avancée seront sans-cesse suivies de défaites et de reculs. Nos offensives porteuses d’espoirs seront suivies de moments de paralysies du fait d’un sentiment d’impuissance lié à ces reculs logiques. Nous aurons collectivement à tirer le bilan de cette belle séquence de mobilisation collective pour en tirer les leçons pour progresser dans cette longue marche que constitue l’organisation autonome des quartiers populaires et des descendants de l’immigration. Cette organisation autonome est un des facteurs essentiel du mouvement actuel, elle est également la seule voie pour l’avenir.
Publié le 18 juin 2020 par bouamamas
- Voir sur cet aspect l’article d’Abdellali Ajjat, Quartiers populaires et désert politique, Manière de voir, n° 89, Le Monde Diplomatique, Octobre-Novembre 2006.[⇧]
- Voir Julien Talpin, Bâillonner les quartiers. Comment le pouvoir réprime les mobilisations populaires, Les Etaques, Lille, 2020.[⇧]
- Emmanuel Terray, La question du voile : une hystérie politique, Mouvement, n° 32, 2004.[⇧]
- Population et Sociétés, n° 452, janvier 2009.[⇧]
- Ta-Nehisi Coates, Une colère noire. Lettres à mon fils, Autrement, Paris, 2015.[⇧]
- Dépêche AFP du 14 juin 2020[⇧]
- Stokely Carmichael et Charles V Hamilton, Le Black Power. Pour une politique de libération aux Etats-Unis, Payot, Paris, 2009, pp.37-39.[⇧]
- Voir sur cet aspect mon article « La fabrique politique de la violence policière A propos des attaques contre Camélia Jordana », https://bouamamas.wordpress.com/2020/05/28/la-fabrique-politique-de-la-violence-policiere-a-propos-des-attaques-contre-camelia-jordana/#more-529.[⇧]
- Sibeth Ndiaye, Nous payons aujourd’hui l’effacement de l’universalisme républicain, Le Monde du 13 juin 2020.[⇧]
- Sur la fonction politique de cette association voir notre livre « Dix ans de marche des « beurs ». Chronique d’un mouvement avorté », Desclée de Brouwer, Paris, 1994.[⇧]
- Le Monde du 15 juin 2020.[⇧]
- Patrick Boucheron, Corey Robin, Renaud Payre, L’exercice de la peur : usages politiques d’une émotion, Presses universitaires de Lyon, 2015, p. 50.[⇧]