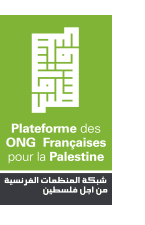Le 26 | L’UJFP associée à des juristes et des universitaires
Depuis quelques mois, les législateurs français s’emballent pour museler la liberté d’expression en voulant criminaliser toute critique de la politique israélienne et en particulier la lutte contre le génocide en cours à Gaza et ce en dépit du droit international (ordonnances, avis ou rapports). Le milieu universitaire est spécifiquement visé.
C’est ainsi que le 20 février 2025, le Sénat a adopté en première lecture et à l’unanimité une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur. Ce texte, déposé en octobre 2024 par les sénateurs Pierre-Antoine Levi et Bernard Fialaire, s’appuie sur un rapport d’information rendu le 26 juin 2024 (n°705) dressant plusieurs constats : une augmentation des actes antisémites au sein des universités françaises ; des difficultés à quantifier ces actes ; une décorrélation du nombre de poursuites disciplinaires consécutives. La réponse législative apportée par la proposition de loi s’appuie sur un triptyque : formation, signalement et sanction disciplinaire.
La proposition de loi prévoit le renforcement des formations “à la lutte contre l’antisémitisme et le racisme, les discriminations, les violences et la haine” dans les établissements d’enseignement supérieur et d’une mission “Egalité et diversité”, en élargissant la compétence de la mission Egalité entre les hommes et les femmes aux autres formes de discrimination.
La mesure phare consiste en la création d’une “section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel” par région académique, qui, saisie par le recteur, “exerce alors, en lieu et place de la section disciplinaire prévue à l’article L. 811-5 [propres aux établissements], le pouvoir disciplinaire à l’égard des usagers.”. Cette nouvelle instance disciplinaire, directement sous le contrôle du recteur, porte atteinte au principe d’indépendance des établissements d’enseignement supérieur.
A la lecture du rapport précité, les mesures envisagées visent à réduire le delta entre le volume d’actes antisémites produit par une étude des ressentis de l’Ifop et l’Union des étudiants juifs de France (UEJF) de septembre 2023 – selon laquelle 91 % des étudiants juifs de France ont déjà été confrontés à au moins un acte antisémite dont 43 % d’entre eux auraient subi “des attaques concernant Israël” – d’une part, et les chiffres de l’enquête Remede de 2023 par la conférence des chargés de mission Egalité et Diversité des établissements d’enseignement supérieur (CPED) – qui relève, en 2022, moins d’une saisine par cellules de signalement internes aux établissements relative à l’antisémitisme – d’autre part.
Il ne s’agit pas d’ignorer le phénomène de non-signalement, ni de contester une hausse des actes antisémites consécutive au 7 octobre 2023. Cependant, cet écart interroge sur la nature des actes qualifiés d’antisémites, dans un rapport faisant état d’un « antisémitisme d’atmosphère”, d’une « instrumentalisation du conflit israélo-palestinien« , « pour légitimer des discours et des actions antisémites, brouillant dangereusement les frontières entre critique politique légitime et discrimination« . Cette analyse prend clairement pour appui la définition de l’antisémitisme proposée par l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA), qui a, largement été considérée comme problématique eu égard aux exemples qu’elle inclut faisant lien avec la critique de l’État d’Israël. C’est cette même définition qui est recommandée par les sénateurs pour l’application de la loi relative à la lutte de l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur.
Adoptée le 26 mai 2016, la définition opérationnelle de l’antisémitisme de l’IHRA, dont la France est membre depuis 1999, s’est imposée au sein de l’Union européenne d’abord en faisant l’objet d’une résolution du Parlement européen le 1er juin 2017, puis d’une déclaration du Conseil de l’Union européenne le 6 décembre 2018.
La promotion de cette définition, pur instrument de droit souple, a abouti – non sans opposition – en France, à l’adoption de résolutions à l’Assemblée nationale (AN) en 2019 déposée par Sylvain Maillard, puis en 2021 au Sénat portée par Bruno Retailleau. Depuis lors, cette définition est utilisée “en tant qu’instrument d’orientation utile en matière d’éducation et de formation et afin de soutenir les autorités judiciaires et répressives dans les efforts qu’elles déploient pour détecter et poursuivre les attaques antisémites de manière plus efficiente et plus efficace”1.
Pourtant, lors des débats parlementaires à l’AN en 2019, plusieurs députés se sont vivement opposés à cette définition, laquelle n’a été votée qu’à 156 voix. La gauche, dont le PS, et plus des deux tiers des macronistes, avait voté contre ou s’étaient abstenus. La résolution s’appuyait sur un des exemples de la définition de l’IHRA, lequel permettrait de lutter contre l’antisémitisme dans “sa forme moderne et renouvelée, en ce qu’elle englobe les manifestations de haine à l’égard de l’État d’Israël justifiées par la seule perception de ce dernier comme collectivité juive”.
Sans jamais le dire clairement, l’association de l’État d’Israël à une collectivité juive crée une confusion entre antisémitisme et antisionisme, confusion qui a été renforcée par la loi fondamentale israélienne de 2018 définissant un “État-nation du peuple juif”. Or, “L’antisionisme est un point de vue légitime dans l’histoire juive, et à une longue tradition, y compris en Israël. Certains juifs s’opposent au sionisme pour des raisons religieuses, d’autres pour des raisons politiques ou culturelles.” précisait la tribune des 127 intellectuels juifs d’Israël et d’ailleurs publiée dans Le Monde le 2 décembre 2019.
Le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 25 février 2025 relatif à la dissolution du collectif Palestine vaincra, indiquait que « l’antisionisme militant du groupement ne le conduit pas à tenir lui-même des propos à caractère antisémite ». Le sionisme ne constitue pas un trait inhérent à un individu ou à un groupe, mais plutôt un courant politique ou religieux.
La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) s’était positionnée contre la transposition de la définition de l’IHRA en France dans son rapport de 2018 en dénonçant “l’amalgame entre le racisme et la critique légitime d’un État et de sa politique”, faisant écho à la frontière dressée par l’arrêt Garaudy contre France rendu par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) le 24 juin 2003.
Elle rappelait également les résultats d’une enquête montrant “la persistance de vieux préjugés antisémites (liant les juifs à l’argent, au pouvoir, leur reprochant leur communautarisme), et nuance la thèse d’un “nouvel antisémitisme” sui generis (polarisé autour d’Israël et du sionisme) chassant l’ancien.”2
Une autre critique visait la différenciation de la lutte contre l’antisémitisme des autres formes de racisme. En imposant une définition (contestée) de l’antisémitisme, une rupture est opérée avec le cadre juridique existant, composé des lois de 1881 sur la liberté de la presse, de 1972 sur la lutte contre le racisme, et de la loi Gayssot de 1990, lesquelles en sont exemptes. Bernard Fialaire assumait le 20 février 2025 devant la chambre haute donner “une place particulière à lutte contre l’antisémitisme”, induisant une forme de hiérarchisation des racismes. Il est frappant de constater, à cet égard, que les mesures législatives proposées concernent toutes les formes de discrimination, sans qu’à aucun moment lors les travaux préparatoires au texte, il n’en ait été question. Combattre l’antisémitisme sans s’attaquer avec la même force aux autres formes de discrimination n’est pas acceptable.
Dans un communiqué daté du 4 novembre 2023, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Türk, a vivement déploré la forte augmentation de la haine dans le monde, y compris en Europe, dans le cadre du « conflit israélo-palestinien », notamment depuis le 7 octobre. Tout en exprimant ses préoccupations quant aux restrictions injustifiées imposées à la liberté d’expression ainsi qu’aux manifestations liées à ce conflit, il mettait l’accent sur la montée de l’antisémitisme et de l’islamophobie.
Ces constats amènent la question du contexte dans lequel cette proposition de loi s’inscrit au parlement et de ses motivations cachées. Il est possible de considérer que les résolutions de 2019 et 2021, comme la présente proposition de loi, visent en réalité à protéger la politique coloniale et d’apartheid du régime israélien de toute critique, en assimilant tous les Juifs à cette politique et à ce régime, ce qui ne peut, in fine, que favoriser l’antisémitisme. Eric Coquerel résumait la situation en ces termes en 2019 : “Cette proposition de résolution a moins pour objectif de débusquer l’antisémitisme que de réaffirmer un soutien à un État étranger, au nom de la philosophie du choc des civilisations à laquelle adhèrent les États-Unis et le gouvernement israélien actuel.”.
Force est de constater que ce texte s’insère dans un contexte de génocide des Palestiniennes et des Palestiniens. Pour rappel, la Cour internationale de justice (CIJ) a affirmé, à plusieurs reprises par ordonnances, le risque de génocide. De nombreux rapports officiels pointent l’existence d’une politique génocidaire, dont le dernier rapport de Francesca Albanese du 1er octobre 2024 (A/79/384), rapporteuse spéciale des Nations unies pour les territoires palestiniens occupés. De même, plusieurs spécialistes des études sur les génocides se sont prononcés : Omer Bartov, historien juif israélien-américain, professeur d’Université aux États-Unis, spécialiste reconnu de la Seconde guerre mondiale et de la Shoah, ayant servi dans l’armée israélienne, considère qu’Israël commet bien un génocide à Gaza ; c’est également la position d’Amos Goldberg, historien israélien, spécialiste de la Shoah.
Plus encore, la CIJ a rendu son avis consultatif le 19 juillet 2024 affirmant que “les États sont dans l’obligation de ne pas reconnaître comme licite la situation découlant de la présence illicite de l’État d’Israël dans le Territoire palestinien occupé et de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation créée par la présence continue de l’État d’Israël dans le Territoire palestinien occupé.”
En outre, ses ordonnances de 2024 enjoignent les États parties à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide à tout mettre en œuvre pour prévenir les actes de génocide. Cette obligation pèse sur tous les organes de l’État. L’exécutif français, le pouvoir législatif de notre pays et celui de l’Union européenne, doivent donc faire en sorte de prévenir les actes à venir d’un génocide déjà en cours.
Or, c’est justement ce qu’exigent les étudiants et les personnels universitaires mobilisés contre la complicité de la France, notamment en demandant la rupture ou la suspension des partenariats des universités françaises avec les universités israéliennes et avec les entreprises complices de la politique israélienne actuelle à Gaza et dans le reste de la Palestine3.
Compte tenu de leur rôle social et de leurs responsabilités, les universités devraient dûment veiller à ce que leurs activités académiques et de recherche ne soient pas susceptibles d’avoir des impacts négatifs sur le respect des droits humains, à l’instar de ce que préconise les Principes directeurs des Nations Unies à l’égard des entreprises commerciales. En particulier, les universités doivent veiller à ne pas contribuer, même indirectement, à des violations du droit international telles qu’elles sont commises à grande échelle par Israël à Gaza et en Cisjordanie, dans le cadre de sa politique d’occupation et de colonisation. Les universités se doivent également de garantir la liberté d’expression de leurs étudiants et leur droit de participer à des actions militantes s’inscrivant dans un débat public d’intérêt général.
En réponse, le gouvernement a encouragé la répression de ces mouvements par l’intermédiaire des présidents d’universités, qui ont utilisé leur pouvoir de police pour réprimer les manifestations étudiantes contre le génocide à Gaza, expulser les étudiants y participant et multiplié les procédures disciplinaires, notamment au nom de la lutte contre l’antisémitisme. Si la proposition de loi est votée, les sections disciplinaires inter-établissements renforceront l’immixtion politique de l’exécutif dans le fonctionnement des universités.
Mettant en exergue une différence de traitement insupportable, plus de 500 scientifiques et personnels d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche ont rappelé, dans une tribune publié en février 2025, la rupture et la suspension des collaborations scientifiques du CNRS et de l’INRA avec la Russie une semaine après l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe en 2022.
Depuis plus d’un an et demi, les attaques contre la liberté d’expression dans le milieu universitaire et des libertés académiques sont massives : interdiction de réservation de salle, suspension de séminaires, exclusions d’étudiants, recours aux forces de l’ordre, menaces de suspension ou coupures de programmes de recherche, de financements de thèse, poursuites disciplinaires et judiciaires.
Y est attaqué “le droit de dire publiquement tout ce qu’exigent une recherche, un savoir et une pensée de la vérité« 4, pour emprunter les termes de Jacques Derrida. Pour ainsi dire, cette proposition de loi participe à la censure et à l’autocensure des productions académiques.
Cette analyse a déjà été établie en 2022 par la Rapporteuse spéciale de l’ONU sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, E. Tendayi Achiume. Dans son rapport annuel, elle considérait que cette définition [de l’IHRA] est « grandement instrumentalisée sur la base des onze “exemples contemporains d’antisémitisme” qui lui sont rattachés, dont sept concernent l’État d’Israël et que certains de ces exemples sont invoqués et exploités pour supprimer des droits humains et des libertés fondamentales, comme la liberté d’expression, de réunion et de participation politique, ainsi que les droits à l’égalité et à la non-discrimination« ; en conséquence, elle déconseillait son usage (§§ 71 à 79 du rapport).
Notons que le juriste américain Kenneth Stern, principal rédacteur du texte sur la définition de l’antisémitisme de l’IHRA, s’élève depuis plusieurs années contre le détournement de cette définition pour faire taire les propos critiques envers la politique du gouvernement israélien.
Dans le même sens, dans son rapport du mois d’août 2024 (doc A/79/319), la Rapporteuse spéciale de l’ONU sur la liberté d’expression, Irène Khan déplore la remise en question et les attaques à l’encontre de “la liberté académique des étudiants et des universitaires ainsi que l’autonomie des institutions” dans plusieurs pays occidentaux. Elle relève que ces atteintes emploient, de manière récurrente, des définitions contestées de l’antisémitisme, en particulier celle de l’IHRA. Parmi plusieurs critiques, elle souligne sa dangerosité eu égard aux “accusations injustifiées” auxquelles elle peut donner lieu, aux “atteintes à la réputation d’autrui” et au détournement de “l’attention de la lutte contre les causes réelles de l’antisémitisme”.
La rapporteuse des Nations Unis insiste, cette définition “ne comporte pas “l’élément d’incitation, nécessaire à l’interdiction de la parole” (…), les “exemples illustratifs” qui y sont rattachés traitent non seulement de l’impact du discours sur les personnes, mais aussi de l’impact sur l’État d’Israël, ce qui est contraire au droit international des droits humains et en particulier au droit à la liberté d’expression, qui autorise des critiques à l’égard de tous les États”. Autrement dit, cette définition est contraire au droit international.
Dès lors, cette proposition de loi apparaît comme une opportunité de museler encore davantage les discours relatifs à la Palestine au sein des universités, mais qui pourrait bien s’étendre, demain, à d’autres sujets. D’autres textes ont été déposés au parlement à l’automne 20245. Prenons pour exemples la proposition de loi de Caroline Yadan suggérant la création d’un délit de provocation à la destruction ou à la négation d’un État, ou celle de Stéphane Le Rudulier cherchant à protéger spécifiquement l’Etat d’Israël avec un délit dit de contestation antisioniste. Ces menaces comportent des risques graves pour la liberté d’expression, cœur d’une société démocratique.
L’abondante jurisprudence de la CEDH insiste de manière constante. La liberté d’expression doit être garantie, même s’il s’agit d’exprimer des opinions non consensuelles et qui dérangent. Cette liberté n’est toutefois pas absolue et l’interdiction de l’appel à la haine ou à la discrimination raciale en constituent des limites. Or, critiquer une politique gouvernementale au motif qu’elle viole des normes fondamentales de protection des individus et du peuple palestinien, ne devrait jamais être assimilé à une incitation à la haine.
Plus encore, la liberté d’expression doit être garantie de manière particulièrement renforcée lorsque l’expression en cause porte sur un débat d’intérêt général. La Cour de Strasbourg l’a rappelé à l’occasion du célèbre arrêt concernant le boycott des produits israéliens, portant sur un “sujet d’intérêt général, celui du respect du droit international public par l’État d’Israël et de la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés” (arrêt Baldassi et autres contre France, 11 juin 2020, § 78).
Le président de la CNCDH rappelait dans un courrier du 3 avril 2024, à l’attention du garde des sceaux de l’époque que d’une part, expliquer ou rendre compte du contexte d’un drame n’est pas l’approuver, et d’autre part, mis à part l’éloge d’actes terroristes, la liberté d’expression vaut pour les idées qui “heurtent, choquent ou inquiètent l’État ou une fraction quelconque de la population”.
Par-delà les libertés académiques, qui sont déjà lourdement affectées, les droits des Palestiniens, subissant une oppression systématique jusqu’au risque de la disparition, sont au cœur de ce propos. Mais pas uniquement : c’est la protection de toutes et tous, par le droit, ici et en Palestine, et celle de nos structures de savoir qui sont en jeu.
- Résolution adoptée le 3 décembre 2019 par l’AN visant à lutter contre l’antisémitisme (T.A. n°361)[⇧]
- Rapport sur la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie, par la CNCDH de 2018, page 25.[⇧]
- https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/186/186-20240719-adv-01-00-frc.pdf[⇧]
- Jacques Derrida, L’université sans condition, Galilée, Paris, 2001[⇧]
- Sont également en déposés au parlement : une proposition de loi pour consacrer la lutte contre l’antisémitisme, déposée au Sénat le 1er octobre 2024 par Stéphane LE RUDULIER, qui vise, en son article 5, à créer un délit dit de contestation antisioniste ; une proposition de loi visant à lutter contre les formes renouvelées de l’antisémitisme, déposée le 19 novembre 2024 par Caroline YADAN, qui vise notamment à créer un délit de provocation à la destruction ou à la négation d’un État ou de faire publiquement l’apologie de sa destruction ou de sa négation et une proposition de résolution européenne visant à une coopération européenne renforcée contre l’antisémitisme et la haine anti-juive, enregistrée à la présidence de l’AN le 25 février 2025.[⇧]