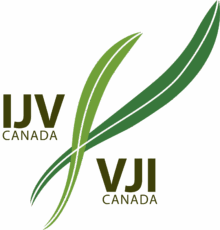Paru sur le site lundimatin, le 11 février 2019
À propos de Réflexions sur la question antisémite de Delphine Horvilleur
A la fin de son dernier livre, Réflexions sur la question antisémite (Grasset 2019), Delphine Horvilleur appelle les Juifs qui la lisent – « de rappeler constamment la faille constitutive, celle qu’ils ont su incarner à travers l’Histoire et qui, seule, peut assurer un barrage contre le totalitarisme mais aussi garantir la persévérance juive ». La réception médiatique du livre, élogieuse et sans la moindre critique sérieuse, a pourtant renforcé l’effet totalisant de la vision qu’il propose de l’histoire juive et de la réalité contemporaine. Cela devrait intriguer son auteur.
La contradiction apparaît aussi au niveau du contenu. Selon Horvilleur, la cause de l’antisémitisme est la menace que ressent l’antisémite face à la dimension dé-totalisante du Juif. Dans les mots de Jean Claude Milner qu’elle cite : « par leurs rites et leurs coutumes, les Juifs empêchent qu’on puisse traiter, de manière consistante, de tous les hommes. Ils rendent impossible l’emploi de l’opérateur tout, quand il s’agit des êtres humains. Alors qu’ils vivent au cœur de l’oikoumené (la terre habitée), ils fragmentent l’humanité. ». Mais ce qui pourrait se lire comme une position problématique chez Milner devient chez Horvilleur la base d’une vision normative de la société.
Ceux qui haïssent les Juifs, le feraient donc parce qu’ils refuseraient de reconnaître la faille inhérente dans leur propre identité… La haine des Juifs serait toujours « porteur extérieur de la coupure qu’on refuse de voir en soi ; Pas besoin d’être juif pour vivre avec le manque. Mais difficile de ne pas être antisémite quand on veut vivre à tout prix sans vide et sans béance ». La structure se repère donc assez facilement – d’un côté les Juifs et leurs semblables, ceux qui ont appris à vivre avec le manque et dans l’incomplétude, de l’autre côté tous les autres. Dans la vision de la société contemporaine défendue par Horvilleur, qu’elle explicite notamment au dernier chapitre de l’ouvrage, les Juifs et leurs semblables occupent la place d’un centre imaginaire dépolitisé, qui ne fait du mal à personne, avec comme haïsseurs perpétuels les radicaux – de gauche et de droite. Dans la mesure où le phénomène antisémite est réel, et où le livre, sous prétexte d’en parler, le mobilise pour renforcer une vision de la société que je ne partage pas en se basant sur la tradition biblique et talmudique, il m’a paru nécessaire de le lire en juif, au sens où Horvilleur l’entend, c’est-à-dire – en introduisant la faille dans sa vision totalisante de l’histoire juive.
Les failles ont souvent comme symptômes les erreurs, et la première qui m’a sauté aux yeux concerne l’apparition du nom « Juif » dans la Bible. Horvilleur écrit à juste titre que pendant la plus grande partie du récit biblique il n’est pas question des « Juifs » mais des « Hébreux » et du « peuple d’Israël », mais elle a tort lorsqu’elle affirme que la première fois où le nom « Juif » (yehoudi) apparaît dans la Bible est dans le livre d’Esther. A la base de cette erreur elle arrive à présenter l’antisémite comme le pendant perpétuel du Juif : « l’antisémitisme surgit dans la Bible dès que le Juif apparaît ; il semble sorti d’une même matrice ou d’un même verset ».
En réalité, le nom Juif apparaît un peu plus tôt dans la Bible, dans le deuxième livre des Rois. Les « Juifs » (yehoudim) en question sont les habitants d’une colonie judéenne à Eilat, établie par le roi Amatzia de Jérusalem au début du huitième siècle avant notre ère. Le narrateur du livre des Rois les évoque pour dire qu’ils ont été expulsés d’Eilat par le roi d’Aram. On ne sait pas ce qu’ils sont devenus. L’événement est censé avoir lieu au moins deux siècles avant l’histoire d’Esther.
On pourrait lier cet oubli, volontaire ou inconscient, à une caractéristique plus générale du livre qui consiste en l’évacuation de toute problématique liée aux rapports de domination. Ce n’est pas que ces rapports ne soient pas mentionnés. Horvilleur parle des oppresseurs et des opprimées, mais elle ne problématise pas ces catégories. Dans son discours, les Juifs ne peuvent occuper une autre place que celle des dominés. Ramener à la surface les occurrences du nom Juif dans le livre des Rois et dans Jérémie l’obligerait à revenir sur ce présupposé.
Malgré sa critique de la pensée décoloniale, Horvilleur partage avec elle le même point de départ – le mal politique dans la société a toujours comme cause l’Empire. Pour établir que cette idée est juive elle cite plusieurs textes talmudiques qui mettent en scène le rapport des Juifs à l’Empire romain. Elle offre notamment une belle analyse d’un dialogue talmudique entre un empereur romain qui haïssait les Juifs et voulait les exterminer et un certain Qeti‘a bar Shalom (un nom symbolique qui veut dire en hébreu « coupure fils de paix »). Pour Horvilleur, la figure talmudique de Qeti’a représente le rôle des Juifs dans l’Histoire – faire barrage à chaque tentative d’expansion impériale et, par extension, à toutes sortes d’intégrisme. « L’antisémite à travers les siècles est toujours un intégriste de l’intégrité », écrit-elle. Mais pour que l’association entre l’empereur romain dont parle le Talmud ans et les intégristes d’aujourd’hui passe sans faire scandale, elle doit laisser de côté une bonne partie de l’histoire.
Horvilleur ne raconte pas à ses lecteurs que la grande révolte contre les Romains qu’ont mené les Juifs palestiniens entre 66 et 73, eut comme conséquence non seulement la destruction du Temple, mais aussi la détérioration du statut symbolique, politique et économique des Juifs dans l’ordre impérial. Leur défaite (comme celles d’autres provinces rebelles) fut affichée à Rome (la porte de Titus) et à travers l’Empire (la pièce de monnaie décrivant en image et en texte la Judée capturée). Tout cela a stigmatisé les Juifs comme semeurs de troubles, et la réalité a donné à ce préjugé de quoi se nourrir – pendant les cinquante années suivant la destruction de leur Temple en 70, des Juifs ont mené deux autres révoltes contre l’Empire.
Contrairement à l’image qu’elle donne dans ce livre, la résistance des Juifs à l’ordre impérial n’était pas seulement symbolique. Les Juifs ont pris des armes car ils trouvaient l’ordre impérial injuste. Ils se sentaient exploités, humiliés. Ils ont réclamé du pouvoir, et essayé de se l’approprier par la violence.
L’image irénique que ce livre transmet du mouvement rabbinique est également fausse. Ce mouvement profite de la conjoncture politique du tournant du troisième siècle pour se consolider grâce à l’appui du pouvoir romain. Rabbi Yehoudah dit le Prince, l’éditeur de la Mishnah, n’était pas « un petit enseignant » d’une province déserte et démunie, mais un Juif aisé d’une ville moyenne de la Galilée romaine. L’archéologue israélien Zeev Weiss a même suggérée qu’une somptueuse Villa du site archéologique de Sepphoris était sa demeure. Par ailleurs, on n’édite pas une encyclopédie du savoir rabbinique en étant « un petit enseignant ». Il faut avoir du pouvoir et des ressources, et dans la réalité historique de la Palestine du troisième siècle cela nécessite des liens étroits avec l’ordre impérial. Il est donc tout à fait possible qu’il se soit entretenu avec un dirigeant romain, comme le racontent plusieurs rabbins cités dans le Talmud.
Mais Horvilleur efface la réalité historique portée par la parole rabbinique, et pose la question rhétorique : « imagine-t-on un dirigeant de l’Empire développer une telle intimité avec un petit enseignant juif ? ». Elle est déterminée à répondre par la négative et enferme Rabbi Yehoudah dans une impuissance imaginaire face à l’Empire. En le faisant elle passe à côté d’une faille constitutive qui donne au judaïsme rabbinique sa forme unique dans l’histoire.
Le génie des rabbins de l’Antiquité fut de savoir créer, à l’intérieur de la place limitée accordée aux Juifs par l’Empire, une autre forme d’ordre politique où le souverain de facto était un tribunal appliquant la Loi de la Torah. En développant leur système, les rabbins contribuaient à leur manière au maintien de la paix impériale. Le fait qu’ils n’aient pas participé à la résistance armée contre l’Empire ne veut pas dire qu’ils rejetaient complètement la violence physique, économique, symbolique ; ils l’ont tout simplement tournée vers l’intérieur de la société juive en s’en attribuant le monopole. La parole rabbinique a pu traverser l’histoire avant d’atterrir sous la plume d’Horvilleur parce que les rabbins étaient capables de participer à deux missions distinctes : assurer la paix impériale au sein de la société juive tout en accomplissant, à l’intérieur de cette société, la volonté du souverain divin. S’ils ont réussi c’est précisément parce qu’ils ne partageaient pas la posture apolitique qu’on leur attribue d’habitude.
La parole rabbinique de l’Antiquité se prononce depuis la place où un dieu et un roi négocient la domination d’un peuple. Le mouvement entre les deux formes de souveraineté – la Torah et l’Empire – est ce qui a donné au judaïsme sa consistance historique jusqu’à la fin du dix-neuvième siècle et l’avènement du sionisme politique. Le sionisme a rejeté le mouvement rabbinique en s’inscrivant pleinement dans l’ordre impérial où il a cherché sa réalisation. Horvilleur fait la même chose, et cela malgré le fait qu’elle se réclame des rabbins de l’époque talmudique, ceux dont le discours instaure ce mouvement et l’entretient.
Réactiver le mouvement théologico-politique de la parole rabbinique pourrait provoquer un changement réel dans l’ordre du présent, une perspective que Horvilleur semble vouloir éviter. Elle réduit les conflits politiques à des questions identitaires et symboliques. Ses lectures talmudiques sont censées adoucir les lecteurs avant qu’ils arrivent au dernier chapitre qui parle du présent. En effet, après avoir dépolitisé l’histoire juive dans les chapitres précédents, Horvilleur peut désormais présenter la complicité d’Israël avec les forces impériales comme le délire des intégristes. L’État d’Israël serait la victime innocente d’une haine démesurée qui n’a rien à voir avec ses actes violents comme force occupante du peuple palestinien. Ceux qui attaquent les sionistes ne le feraient pas pour la cause palestinienne, mais à cause de la haine des Juifs. Ceux qui disent qu’Israël instrumentalise la Shoah seraient également dans le délire antisémite. « La question antisémite » devient ainsi un principe organisateur de l’Histoire qui normalise les rapports de domination et justifie les injustices.
Ron Naiweld est chargé de recherche au CNRS