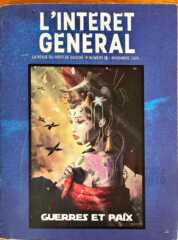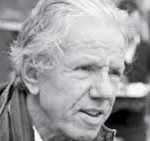Michèle Sibony – 20 Octobre 2013
Comme tout être humain les Palestiniens ont le droit d’accès à la terre et à un abri. Pourtant un jeune couple arabe, citoyen d’Israël et de la ville, qui veut acquérir un appartement rencontre de nombreux problèmes (Boutheina Dabeet).
Pour rejoindre Ramle petite ville du centre du pays, nous avons pris un bus de Jérusalem qui traverse ce que l’on aurait appelé ici la France profonde, c’est à dire une périphérie faite de moshavim (fermes coopératives) souvent religieux, de bases militaires et d’écoles religieuses. C’est tout de même un choc le bus est chargé à 90 % de religieux-ses ou de soldat-es, voire les deux mon général, soldats à kippa. J’essaye de photographier discrètement le plus proche de moi, sans succès, tans l’image de ce jeune homme en uniforme penché sur son livre de prière, fusil calé entre les genoux me frappe: « Le glaive et le goupillon » vieille histoire.
Dès que nous sommes sorties de la station centrale, ce matin ensoleillé d’octobre, Alessandra (ma coéquipière militante syndicaliste italienne), et moi-même avons été saisies et emportées par l’intensité de l’atmosphère. C’était presque euphorisant cette rue principale commerçante bariolée, multicolore et multi ethnique, bordée de petits immeubles bas des années cinquante et de maisons arabes expropriées de 1948. On est dans une petite ville pauvre, cela se voit à l’œil nu, mais riche de ses habitants, indiens, éthiopiens russes, palestiniens, irakiens, du Maghreb, tous les vêtements sont différents, les têtes couvertes ou non de multiples coiffes, de la kippa au bonnet tricoté, au foulard, multiples longueurs des jupes , cafés orientaux, et occidentaux, restaurants indiens, shawarma, voisinent en microcosme dense. Des passants curieux et proches, qui regardent l’œil de l’appareil photo chaque fois que je vise. De cette rue principale partent plusieurs perpendiculaires vers un quartier qui a l’air abîmé mais très beau, « la vieille ville » où l’on aperçoit une très ancienne mosquée.
C’est Boutheina Dabeet, une grande femme brune au regard souriant et énergique, qui nous reçoit dans son cabinet d’architecte, elle est native de Ramle et après y avoir milité des années avec Shatil tout en étant par tradition familiale affiliée au parti Hadash, elle est numéro 3 de la liste municipale, elle a repris ses activités professionnelles et son premier projet de retour à Ramleh a été nous dit-elle fièrement la construction de la synagogue tunisienne.
Elle a avant cela dirigé pendant dix ans le projet « villes mixtes » avec Shatil [note]<*>Shatil : The New Israel Fund’s Initiative for Social Change, ONG créée en 1982 qui travaille au renforcement de la société civile à promouvoir la démocratie la justice sociale et une société israélienne partagée. Elle offre de nombreux services sociaux juridiques et de formation chaque année à plus de mille associations de terrain et construit des coalitions et réseaux pour les populations désavantagées: nouveaux immigrants palestiniens israéliens, et résidents de villes de développement]] qui concerne principalement les quatre villes de Lod Ramle Akko (Akka en arabe St Jean d’Acre) et Jaffa (Yafo en hébreu). Elle travaille sur les liens étroits entre la planification urbaine de ces villes et le sort des populations palestiniennes qui y vivent encore.
A l’aide de son power point elle articule en permanence images et plans au statut des populations. Mais elle commence par reprendre quelques mythes: tout le monde parle de villages s’agissant de la Palestine d’avant 48, deux cartes: une vue d’avion de Lod en 1949 qui montre une ville plutôt grande au bâti compact, et une vue similaire datée de 1965 qui montre des champs : la ville a été rasée.
À Jaffa 3200 bâtiments ont été détruits, à Ramle il n’est resté que 15 % du bâti de la ville. Elle évalue à 20 000 la population palestinienne qui vit aujourd’hui dans ces villes dites mixtes. En 1948 sur 17 000 personnes 900 sont restées. Sur les 40 000 habitants de Lod, 700 sont restés. A l’époque l’Agence Juive a relogé dans les maisons restantes les émigrés, en déplaçant de force les habitants palestiniens vers d’autres quartiers de la ville, comme ce fut le cas dans sa propre famille pour son grand-père.
C’est ainsi que la plupart des Palestiniens de Ramle furent regroupés dans ce qui restait du quartier palestinien resté debout au centre de la ville et appelé officiellement par tous « le ghetto ». La même procédure et la même dénomination furent adoptées à Lod.
Comme tout être humain les Palestiniens ont le droit d’accès à la terre et à un abri, rappelle Boutheina. Pourtant un jeune couple arabe , citoyen d’Israël et de la ville, qui veut acquérir un appartement rencontre de nombreux problèmes.
Par exemple les projets de nouveaux quartiers prévoient des critères de candidature comme « avoir fait » l’armée , ou être religieux (juif) ce qui les exclut d’office.
Nous repartons en 1948: déjà avant 48 la plupart des maisons de Ramle étaient considérées comme illégales à cause des expansions nécessaires construites sans autorisation , et depuis toutes sont considérées comme non reconnues. C’est ainsi, à cause des expansions construites pour loger la famille que les Dabeet ont reçu un ordre d’éviction sur leur maison de 1949 et ont dû payer un coûteux procès pour qu’elle ne soit pas détruite.
Elle cite aussi le cas d’une famille chassée du Nord en Israël, réfugiée à Safed (autre ville du nord) puis chassée à nouveau elle s’installe à Lod, et qui a vécu deux fois la destruction de sa maison.
Il faut comprendre que nous vivons des expulsions et démolitions en permanence ; elle nous montre des images de 2010 véritables scènes de guerre : 6 maisons détruites au bulldozer. Dans ces situations si l’on peut dire que la presse locale est présente, au moment des démolitions, les média nationaux sont absents. Sur 7 autres maisons promises à destruction il y a trois ans on a gagné par contre. J’ai vu de mes yeux et participé aux batailles contre la démolition de plus de 200 maisons. A Jaffa sur 500 ordres d’évacuation de maisons 497 sont encore actifs.
A Lod on a ressorti pour empêcher la population de se mobiliser contre les destructions, une loi datant du droit ottoman qui interdit un rassemblement de plus de trois personnes. L’implication des femmes dans ces batailles pour sauver la maison est particulièrement forte. Lors de la révolte des tentes en août 2011 dont l’une des principales revendications portait sur le logement nous avons été très présents.
Puis elle nous montre la carte d’un quartier en cours de planification (c’est à dire de restructuration : on y distingue par couleurs les terres agricoles non constructibles, une zone industrielle, un cimetière , la zone où vivent les familles palestiniennes du quartier, entre les terres agricoles et le cimetière, puis elle nous montre le plan de la restructuration, avec ses nouveaux quartiers et nous dit : ce sont les terres d’ Abu Tok , un quartier entier considéré comme invisible, et traité comme s’il était vide.
Boutheina traduit aussi sa lassitude devant ce combat de Sisyphe : devant l’image d’une manifestation devant le tribunal elle soupire : çà c’était des manifs tous les mardis pendant les deux ans d’un procès qui s’est achevé par un échec en 2011. Mais elle enchaîne, vous savez ce ne sont pas forcément des maisons que cette lutte permet de reconstruire, elle nous permet de nous construire nous même.
Nos villes de Ramle et Lod souffrent d’ une société civile très affaiblie. En réalité ce sont des villes pauvres et l’évolution sociologique montre que dès que des gens accèdent à un niveau social suffisant ils les quittent. La violence, la drogue et la délinquance des jeunes y sont monnaie courante. La planification se méfie des arabes vécus comme des ennemis de l’intérieur , ainsi elle organise des «zones glacis ou tampons» autour de leurs quartiers. Au sud de Lod par exemple une décision vient d’être prise de créer 3000 unités d’habitations réservées à des familles juives orthodoxes. Au nord, ce sont 500 unités réservées à la police et l’armée. Et même on construit des murs à Lod pour séparer les quartiers juifs des quartiers arabes, à Ramle aussi. En fait de mixité c’est une totale séparation qui s’organise sur base ethnique , les quartiers palestiniens sont 100 % palestiniens. L’argument électoral du maire sortant énoncé publiquement à Ramle est «je suis le maire qui a détruit le plus de maisons arabes dans la ville.»
Ce briefing terminé elle nous emmène en visite dans le ghetto, mais avant elle nous fait découvrir un lieu surprenant très ancien, une réserve d’eau souterraine au cœur de la ville qui servait puisque la ville n’a pas de sources, à alimenter les troupeaux, très joli site souterrain voûté où les touristes israéliens accèdent à des barques pour parcourir les 50m2 de la réserve, un peu ridicules entassés sur leurs barques, effet Disney land . Mais elle attire plutôt notre attention à l’extérieur, sur la proximité anormales des constructions nouvelles réservées aux orthodoxes, qui touchent littéralement le site historique.
Nous visitons ensuite le ghetto très délabré où règne au mieux la grande pauvreté au pire l’abandon, les noms des rues cependant y marquent le triomphe du sionisme ; rues Trumpeldor, Hashomer (la Garde) ha’gdoud ha’ivri (le bataillon hébreu) Balfour ….
Elle nous raconte la bataille des noms des rues: menée devant les tribunaux pour pouvoir redonner aux rues du ghetto des noms arabes. Une bataille qui a valu aux arabes de Ramle des insultes publiques du maire, mais le procès a été gagné et deux noms ont été généreusement accordés : Emile Habibi, l’écrivain palestinien de Haïfa et Sulayman Ibn Adbel Malik gouverneur de Palestine et fondateur de la ville, capitale du nouvel Islam en 716. Une des plus vieilles mosquées du monde se trouve encore dans la vieille ville. De vastes places poussiéreuses bordées de ces maisons, trop vastes sont les espaces laissés par la destruction de la ville. Notre balade passe par un atelier restauré par un artiste de Ramle, par l’entrée du dos de l’église où le Père franciscain Juliano offrit refuge aux palestiniens qui se cachaient pendant l’opération « Dani » en 48 , alors que tous devaient se rassembler sur la place pour l’exode.
Enfin fatiguées et poussiéreuses, nous nous affalons dans le restaurant palestinien du ghetto, où l’oncle de Boutheina nous sert le meilleur taboulé dégusté depuis longtemps. Son restaurant est lui aussi conçu comme une mémoire vivante de l’histoire de la ville.
Le charme de la ville, de son marché animé continue d’agir jusqu’à notre retour. Pourtant après notre visite du Neguev de la veille, et celle d’aujourd’hui, c’est un sentiment d’anxiété qui persiste. Il y avait bien au fond du regard ferme et souriant de Boutheina la lutteuse, un voile de lassitude devant l’ étau qui enferme dans le quartier, la ville, le pays, les Palestiniens inexorablement. Lassitude devant la violence brutale du racisme et de l’apartheid qui s’impose, lassitude d’une lutte permanente pour respirer, même à l’intérieur.
Ramle, cette jolie petite ville pleine d’humanité vivante et multicolore, dotée d’un magnifique potentiel de coexistence et de développement , a encore le goût amer d’un fruit de l’apartheid.