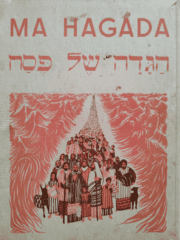Alors que le président Milei s’apprête à recevoir Benyamin Netanyahou en septembre en Argentine, des intellectuels, syndicats et partis politiques accusent Milei de « complicité avec la barbarie ». Face a l’impuissance de voir un génocide en temps réel à Gaza, Marcela Perelman analyse dans l’article traduit de la Revista Crisis, ce que signifie être juif argentin après la destruction de Gaza.
Tout semble impuissant à freiner le génocide télévisé dont nous sommes contemporains. Cependant, il est indispensable d’y réfléchir. L’auteure de cet article se demande ce que signifie être juif argentin après la destruction de Gaza, et dans sa quête de réponse, elle propose de relire d’un œil critique tant le projet sioniste que l’impérialisme européen qui l’a soutenu. (Revista Crisis)
« Shoyn es basta »
« La confusion entre ce qui est juif et ce qui est israélien découle de la confusion entre l’État, le gouvernement et le peuple. Il est tentant de résoudre le problème en séparant ainsi les choses, comme pour clarifier un malentendu, mais cela n’est plus possible. C’est tentant parce que cela permet de faire porter toute la responsabilité au gouvernement d’extrême droite d’Israël, aleph de la fascisation de l’Occident. Ce n’est pas faux, mais ce n’est qu’une explication conjoncturelle. L’israélien est traversé par le juif parce que c’est l’essence même du projet de l’État qui a placé l’étoile de David au centre de son drapeau. Ce mode fondateur de nationalisme étatique a des implications et des conséquences : il n’a pas déterminé le projet d’extermination actuel, mais il contenait des conditions structurelles qui auraient nécessité des remises en question très profondes et des mouvements sociaux très forts pour que la réalité soit autre.
D’un côté, l’amalgame entre judaïsme et israélisme est utilisé pour exiger des Juifs qu’ils s’expliquent sur les actions d’Israël ou pour mettre en doute notre capacité à critiquer et à dénoncer. De l’autre, cela revient à faire passer les critiques envers Israël pour des actes d’antisémitisme, allant même jusqu’à la criminalisation. Pour les inconditionnels d’Israël, il n’y a pas de différence entre judaïsme, sionisme et israélisme. Pour les antisémites non plus. Pour les autres, pour nous, de vieilles et de nouvelles questions se posent. Même si nous n’avons rien à voir avec les décisions politiques et militaires d’Israël, depuis que le judaïsme et le sionisme sont liés dans le territoire disputé du Moyen-Orient, ce lien déborde sur les modes d’être juif dans le monde entier.
La question revient : qu’est-ce que cela signifiait d’être juif en Europe pendant 18 siècles de marginalisation sociale et politique ? Qu’est-ce que cela signifiait d’être juif au XIXe siècle, lorsqu’ils se sont étendus à la vie publique, ont écrit les livres qui nous ont le plus formés et se sont heurtés aux nationalismes ? Qu’est-ce que cela signifiait d’être juif dans la zone d’exclusion du tsarisme, dans la terreur d’un pogrom ? Qu’est-ce que cela signifiait d’être juif dans les ghettos, de voir les meurtres et d’être assassiné ? Que signifiait devenir survivant ? En Argentine : être juif pendant le pogrom de 1919, en 1942 avec la solution finale, en 1948 avec la création de l’État d’Israël, en 1967 avec la guerre des Six Jours. Que signifiait être un militant juif dans les années 70, être juif sous la torture ? Qu’est-ce qui a changé avec l’attentat à la bombe contre l’ambassade d’Israël et l’attentat contre l’AMIA ? Et maintenant, c’est à notre tour, cela nous est imposé, certains d’entre nous en perdent le sommeil : que signifie être juif argentin après la destruction de Gaza ?
Le massacre vu depuis Buenos Aires
Que signifiait pour les Juifs argentins le massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre 2023 ? Ces jours-là ont ravivé et actualisé des expériences : la peur et l’horreur, les appels téléphoniques, l’attente. Recevoir les pires nouvelles avec la certitude que les représailles seraient infinies, que tout irait de mal en pis. Un changement subjectif s’est opéré en moi : l’image constante d’avancer vers un point de non-retour personnel.
Beaucoup (la majorité ? les plus visibles ?) ont renforcé le lien entre leur identité juive et leur soutien à Israël, réaffirmant une forme d’adhésion inconditionnelle. La mémoire de la victimisation s’est réveillée. Ils insistent sur le fait que l’existence d’Israël est menacée et que, par conséquent, tout ce qui a été fait est présenté comme une défense légitime et l’inconditionnalité comme la seule réponse logique. Ils considèrent les critiques comme des formes d’antisémitisme, au point d’accuser d’autres Juifs d’antisémitisme. Ce n’est pas le cas partout. Alors qu’ici, la revendication pour les otages — dont beaucoup sont argentins — est surtout soutenue par ceux qui justifient l’action militaire à Gaza, dans d’autres pays et en Israël, les manifestations qui exigent leur libération se situent dans un camp clairement opposé et exigent le cessez-le-feu.
Le silence de certains camarades et collègues concernant l’attentat, même si beaucoup d’entre nous avaient des amis ou des proches impliqués, était parfois blessant. Dans certains milieux, le 7 octobre est devenu un tabou, que certains juifs progressistes vivent comme une solitude politico-affective. Dans d’autres espaces, petit à petit, nous avons des conversations non seulement nécessaires pour nous positionner sur le Moyen-Orient, mais aussi décisives pour recréer notre champ politique local.
L’approche binaire qui consiste à condamner exclusivement les uns ou les autres annule toute forme d’implication dans l’histoire, les causes, les rationalités, les conséquences et les possibilités. Elle les qualifie de relativistes et de « deux-démonistes ». Oser comparer des événements historiques est un autre péché.
La destruction de Gaza représente une double perturbation pour ma subjectivité juive. La première, pour des raisons évidentes : un génocide est actuellement perpétré au nom des Juifs — en mon nom, d’une certaine manière. La seconde concerne le passé : plus je lis, plus je confirme que l’enseignement de l’histoire juive que j’ai reçu est chargé de distorsions et d’omissions. Cela est dû au récit institutionnel sur la création de l’État d’Israël, qui contient une série de mythes fondateurs. Certains ont déjà été réfutés par une historiographie israélienne critique qui, à quelques exceptions près, n’a pas atteint les écoles argentines.
Le sionisme comme conscience de soi
Bien avant le mouvement sioniste qui a conduit à la création d’un État juif, pendant près de deux mille ans, les Juifs d’Europe croyaient qu’ils vivaient en exil, dispersés à travers le monde après la destruction du deuxième temple de Jérusalem, et que le retour à Sion se réaliserait par décision divine à un moment donné. Ces idées relevaient de la foi et non de l’action humaine. Elles sont restées une puissance purement symbolique pendant 18 siècles, jusqu’à ce qu’entre le XIXe et le début du XXe siècle, elles se développent pour devenir un programme politique réalisable, puis réel.
La sécularisation de l’idée de retour et sa politisation ont germé dans les transformations des XVIIIe et XIXe siècles, qui ont constitué une « révolution française » pour les Juifs d’Europe. Jusqu’alors, être juif n’était qu’une définition religieuse qui impliquait d’être un citoyen de seconde zone. Ce statut s’est transformé avec une intégration accélérée dans la vie publique. Les Juifs éclairés ont commencé à s’interroger sur leur identité davantage en termes de nationalité que de religion. Ils ont sorti l’hébreu des synagogues et l’ont introduit dans la littérature et le journalisme. Ils se sont rapidement heurtés aux nouveaux nationalismes, qui les rejetaient et les conduiraient à l’extermination. Telles sont les traces du sionisme nationaliste : non pas la religion, mais la politisation de l’inégalité civile et la conscience de vivre sous la menace.
C’est dans ce contexte qu’apparaissent les premiers penseurs du sionisme qui cherchaient à résoudre « la question juive » alors qu’ils vivaient en Europe sous la menace. Il existait différents sionismes : marxiste, culturel, spirituel, politique. Pour les sionistes politiques, la solution consistait à mettre en œuvre l’ancienne idée religieuse du retour à Sion, sur le territoire appelé Palestine, habité par un demi-million de personnes. Ils ignoraient ou voulaient ignorer que la Palestine était également secouée par les nationalismes. En 1891, un sioniste culturel, qui ne croyait pas à la création d’un État juif, Ahad Ha’am, écrivait : « Oublions-nous souvent qu’un peuple entier vit là-bas, qui ne songe pas à quitter son lieu de vie ? ». Ha’am avertit les sionistes politiques que la population palestinienne méritait respect et justice, et que tout comportement méprisant ou violent engendrerait une hostilité réciproque sans fin.
D’autres Juifs européens imaginèrent une utopie juive socialiste : depuis le BUND, l’Union générale des travailleurs juifs, ils défendaient l’idée d’une nation juive fondée sur la culture et la langue yiddish. Être une nation sans territoire pouvait être un idéal et non une condamnation. En tant qu’internationalistes, ils pensaient à la lutte pour l’égalité et la justice sociale dans les pays où ils vivaient : « Où que nous vivions, c’est là notre patrie » (cela sonne mieux en yiddish : Vu mir lebn, dort iz undzer land). J’aime à penser que la manière dont les Juifs s’intègrent ici suit cet esprit : Argentina iz undzer land (Argentine es notre pays).
Solutions européennes
Entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, l’Europe a déplacé les Juifs en leur retirant de plus en plus de droits et en les excluant dans une zone assiégée par les pogroms. Dans ce contexte invivable, la grande majorité de ceux qui ont quitté l’Europe sont venus en Amérique. Très peu de pionniers se sont aventurés en Palestine, où de violents affrontements ont eu lieu.
Dans le monde arabe, la violence européenne se déployait comme une cruauté impérialiste. La Grande-Bretagne gouvernait la Palestine depuis 1917, date à laquelle elle a approuvé la déclaration du Premier ministre Arthur Balfour en faveur de la création d’un « foyer national pour le peuple juif » sur ce territoire. Les positions de ce soi-disant ami des Juifs étaient ouvertement antisémites : les Juifs auraient un endroit où vivre « entre eux », l’Europe pourrait « se débarrasser d’un corps étranger, voire hostile », et cela « atténuerait les misères séculaires créées par la question juive pour la civilisation occidentale ». Balfour est à l’origine d’une série de paradoxes qui ont encore des répercussions aujourd’hui : la convergence des intérêts entre l’antisémitisme occidental (européen, britannique, américain) et le sionisme, car tous deux considéraient que l’Europe n’était pas le lieu où les Juifs devaient vivre.
Avant que le projet de « retour à Sion » ne voie le jour, la Seconde Guerre mondiale éclata et l’extermination nazie commença. Après l’Holocauste, aucun pays européen n’accueillit les Juifs « restants » ou survivants. Fuir était une question de vie ou de mort et la destination n’était pas un choix libre. Avoir son propre territoire s’imposa finalement comme un impératif existentiel. L’Ancien Testament a été réinterprété comme un document historique démontrant que la Palestine était la terre ancestrale. L’après-guerre a ouvert la voie multilatérale à la concrétisation du sionisme politique : un État juif au cœur du Moyen-Orient, à l’instar des autres États souverains. Hors d’Europe et avec la force nécessaire.
Après avoir béni le foyer juif au Moyen-Orient, les Britanniques ont cruellement restreint les quotas d’entrée. Face à cela, les militants sionistes ont organisé des bateaux clandestins pour fuir l’Europe en traversant la Méditerranée. C’est là l’épopée fondatrice qui fait qu’Israël est considéré comme un refuge pour les Juifs. Cette fuite s’est transformée en un « droit au retour » pour tous les Juifs du monde : en Occident, elle a représenté une énorme réparation et la principale garantie que le génocide ne se reproduirait pas. Le récit de cette épopée a omis et continue de nier qu’un peuple habitait ce territoire. Chacun des termes de la formule sioniste « une terre sans peuple pour un peuple sans terre » recèle des dissimulations : que les Juifs avaient bel et bien des terres en Europe, qui leur ont été refusées, et qu’il y avait bien un peuple sur le territoire palestinien, qui a été nié. Dès leur arrivée en Palestine, le monde arabe a été identifié comme la nouvelle menace, ce qui s’est traduit par une nazification croissante de l’image des Arabes, qui perdure encore aujourd’hui.
L’Europe est responsable non seulement de l’extermination, mais aussi de la spoliation et du déplacement forcé des Juifs. Si l’on considère que l’enracinement de nombreux Juifs en Palestine s’est concrétisé par l’expulsion et le transfert forcé de ceux qui vivaient sur le territoire où Israël a été créé, on constate que dans la chaîne des déplacements et des exterminations, l’Europe ne peut être mise à l’écart. Amos Oz a décrit le conflit comme une lutte entre deux populations victimes de la violence européenne : les Arabes, exploités par l’impérialisme, et les Juifs, persécutés et assassinés.
En 1947, les Nations unies ont approuvé un plan visant à diviser le territoire palestinien en deux États, l’un juif et l’autre arabo-palestinien, avec Jérusalem sous administration internationale. Elle l’a fait avec le soutien des grandes puissances (tant les États-Unis que l’Union soviétique), sans la participation de la population arabe vivant en Palestine et avec le rejet des pays arabes et musulmans. L’Argentine du premier gouvernement Perón s’est abstenue, mais a reconnu Israël un an plus tard.
Comme beaucoup l’avaient prédit, une guerre éclata. Il y eut des massacres, des sièges et des batailles terribles entre les deux populations. C’est pendant cette guerre qu’a commencé le drame des réfugiés palestiniens, qui n’ont jamais pu retourner chez eux. La Grande-Bretagne a annoncé son retrait, comme l’a dit Rodolfo Walsh : « Elle avait accompli son cycle (…) mais elle laisserait au Moyen-Orient — comme en Inde, comme en Irlande — les germes d’un conflit inépuisable ». La fin de cette guerre en 1948 a marqué un événement historique transcendant, qui se dédouble en deux événements et génère deux souvenirs opposés : Iom Haatzmaut, le jour de l’indépendance d’Israël, et le début de la Nakba, catastrophe en arabe, qui a entraîné le déplacement forcé de 750 000 personnes, soit les deux tiers de la population arabe palestinienne. À ce moment-là, une bissectrice de l’histoire s’est ouverte, qui se prolonge jusqu’à aujourd’hui.
77 ans
Depuis 1948, il y a eu différentes périodes avec des horizons d’avenir différents. La population palestinienne a été soumise à des conditions de plus en plus difficiles : ce qui a commencé par un déplacement s’est transformé en une tentative d’extermination. Les violences terroristes se sont intensifiées et sont devenues extrêmes.
Jusqu’à la fin du XXe siècle, le soutien occidental à Israël provenait des partis sociaux-démocrates européens et du parti démocrate américain : ils voyaient dans les kibboutz un modèle socialiste moderne et leur islamophobie leur permettait de mépriser les Palestiniens. Depuis le début des années 2000, Israël a abandonné ses efforts pour réaliser l’impossible : conjuguer les valeurs universelles et humanistes avec un projet ethno-étatique exclusif, et a eu tendance à s’appuyer beaucoup plus sur les secteurs de droite et du fondamentalisme chrétien, avec un rôle multinational de plus en plus lié à son industrie militaire, de surveillance et de sécurité. Il est juste de considérer Israël non seulement comme un processus endogène, mais aussi comme un aleph de l’Occident : après la chute du mur de Berlin, les frontières d’Israël sont devenues les nouvelles frontières mondiales entre l’Occident et le reste du monde.
Quelques notes sur les transformations internes d’Israël : les kibboutz sont passés de communautés autosuffisantes basées sur le travail et la propriété collectifs à des communautés privées et inégales. Après des décennies d’hégémonie travailliste, un cycle d’extrême droite s’est consolidé. Le pouvoir des secteurs orthodoxes s’est accru. Ses frontières ont évolué avec une dynamique expansionniste et agressive. Les restrictions imposées aux Palestiniens à l’intérieur et à l’extérieur d’Israël se sont intensifiées.
La participation, génération après génération, à la vie militaire est constitutive de la société et de l’État israéliens. Cette éthique s’oppose à la tradition yiddishiste de peur et de rejet de l’armée, répandue parmi les Juifs d’Europe et que nous perpétuons en Argentine. Cette tradition n’implique pas un rejet de toute forme de violence armée : nous nous souvenons avec admiration de la résistance dans le ghetto de Varsovie et de l’exploit clandestin des bateaux qui tentaient de traverser la mer après la Shoah. Mais cela n’implique pas une continuité — ni tactique, ni éthique, ni stratégique — entre ces efforts de résistance et ce que font aujourd’hui les forces de défense d’Israël.
En Argentine, depuis la création d’Israël, il y a eu une large « sionisation » de la communauté, reconnaissable comme majoritaire, mais qui n’a jamais été généralisée. Si beaucoup de nos parents ont un nom en yiddish, notre génération a reçu des noms en hébreu. Les écoles à horaire réduit enseignant le yiddish sont devenues des écoles à temps plein qui arborent le drapeau israélien aux côtés du drapeau argentin. Des milliers d’Argentins ont découvert Israël grâce à des voyages sionistes subventionnés. À son tour, la communauté argentine en Israël est importante, car l’idée d’un refuge juif s’est concrétisée par des migrations dans les années 60 pour rejoindre le communalisme des kibboutz, par des exils dans les années 70 et par une destination en 2001.
Depuis des années, Israël est un sujet délicat dans les conversations, marqué par l’évolution politique et militaire israélienne et par le chevauchement avec la fracture politique locale qui a donné lieu à des épisodes très tendus au sein de la communauté (exemples : le mémorandum avec l’Iran et la mort de Nisman). La relation avec Israël est beaucoup moins problématique que dans les autres grandes communautés juives, comme celles des États-Unis, d’Australie ou du Brésil, où l’alignement n’est pas considéré comme acquis. Les causes de cette moindre problématisation ne sont pas claires, mais nous pouvons identifier, entre autres facteurs, l’attentat contre l’AMIA comme un point crucial où l’identité diasporique argentine s’est intégrée à une position anti-arabe mondiale.
Shoyn genug (Ça suffit)
Les effets concrets ne sont pas encore visibles, mais les gestes diplomatiques montrent que le monde a déjà pris note du fait qu’Israël a franchi une ligne rouge. Milei est le seul dirigeant à s’être rendu dans ce pays cette année. Il faudra voir si l’Occident reconnaîtra à un moment donné qu’il aurait dû mettre fin à ce désastre — dont il est partie prenante — bien plus tôt, ou si la vérité qui se construira laissera Israël seul dans le hors-jeu de l’histoire. Toute violence a une dimension symbolique. Au-delà des corps massacrés, du sang versé et des maisons brûlées, se dresse un conflit d’idées. Les changements au niveau symbolique ont une temporalité différente de celle de la destruction matérielle.
J’ai déjà évoqué le drapeau israélien. Il arbore les couleurs du talit, le manteau rituel. Au centre, l’étoile de David n’est pas seulement un symbole religieux : elle a été adoptée au début du sionisme, puis est devenue le signe de ségrégation que les Juifs étaient obligés de porter de manière visible dans l’Europe nazie. En seulement trois ans, l’étoile est passée de l’insigne jaune au drapeau d’Israël. David possède en outre les attributs qu’Israël souhaite pour lui-même : le faible qui affronte les puissants, roi guerrier et conquérant, mais surtout juste.
On peut considérer l’action militaire israélienne à Gaza comme une réponse militaire sans proportion matérielle avec ce à quoi elle est censée répondre. Le message de ce type de représailles est autre : celui d’une punition totale. C’est l’histoire des réponses démesurées contre la population civile, dont le succès militaire entraîne la déshumanisation de ceux qui les exécutent et une défaite pour l’humanité tout entière : le massacre nazi de Lidice en 1942, le bombardement allié de Dresde et les bombes atomiques américaines sur Hiroshima et Nagasaki en 1945. Si aujourd’hui cette démesure peut s’intensifier sans rencontrer de limites dans le droit international ni d’autres freins multilatéraux, économiques ou diplomatiques, c’est parce que la destruction atteint le paradigme des droits de l’homme également issu de l’après-guerre.
Détruire au nom du judaïsme détruit les fondements juifs que l’on prétend défendre. Si le judaïsme et l’histoire des Juifs ont apporté de l’humanisme au projet sioniste, cela s’effondre si l’Occident israéliste s’empare du judaïsme et le refait pour en faire une justification ouverte d’une violence sans limites.
J’ai cette hypothèse : la destruction de Gaza qui a suivi le massacre du 7 octobre expose au monde entier la crise des idées fondatrices d’Israël en tant qu’État juif. Elle jette le doute sur tout ce qui figure sur son drapeau. Elle le montre non pas comme un État de justice, mais comme un État de pouvoir imposé par la force, comme n’importe quel État-nation. Elle montre qu’il n’y a pas d’exception ni de plus d’éthique en raison de l’origine liée à la victimisation des Juifs. Elle contredit les récits sur son origine. Lorsque la légitimité d’Israël est contestée, je comprends cela : non pas la remise en cause de son existence, mais celle de son essence.
L’yiddish, qui pour ma génération était un son domestique, réservé à la complicité, à l’humour et à l’affection, apparaît soudainement dans la sphère publique comme un mot de passe antifasciste. La langue qui n’a jamais été la langue du pouvoir et qui n’a pas de mots pour désigner le militaire est désormais un pont multiple. En Argentine, de manière diffuse mais constante, je perçois une revendication d’être juif de manière dissidente, non institutionnelle, ironique, queer, russo-turque, spirituelle, politique. Face à l’imposition d’une identité juive hébraïque, automatiquement israélienne, beaucoup ne souhaitent ni se soumettre — et accepter le défi de ce qui peut et ne peut pas être dit — ni se déjudaïser — et admettre que la seule façon d’être juif est celle qu’on cherche à nous imposer comme valable . Il n’est donc pas surprenant qu’à l’heure actuelle, nous soyons nombreux à contester l’imposition d’une identité juive hégémonique et à nous interroger sur la manière dont nous allons être juifs après Gaza. »
Marcela Perelman, Revista Crisis, 5/07/2025
Article traduit – avec l’aide de Deepl – de l’original : https://revistacrisis.com.ar/notas/shoyn-es-basta
Marcela Perelman : Depuis 2002, elle travaille au CELS ( Centre d’études légales et sociales ) où elle dirige le département Recherche. Elle fait partie de l’équipe d’anthropologie politique et juridique de l’UBA (Université de Buenos Aires) et enseigne la sociologie urbaine à l’UBA et au doctorat en droits de l’homme de l’UNLa (Université Nationale de Lanús). Les thèmes de son travail découlent de ses réflexions sur les problèmes liés aux droits de l’homme.
– Les intellectuels accusent Milei de « complicité avec la barbarie » pour avoir invité Netanyahou à visiter le pays. https://www.eldiarioar.com/politica/intelectuales-acusan-milei-complicidad-barbarie-invitacion-netanyahu-visitar-pais_1_12521779.html
– L’Association des travailleurs de l’État (ATE) et l’organisation « Fils et Filles pour l’Identité et la Justice contre l’Oubli et le Silence (HIJOS) exigent l’arrestation de Netanyahou s’il se rend en Argentine.