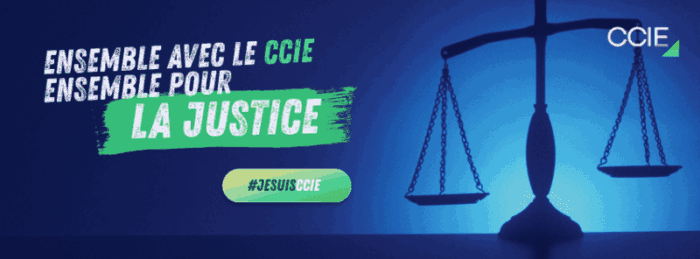Quelle surprise lorsque nous apprenons, ce mardi 3 octobre, l’annulation d’un colloque à l’Université Lumière Lyon 2, auquel nous comptions nous rendre, autour du thème : «Lutter contre l’islamophobie, un enjeu d’égalité?». Cette décision semble donner raison aux prises de positions qui, derrière la mise en cause des participants, dénient l’enjeu de lutte contre l’islamophobie.
Derrière la journée d’études et de débats se cacherait une entreprise “islamiste” et “antirépublicaine”, à la recherche d’une “caution scientifique”.
L’événement est pourtant semblable à bien des manifestations organisées à l’université en rassemblant des universitaires issus de diverses disciplines (science politique, sociologie, sciences économiques…), des associations intervenant dans le champ en question, ou encore des responsables politiques.
Que reproche-t-on exactement à la tenue d’un tel colloque ? Qui en sont les “pourfendeurs”? Il semble, une fois n’est pas coutume, que la discussion autour de l’islamophobie souffre de la mobilisation de quelques personnalités, journalistes, et de quelques associations s’étant autorevendiqués défenseurs d’une conception de la république bien particulière. Lorsqu’un tel réseau obtient de la part d’une université l’annulation d’un débat, c’est plus largement plusieurs piliers démocratiques qui sont mis en danger : la libre expression des associations d’une part, l’université et le débat scientifique d’autre part. Retour sur une dynamique de censure autour du fait “islamophobe”.
Une entreprise “islamiste” et “antirépublicaine” dans les murs de l’université ?
Dans un article publié sur le Figaro.fr le 28 septembre dernier, Céline Pina, essayiste et ancienne élue locale socialiste relayée fréquemment dans différents médias (Le Point, Marianne, LCI, Bourdin direct, La Règle du jeu…) se fait lanceuse d’alerte en dénonçant la tenue du colloque. Participants et organisateurs seraient issus d’une “nébuleuse islamiste et indigéniste” en quête de “caution universitaire”.
En cause donc, la participation au colloque d’un certain nombre d’associations et collectifs jugés controversés, citons pêle-mêle le CCIF (Collectif contre l’islamophobie), l’EMF (Étudiants Musulmans de France), la CRI (Coordination contre le racisme et l’islamophobie)… Signalons avant toute chose que le colloque est organisé par la chaire “Égalité, inégalités et discriminations” de l’université Lyon 2 et l’Institut des Etudes du Travail de Lyon (IETL) et par l’Institut Supérieur d’Étude des Religions et de la laïcité (ISERL). Il s’inscrit donc dans les travaux de recherche portés par ces structures, mais également dans un débat citoyen portant sur les inégalités et discriminations. Comme indiqué sur le programme du colloque

“La société française est amenée à s’interroger : au-delà d’un développement de l’islamophobie, la persistance d’inégalités, l’ampleur des discriminations, la remise en débat de mesures portant atteinte aux droits des femmes, les incitations à la haine, l’essor de manifestations homophobes ou d’actes racistes et antisémites interpellent les citoyen.nes quant aux conditions d’exercice du vivre et de l’agir ensemble dans le respect de l’altérité. Ces enjeux sont au coeur même de la notion de laïcité. Le monde universitaire, dans toutes ses composantes, est concerné au premier chef, tant dans son fonctionnement, dans l’égalité d’accès au savoir que dans la recherche. Cette articulation entre le militantisme pour les droits humains et la réflexion universitaire vient montrer que les phénomènes qui préoccupent la société font écho à l’intérêt porté par l’université aux problématiques sociales. Il n’existe pas de cloisonnement hermétique entre ces deux mondes qui au contraire se complètent pour la construction d’une collectivité responsable et citoyenne.”
Bien évidemment, aucune des organisations participantes ne souffre d’interdiction légale quelconque. Céline Pina les incrimine au nom de liens supposés de certains intervenants à des groupes comme les frères musulmans, ou – réactivant des figures diabolisées – à des individus comme Tariq Ramadan.
On pourrait en rester là : invoquer des connivences entre des intervenants et des groupes soi-disant controversés est-il une raison valable pour faire taire les débats? À plus forte raison, lorsque ces derniers sont encadrés par des universitaires travaillant précisément sur les thématiques sur lesquelles interviennent les associations?
Mais la confusion générale semée dans la tribune de Céline Pina mérite que l’on s’y attarde un instant. Tous les critères semblent bons pour faire taire le débat.
On invoque ici les dispositifs issus de l’état d’urgence, en l’occurrence la constitution d’un fichier “S” pour le président de la CRI. Sans doute le dispositif n’allait-il pas assez loin, que Céline Pina réclame désormais l’interdiction pour un fiché S de pouvoir s’exprimer lors d’un colloque. Fort heureusement, juridiquement, un fiché “S” garde le droit de s’exprimer.
On évoque, sans la moindre administration de la preuve, des liens entre les frères musulmans et le CCIF, quand bien même le collectif l’a toujours démenti et ne cesse de revendiquer son attachement aux principes de la loi de 1905 sur la laïcité. Rappelons que celui-ci, à travers les statistiques qu’il constitue, est l’un des rares organismes permettant de prendre la mesure des actes islamophobes et qu’il est à cet égard consulté par de nombreuses institutions publiques ou par des travaux de recherche, au grand dam de ses détracteurs.
Seule derrière l’écran de son ordinateur, Céline Pina s’arroge la légitimité de créditer la valeur scientifique des travaux académiques des intervenants : “On y trouve également les habituels étudiants inscrits en doctorat se faisant passer pour des experts reconnus ou des enseignants, dont les travaux, ne brillent ni par l’abondance, ni par le rayonnement, ni par la qualité scientifique.” On ne sait pas vraiment qui est visé, mais les jeunes chercheurs participants ne semblent pas produire suffisamment pour l’essayiste. Sans entrer dans un débat sur les moyens de la recherche en France et les conditions des jeunes chercheurs, rappelons à toutes fins utiles qu’un doctorant n’est pas censé avoir produit une “abondance” de travaux, en début de carrière. Quant à la prétendue inscription en doctorat à des fins « islamogauchiste », signalons que celle-ci ne répond pas au bon vouloir de l’étudiant, mais fait l’objet d’une validation scientifique. En outre, cet argument est totalement péremptoire puisqu’aucun étudiant inscrit en doctorat ne communiquait, pour le coup, à ce colloque. Les chercheurs présents ont tous soutenu une thèse, ce qui là encore est un exercice de légitimation scientifique bien meilleur que la seule opinion de Céline Pina.
On se demande bien au motif de quelle connaissance des enjeux scientifiques, l’essayiste se mêle-t-elle de questions de recherche. Même à propos des chercheurs “installés”, encore une fois, les arguments à l’appui paraissent bien pauvres et complètement à côté pour dénoncer le manque de scientificité. François Burgat, politologue, directeur de recherche CNRS à l’IREMAM (Institut de recherche et d’Études sur le monde arabe et musulman) se voit ainsi reproché d’avoir côtoyé Tariq Ramadan – figure ô combien repoussoir dont on s’économise allégrement de devoir en chercher une raison – et l’UOIF (l’Union des Organisations islamistes de France) qui bien qu’affirmant s’être écarté de ce mouvement est ici désigné comme “parti des frères musulmans”. On retrouve ainsi un argument tout droit repris de la communication du front national (rappelons alors que le dernier épisode médiatique traitant du mouvement voyait s’opposer Emmanuel Macron et Marine Le Pen, cette dernière reprochant à son interlocuteur d’être également sous influence de la “dangereuse organisation”).
L’entretien de rapport, parfois étroit et durable, entre un chercheur et les acteurs de son objet d’étude, devrait pourtant faire sens auprès du lecteur. En sciences sociales, le chercheur discute avec les acteurs de son terrain.
Nous relevons enfin avec délectation le reproche fait à un professeur d’avoir d’empêcher Caroline Fourest de tenir une conférence au sein de l’Université Libre de Bruxelles. Sans nous prononcer sur les innombrables approximations et contre-vérités de la journaliste pourtant très médiatisée, dont on pourra en apprécier quelques exemples à ce sujet ici, la logique de l’argument interpelle : Vengeance donc ! il faudrait censurer celui qui a censuré.
En tout état de cause, aucun élément ne semble attester d’une quelconque marginalité académique des intervenants.e.s, bien au contraire. La présidence de l’Université Lyon 2 se défend d’ailleurs de toute remise en question des axes discutés dans lors de l’évènement : “La présidence apporte tout son soutien à la chaire « Égalité, Inégalité, Discriminations » et à l’Institut supérieur d’Étude des religions et de la laïcité (ISERL)« .
On pourrait donc s’arrêter au ridicule de cette prétention de Cécile Pina à juger de la scientificité de travaux de recherche, si cette controverse n’avait pas abouti à infléchir l’activité d’une université. Car c’est bien sur ce point qu’il y a danger : alimentée par un microréseau de défenseurs autoproclamés de la laïcité et de la république, la suspension du colloque vaut pour atteinte à la discussion scientifique – ou avec des scientifiques – et donc au débat de manière générale.
L’impossible débat (serein) sur l’islamophobie : Censure et dénégation d’un problème social.
La mobilisation de journalistes, d’essayistes ou autre personnalité, qui ont voix au chapitre dans le débat public, et cherchent à réduire au silence le débat autour de l’islamophobie n’est pas une première. On peut même identifier un réseau de “veille républicaine” aux allures de vieille France. Dans le cadre de l’organisation de ce colloque, les lanceurs d’alerte autoproclamés vont du site d’extrême droite Fdesouche, jusqu’à la LICRA, en passant par le Printemps républicain de Laurent Bouvet ou encore l’article décrypté plus haut. On pourra apprécier ici la reprise des mêmes arguments d’une structure à l’autre. L’événement est mis sur un même plan que l’instrumentalisation de l’Université Jean-Moulin, Lyon 3, par l’extrême droite du temps de Bruno Gollnisch, par la LICRA comme par Céline Pina.
Ce nouvel épisode succède à une longue liste de prises de position visant à mettre en cause la reconnaissance de l’islamophobie comme l’une des traductions contemporaine du racisme. Des organismes et des personnalités politiques de gauche comme de droite sont mobilisés autour de la construction d’une menace républicaine, dont nous avions déjà évoqué les effets et les ressorts. Les faits que ces différents courants est trouvé en la matière un terrain d’entente suscite la curiosité, en tout cas, interroge.
Il est vrai que la constitution d’un phénomène en objet scientifique peut participer à sa reconnaissance comme problème public. La science n’est pas, en aucun cas, en dehors de la société, des débats et des orientations politiques, quel qu’en soit l’objet. C’est justement pourquoi l’enjeu de l’annulation du colloque peut donc être interprété comme une volonté de dénier l’existence du problème “islamophobie”. C’est ainsi que l’on retrouve dans les lignes mettant en cause sa tenue, au-delà des arguments invoqués, le déni de l’islamophobie, comme catégorie scientifique d’abord, et comme problème public ensuite.
Nous sommes longuement revenus sur l’entreprise de délégitimation du caractère scientifique des travaux sur l’islamophobie. En effet, l’un des objectifs de la mobilisation ici dénoncée vise à empêcher la mise en place et la tenue de programme de recherche en la matière. Cette volonté est perceptible à travers la non-reconnaissance des catégories évoquées sur le programme du colloque. C’est notamment le cas pour l’islamophobie d’État qui renvoie de manière plus générale au racisme d’État. Pour la Licra, les intervenants cherchent ici à “labelliser des thèses indéfendables comme celle de « l’islamophobie d’Etat » en présence d’un fiché S”. L’islamophobie d’État n’a pourtant rien à voir avec le fiché S en question. Il s’agit bel et bien d’une catégorie scientifique développée par bon nombre de travaux et il s’agit donc de mener une discussion à son propos. Elle peut renvoyer au processus de construction du problème musulman par les élites françaises 1 comme à la démarche de minoration de certaines catégories de citoyens en fonction de leur religion 2 Or, le racisme d’État semble avoir été défini par Céline Pina de manière “précise : il crée des sociétés d’apartheid où la différence des droits selon que vous soyez dominant ou dominé est inscrite dans la loi. Une des marques les plus révélatrices concerne l’interdiction des mariages au nom de la pureté de la race ou de l’appartenance.” Et d’ajouter, “nombre des militants de l’islam politique qui interviennent dans ce colloque sont algériens, ils savent que leur pays interdit les mariages entre musulmans et non-musulmans. S’ils veulent lutter contre le racisme d’État, ils ont là un bel exemple, réel et non fantasmé.” À bon entendeur : occupez-vous de votre pays avant de parler du nôtre! Il n’y a cependant là rien qui puisse être assimilé à une quelconque démarche scientifique. Le refus de reconnaître le concept même d’islamophobie constitue une ligne dure de la part des protagonistes comme on peut le voir [ici.
Aussi, malgré les précautions de la présidence de l’université Lyon 2, l’annulation du colloque peut passer pour sanction des problématiques abordées. Il y a bel et bien un enjeu politique à la tenue du colloque, et son annulation fait frémir toutes les personnes engagées sur la lutte contre les discriminations et les inégalités.
Au-delà de l’objet d’étude, c’est donc bien la reconnaissance politique du problème qui est en jeu. “On y apprend que l’assassinat des journalistes de Charlie et les vagues d’attentats que nous avons connus n’ont eu qu’une seule conséquence: l’explosion de «l’islamophobie». Or c’est faux”. Qu’est-ce qui est faux selon Céline Pina? On peut le vérifier, les organisateurs n’ont jamais prétendu identifier ainsi l’unique conséquence des attentats. S’agirait-il de remettre en cause l’augmentation des faits islamophobes? Et pour cela, il suffit à Céline Pina de prendre un ton grave et déclaratif, sans le moindre contre-argument : “c’est faux”. L’affaire est donc réglée : l’enjeu est de minorer les atteintes, les traitements différenciés aux personnes de confession, “réelle ou supposée”, musulmane. Cette lutte politique pour ne pas reconnaître un problème comme public passe, comme nous l’avons noté par la délégitimation des organisations qui s’en préoccupe. Elle vise également à éviter tout soutien de la part de personnalité politique de premier ordre. Il en va ainsi du traitement de Jean-Louis Bianco, président de l’observatoire de la laïcité, à qui l’on reproche sa participation, même s’il ne s’agissait que d’une communication écrite.
Le tabou sur le traitement de la France postcoloniale semble avoir encore de beaux jours devant lui. Reste à savoir si ce genre de pression exercé sur l’université constitue une exception ou un recule généralisé sur le débat démocratique.
4 oct. 2017 Par Antoine Lévêque Édition : Le Léviathan anthropophage
- Abdellali Hajjat et Marwan Mohammed, Islamophobie: comment les élites françaises fabriquent le problème musulman, Paris, La Découverte, 2013.[⇧]
- Vincent Geisser, « La production républicaine d’une « minorité musulmane » ou le paradoxe » hexagonal », in Minorités visibles en politique, Paris, CNRS Éditions, Société & politique.[⇧]