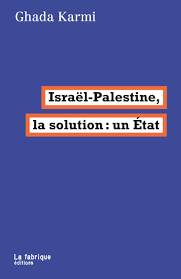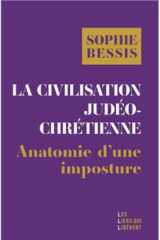Ghada Karmi
Israël-Palestine, la solution : un État
La fabrique éditions, 2022
156 p, 13 euros
Pour le commander sur le site de l’éditeur
Ghada Karmi est Palestinienne exilée et universitaire en Angleterre. Elle est chargée de recherche et maître de conférences à l’Institut d’Études arabes et islamiques de l’Université d’Exeter et travaille dans le même département que Ilan Pappé. Elle a écrit plusieurs ouvrages sur la question palestinienne, celui-ci est le premier traduit en français.
Eric Hazan, dont on se souvient qu’il a publié avec Eyal Sivan Un État commun. Entre le Jourdain et la mer, est l’éditeur et le traducteur de cette version abrégée et partiellement actualisée du livre de Ghada Karmi de 2007, Married to Another Man : Israel’s Dilemna in Palestine.
Dans Les 10 légendes structurantes d’Israël, Ilan Pappé explique en quoi présenter la solution à deux États comme la seule possible est la dixième légende. Ghada Karmi, elle, est plus catégorique. Il ne pourra pas, selon elle, y avoir d’autre solution juste que celle d’un seul État, dont elle ne préjuge certes pas du fonctionnement. Mais avant de le démontrer, elle prend le temps de revenir sur l’histoire de cette terre de Palestine qui est la sienne.
Dans un premier chapitre, le problème du sionisme, elle commence par « replacer la situation en Israël Palestine dans son juste contexte et montre que le sionisme était dès la création d’Israël voué à ne pas pouvoir implanter un État démocratique, respectant la population autochtone. Israël n’est pas un phénomène naturel au Moyen-Orient, il ne s’est pas développé dans des circonstances ordinaires et il n’a pas d’antécédents historiques dans la région, malgré la mythologie biblique invoquée pour suggérer le contraire ».
Ghada Karmi cite longuement l’interview de Benny Morris dans le quotidien Haaretz du 8 janvier 2004, qui fut un de premiers « nouveaux historiens » israéliens à montrer la réalité de ce qu’a été la Nakba. En 2004, Benny Morris assume totalement le choix sioniste et ses conséquences : « un État juif ne pouvait accéder à l’existence sans l’expulsion de 700 000 Palestiniens. Il fallait donc les expulser. Si le désir d’établir un État juif était légitime, il n’y avait pas d’autre choix (…). Le besoin d’établir cet État à cet endroit était plus important que l’injustice faite aux Palestiniens en les expulsant. » Et logiquement Benny Morris en tire la conséquence : « Il n’y aura pas de paix dans la génération actuelle. Il n’y aura pas de solution. Nous sommes voués à vivre par l’épée ».
Ghada Karmi montre que Jabotinsky dès 1923 ne disait pas autre chose, comme Moshe Dayan dans une intervention limpide en 1956 lors des funérailles d’un jeune Israélien tué par un Arabe près de la frontière égyptienne : « ne lançons pas d’accusations contre les meurtriers. Qui sommes-nous donc pour leur reprocher leur haine ? Depuis maintenant 8 ans ils traînent dans leurs camps de réfugiés à Gaza et sous leurs yeux nous nous installons sur les terres et dans les villages où eux et leurs ancêtres ont vécu. Nous sommes une génération de colons, et sans casques d’acier, sans canons, nous ne pouvons ni planter un arbre ni construire une maison . (…) C’est le destin de notre génération, le choix de notre vie – être prêts, être armés, forts et durs, autrement l’épée glissera de nos mains et notre existence même partira en fumée. »
Et Ghada Karmi précise : « l’argument central de ce livre est que la principale cause de l’échec du « processus de paix » est la volonté sioniste de créer et de maintenir une majorité juive dans un pays appartenant à des non-Juifs. (…) En tant que Palestinienne « de l’extérieur », la question de la justice est dominante dans ma façon de penser. Le fait que je ne vive pas sous occupation israélienne, ni dans un camp de réfugiés, ni à l’intérieur d’Israël comme citoyenne de deuxième ordre ne change rien à ma position. »
Dans un deuxième chapitre, Israël et les Arabes, Ghada Karmi montre qu’en 1948 les Arabes se sont trouvés face à une nouvelle création, Israël, qui leur était étrangère à tous points de vue ; ils ne pouvaient ni comprendre le nouvel État ni s’entendre avec lui. « Depuis le début, Israël a bénéficié de l’appui des grandes puissances occidentales qui permirent au projet sioniste de « faire son lit » dans une région étrangère et hostile (…). Les Arabes furent amenés à répondre à la création d’Israël de diverses façons, toutes néfastes. » Et Ghada Karmi passe en revue les diverses réponses allant de la lutte armée (en position de faiblesse) aux stratégies diplomatiques (là encore sans un rapport des forces favorable) en passant par les attentats suicides. L’auteure montre combien les réfugiés pèsent sur les finances des États qui les reçoivent. Elle évoque les derniers accords et conclut : « Israël a pu imposer sa version unique de « la paix » au monde arabe, tous les États arabes étant « pacifiés » ou affaiblis, y compris de possibles challengers comme l’Irak ou la Syrie, les Palestiniens étant maintenus en soumission par la matraque. Comme si les puissances occidentales, qui ont tant fait pour aider Israël à ce résultat, avaient finalement réussi à faire avaler de force Israël aux Arabes, quoi que ceux-ci aient pu souhaiter ou espérer. » Ghada Karmi montre aussi que la conquête sioniste a eu un impact important sur l’évolution des régimes arabes, qui ont renforcé leurs politiques internes autoritaires.
Dans un troisième chapitre, le « plan de paix » israélo-palestinien, Ghada Karmi, constate qu’« il est plus urgent que jamais de trouver une solution à un conflit qui ruine les existences et compromet l’avenir non seulement des Palestiniens mais de tout le monde arabe (et aussi d’Israël). » Or « peu de termes circulent autant dans le lexique politique en étant aussi dépourvus de sens que le « processus de paix israélo-arabe » ». Ghada Karmi reprend l’histoire des rendez-vous diplomatiques, la résolution 242, la conférence de Madrid, les accords d’Oslo. Elle tire un bilan sévère des stratégies d’Arafat et de l’OLP, mais juge que « la principale cause de la dégradation de la Palestine, proche aujourd’hui de la destruction, c’est le soutien constant et l’indulgence manifestée vis-à-vis de l’État juif par les États-Unis et l’Europe depuis sa fondation – et même avant. »
C’est donc dans le quatrième chapitre, qui couvre la moitié de l’ouvrage, que Ghada Karmi traite de sa proposition : un seul État. Il traite de savoir ce qui constituerait cet accord juste et durable entre Palestiniens et Israéliens, sans tenir compte de sa possibilité au moment où elle écrit. « Le fait que quelque chose est juste ou injuste est indépendant de ce qu’on peut faire. » L’auteure prend le temps de montrer que vu la réalité sur le terrain il n’y a aujourd’hui aucune possibilité d’un État palestinien à côté de l’État d’Israël qui satisferait les demandes minimales des Palestiniens, à commencer par le droit au retour.
Mais la définition qu’elle donne de la solution d’un seul État ne résout pas tous les problèmes. Ainsi, elle écrit « La solution à un État prévoit la création d’une seule identité israélo-palestinienne dans laquelle les deux peuples vivront ensemble, sans frontières et sans partition. (…) Selon les partisans d’un seul État, aucun colon juif n’aurait à être déplacé et aucun Palestinien ne se trouverait plus sous occupation.(…) Israël, qui est devenu l’endroit le plus dangereux de la planète pour les Juifs, une fois intégré dans le nouvel État partagé, pourrait être un lieu de réel refuge pour eux. »
L’auteure montre qu’un tel État unique pourrait être un État binational ou un État laïque et démocratique, et elle fait l’inventaire des travaux à ce sujet, et des occasions où la main tendue des Palestiniens a été ignorée par Israël. Elle donne des informations sur la floraison de groupes qui en Israël, en Palestine, et dans le monde entier se sont créés ces dernières années pour défendre l’idée d’un seul État. Et elle cite le livre de Jeff Halper paru en 2021. Elle considère que la solution à un État, si elle signifie la fin du sionisme comme idéologie nationale, permettrait éventuellement la persistance de ce qu’elle appelle un sionisme culturel avec le maintien d’une identité culturelle juive sur la terre biblique.
Ghada Karmi conclut logiquement le chapitre : « Créer une société juste à la place du système israélien actuel qui privilégie un groupe aux dépens des autres est la seule option morale et réaliste pour l’avenir. C’est la meilleure façon de réparer le terrible mal qui a été fait aux Palestineins ainsi qu’aux Juifs. »
Suit un court chapitre «Onze jours en mai », à propos des événements qui se sont déroulés du 6 au 21 mai, et s’interroge dans un épilogue : la fin du sionisme ?
Ghada Karmi ne se fait aucune illusion, ni sur le caractère inéluctable de la solution à un État, ni sur la possibilité même de sa réalisation à court terme. L’instauration de cet État unique ne serait pas l’aboutissement mais le début d’un processus permettant d’envisager l’égalité.
A divers moments de la lecture, j’ai eu le sentiment que l’auteure se refusait à entrer dans une analyse sociale de la société juive israélienne et des différents « morceaux » de la société palestinienne fractionnée. Elle n’évoque pas directement l’intérêt d’un seul État comme cadre d’une possibilité d’émancipation des peuples et des personnes.
Mais nous savons bien que la fin de l’apartheid sud-africain n’a pas signifié encore aujourd’hui l’égalité des droits, l’émergence d’une bourgeoisie noire n’a pas signifié la fin des discriminations.
La lecture de ce livre n’est pas toujours fluide, on imagine qu’il n’a pas été facile d’à la fois abréger et actualiser une telle réflexion.
Mais je crois que cette parole palestinienne doit être lue par tous ceux qui veulent dans le combat mené en soutien à la résistance du peuple palestinien avoir des perspectives positives à proposer, même si nous sommes à l’instant ‘t’ loin de leur réalisation possible.
André Rosevègue (merci à Jean-Guy Greilsamer pour ses remarques)