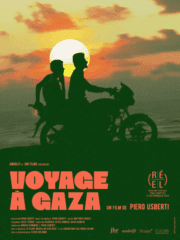Photo: affiche d’Abdel Rahman Al Muzain « Représentant unique légitime » (1980, détail). Archives du projet d’affiches palestiniennes
L’article de Dunja Jelenković sur le site de la revue Alternator1, 15 février 2024
8 novembre 2023. Soirée d’ouverture du 36e Festival international du film documentaire d’Amsterdam (IDFA). Trois militants montent inopinément sur scène en portant une banderole avec les mots : Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre. Le directeur du festival, Orwa Nyrabia, applaudit avec le public.
Avance rapide de deux jours et les choses prennent une tournure. L’IDFA présente ses excuses, affirmant que Nyrabia n’avait pas réellement vu le slogan, qui, selon eux, s’écarte des valeurs du festival. Fréquemment présent lors des manifestations pro-palestiniennes à travers le monde, le slogan a été critiqué par beaucoup comme un prétendu appel au nettoyage ethnique et à l’élimination d’Israël. Cependant, sa signification a des interprétations différentes selon qui le dit et qui l’entend. Cela peut également être compris, sans connotations antisémites, comme un signe de soutien au peuple palestinien opprimé dans sa lutte pour l’égalité qui dure depuis des décennies, particulièrement urgente maintenant, alors qu’il est massacré par dizaines de milliers et se voit refuser ouvertement l’accès à la nourriture et à l’eau. Les hésitations de l’IDFA face à cette controverse et leurs efforts ultérieurs pour se distancier de la réponse immédiate du réalisateur ont conduit à une série de protestations symboliques : les représentants des institutions cinématographiques israéliennes ont publié une lettre ouverte condamnant le festival, tandis que l’Institut du cinéma palestinien et une vingtaine de cinéastes du divers pays ont retiré leurs films du programme. En présentant ses excuses, l’IDFA visait une apparente neutralité et se positionnait ainsi dans le cadre de la position dominante des médias occidentaux à l’égard de la guerre à Gaza, marquée par une condamnation insuffisamment ferme de l’agression israélienne. Pourquoi la position du festival sur cette question est-elle importante ?
Les festivals de cinéma sont des « lieux de mémoire » d’un genre particulier (Nora 1984). Ce sont des événements culturels et artistiques, mais ils ont aussi une autorité sociale et politique. En tant que points de rencontre pour les cinéastes et le public – mais aussi pour les journalistes, les critiques, les représentants de l’industrie (cinématographique), les hommes politiques et les membres d’ONG – leur impact s’étend bien au-delà du moment et du lieu où ils se déroulent. En outre, les films bénéficiant d’une forte diffusion dans les festivals bénéficieront généralement également d’une distribution cinématographique et d’un espace médiatique importants. Ainsi, les récits que les festivals créent sur les enjeux les plus importants du monde dans lequel nous vivons touchent des publics divers, bien plus larges que ceux présents aux projections elles-mêmes.
Les festivals de cinéma documentaire ont tendance à être moins populaires que leurs homologues de longs métrages, mais leur impact reste important en raison de la tendance du public à assimiler le film documentaire à la réalité. Parce que les films documentaires s’appuient sur des images de personnes et d’événements réels, le public interprète souvent le cinéma documentaire comme un miroir de la réalité plutôt que comme une interprétation artistique. D’où l’importance de comprendre quelle version de la « réalité » les festivals de cinéma promeuvent, surtout en temps de guerre où non seulement les territoires mais aussi la vie des gens sont menacés.
En gardant ces considérations à l’esprit, cet article présente un bref aperçu chronologique des approches de propagande des festivals de cinéma européens dans le contexte des conflits territoriaux des XXe et XXIe siècles, qui ont eu lieu ou ont affecté le continent européen, berceau de ce film. type particulier d’événement culturel. Le texte se concentre sur l’espace yougoslave et la crise de Trieste (1945-1954), un conflit de guerre froide entre l’Italie et la Yougoslavie concernant les frontières nord de l’Adriatique. La crise de Trieste, qui a coïncidé avec la première vague de création de festivals de cinéma, expose certaines des méthodes fondamentales de légitimation des revendications idéologiques et territoriales à travers les festivals, démontrant comment de tels événements peuvent remettre en question la réalité politique dans laquelle ils se déroulent tout en s’adaptant à cela.
Diplomatie et propagande (anti)guerre
Depuis leur création, les festivals de cinéma se sont révélés être des événements d’influence géopolitique, en particulier dans les périodes précédant et pendant les conflits internationaux. Le premier festival de cinéma au monde, la « Mostra » à Venise, a été lancé en 1932 pour promouvoir les idéaux de Mussolini. La France suivit bientôt avec le Festival de Cannes, fondé en 1939 en partie pour contrebalancer la propagande fasciste sortant du Lido vénitien. Cependant, le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale l’interrompit dès le premier jour. La Mostra, à l’inverse, n’a pas été immédiatement perturbée par la guerre. Suspendu seulement en 1943, son programme était dominé par des films des pays de l’Axe, soutenant indirectement leurs objectifs de guerre. Il s’agit du premier exemple d’une influence à double sens : le contexte de guerre a affecté la programmation et, à l’inverse, en ne lui résistant pas, le festival a également légitimé ce contexte avec sa programmation.
À l’époque de la reconstruction d’après-guerre, les festivals sont devenus des événements réguliers, les premières éditions des festivals de Cannes, Locarno et Karlovy Vary ayant eu lieu en 1946. Ils ont été suivis par ceux d’Édimbourg, de Bruxelles (1947), de Berlin (1951), de Mannheim-Heidelberg ( 1952), Saint-Sébastien (1953), Oberhausen, Pula (1954) et Leipzig (1955). Alors que la guerre froide imposait un besoin accru de diplomatie (culturelle), les festivals deviennent rapidement des arènes de confrontations et de rapprochements politiques, comme en témoignent leurs politiques de programmation et la circulation des cinéastes de l’époque. Certains ont même été fondés dans un contexte de guerre froide. Le festival du court métrage d’Oberhausen (1954), petite ville industrielle d’Allemagne de l’Ouest, a été créé en signe de protestation contre la division des blocs. Il a invité des cinéastes d’avant-garde du monde entier, avec un accent particulier sur les nouvelles formes et tendances, défiant les frontières imposées par les alliances culturelles et politiques d’après-guerre. Comme Dorothea et Ronald Holloway l’ont noté, cela a fourni la preuve que nous vivions dans « un » monde (O pour Oberhausen. Weg zum Nachbarn 1979).
L’agenda de la guerre froide (et territorial) était également à l’origine de la création du Festival du film de Pula (1954). Un rassemblement cinématographique national yougoslave, né au milieu du conflit avec l’Italie au cœur du territoire contesté, a symboliquement réaffirmé son identité non italienne (Jelenković 2023). Les documents d’archives des festivals européens actifs au moment de la crise de Trieste dévoilent une série de tentatives de diverses structures festives et politiques visant à imposer des idées contradictoires sur des frontières justes. À cette époque, le processus de sélection se faisait par l’intermédiaire des institutions étatiques. Le Festival de Cannes, par exemple, a envoyé des invitations par l’intermédiaire du ministère des Affaires étrangères – non pas aux cinéastes sélectionnés, mais aux pays. Leurs institutions choisiraient alors leurs propres représentants en fonction du nombre de titres indiqué dans l’invitation. Un tel processus reflète inévitablement les intérêts des pays hôtes et invités, qui sont parfois opposés les uns aux autres. Un exemple de cela s’est produit lorsque le Comité yougoslave pour la cinématographie a promu le documentaire Julian March (Radoš Novaković, 1946) sur la frontière controversée au premier Festival de Cannes. Mais la participation yougoslave n’était pas dans l’intérêt de la France à l’époque : l’invitation avait en fait été envoyée par erreur et le documentaire avait finalement été rejeté sous prétexte que la candidature était arrivée trop tard (Jelenkovic 2022). Cela n’a changé qu’en 1949, avec la projection du film de guerre Sur notre propre terre (France Štiglic, 1948). Le film dépeint la région nord de l’Adriatique comme un espace ethnique slovène homogène, ce qui est particulièrement évident dans la scène où une Slovène enlève ses chaussures avant son exécution parce qu’elle veut faire ses derniers pas « sur son propre territoire ». Pourtant, typique de la production socialiste, la division entre le bien et le mal est organisée selon des lignes idéologiques plutôt que nationales, envoyant un message sur l’unité de tous les peuples épris de justice, quelle que soit leur nationalité, autour de l’objectif commun d’établir une société meilleure au sein de leur pays, des frontières équitables. Une impression complètement différente est créée dans les deux films italiens les plus importants sur la frontière : La Ville souffrante (Mario Bonnard, 1949) et Cœurs sans frontières (Luigi Zampa, 1950). Représentant des familles italiennes sous pression pour décider de quel côté de la frontière imposée elles vivraient, ils décrivent tous deux la région nord de l’Adriatique comme un espace ethnique italien, culturellement et politiquement usurpé par les Slaves. Cependant, pendant la crise de Trieste, l’Italie a bénéficié d’un soutien international plus important que la Yougoslavie et a donc eu moins besoin de promouvoir ces films dans le monde entier. Cela ressort clairement de leur faible diffusion dans les festivals, ce qui rendait leur influence insignifiante à l’époque.
La faible visibilité de la question territoriale du nord de l’Adriatique dans les festivals s’est poursuivie après la division de la région à la fin de 1954, mais le sujet s’est désormais également déplacé en marge de la production cinématographique yougoslave. Au milieu des années 1950, la Yougoslavie se positionne comme partenaire à la fois de l’Est et de l’Ouest. Les institutions cinématographiques yougoslaves ont donc détourné leur attention de la question du nord de l’Adriatique pour se concentrer sur la promotion de la politique de Tito comme alternative réussie au bloc de l’Est. De manière assez inattendue, cela ressort clairement de la circulation des films anathèmes de la vague noire des années 1960 et du début des années 1970. Parce qu’ils ont remédié aux lacunes du système, l’accès au public a souvent été bloqué en Yougoslavie même. La vague noire voyage néanmoins à l’étranger et connaît un succès majeur dans les festivals d’Oberhausen, Venise, Berlin et Cannes. Cette situation paradoxale convenait aux censeurs locaux : la diffusion internationale de films aussi critiques confirmait que la Yougoslavie était prétendument un pays de liberté d’expression. Le silence des institutions cinématographiques italiennes sur le conflit frontalier avec la Yougoslavie était motivé par le désir d’éviter un conflit avec Tito et par le manque d’intérêt général pour cet épisode historique. Du milieu des années 1950 jusqu’à la fin de la Guerre froide, la programmation des festivals liée aux conflits territoriaux contemporains faisait principalement référence à ceux hors d’Europe (Indochine, Vietnam, Algérie), reflétant la réalité des conflits armés de cette période.
En ce qui concerne le continent européen, l’impact mutuel des fêtes et des guerres est redevenu remarquable dans la Yougoslavie des années 1990. La situation dans le pays a provoqué à la fois l’annulation et la création de festivals. Le Festival du Film de Pula a été interrompu en 1991 en raison du déclenchement de la guerre en Croatie. Le Festival du Film de Sarajevo a été fondé en 1995 pour encourager la reconstruction de la société civile après la guerre en Bosnie. En Serbie, les sanctions ont empêché l’acquisition de films étrangers, ce qui a conduit à l’annulation du FEST (1993-1994). Le seul festival qui n’a pas connu d’interruptions dues à la guerre est le Festival du documentaire et du court métrage yougoslave de Belgrade. Cependant, en 1992, elle a été réduite aux participants de Serbie-et-Monténégro, avant d’admettre finalement dans la compétition nationale des films de la partie serbe de Bosnie-Herzégovine. Lorsque cela s’est produit, le programme est devenu un miroir relativement fidèle de ce qui était communément considéré comme l’espace national serbe, et le festival a pour l’essentiel abandonné son identité yougoslave. Durant cette période, les sanctions internationales ont empêché non seulement l’entrée de films étrangers en Serbie, mais également la projection de films serbes à l’étranger. C’est pour cette raison que la Palme d’or d’Emir Kusturica pour Underground (1995) a suscité une large couverture médiatique : le film a non seulement remporté le prix principal de l’un des festivals les plus prestigieux au monde, mais il s’agissait également de la première grande exposition internationale d’un film serbe après trois ans d’isolement. L’éclatement de la Yougoslavie, entre parenthèses, a également favorisé un regain d’intérêt pour la question du nord de l’Adriatique et de la crise de Trieste, dans la mesure où il a déclenché un réexamen des actions (d’après-)guerre des communistes. Le renforcement de la droite italienne au milieu des années 1990 a également contribué à un regain d’intérêt pour ce thème, en raison de sa capacité à provoquer des sentiments nationalistes. Dans une telle ambiance, les films Cœur sans frontières et City of Pain ont été restaurés et réédités (respectivement 2000 et 2008). Cela a permis le renouveau de leur vie de festival et, avec elle, de la promotion cinématographique de l’idée du nord de l’Adriatique comme région autochtone italienne.
Au début de la guerre en Ukraine (2014), les programmes des festivals étaient principalement déterminés par leurs organisateurs, les gouvernements n’étant généralement pas intervenus dans le processus de sélection depuis la chute du mur de Berlin et l’ouverture des frontières yougoslaves. Par ailleurs, les festivals d’Europe occidentale semblent unis dans leur condamnation de l’invasion de l’Ukraine : plusieurs programmes spéciaux sur le sujet sont régulièrement organisés, des œuvres ukrainiennes figurent parmi les films projetés et primés et des équipes de tournage viennent souvent en personne. Une forme courante de soutien dans ce contexte est le boycott des cinéastes russes. S’opposant à leur exclusion totale, les festivals de Venise, Cannes et Berlin ont annoncé en mars 2022 qu’ils ne boycotteraient pas les cinéastes russes indépendants, mais uniquement les délégations et ceux qui collaborent avec les institutions officielles. En réalité, cependant, une certaine forme de soutien institutionnel de la part du pays d’origine est généralement une condition préalable à la réalisation d’un film. Ceci est confirmé par le fait que seuls trois films de ce type ont été projetés dans ces trois festivals depuis cette décision : La Femme de Tchaïkovski (Cannes, 2022), La Cage cherche un oiseau (Berlin, 2023) et Grace (Cannes, 2023). .
Et qu’en est-il de la Palestine ?
« Les mots comptent », ont écrit les représentants de l’industrie cinématographique israélienne dans leur lettre réagissant à l’apparition du slogan « de la rivière à la mer » lors de l’ouverture de l’IDFA. En effet, les mots comptent. Les idées générées par les festivals de cinéma ont une résonance profonde et à long terme. C’est pourquoi leurs programmes et leurs invités, ainsi que la condamnation ou le soutien qu’ils apportent à certaines politiques en temps de guerre, sont plus qu’une simple question de curation, mais aussi une question éthique et politique. Compte tenu de la performance passée des festivals européens en période de conflit, on peut se demander si dans les prochaines saisons à Cannes, Venise et Berlin, nous assisterons à des rétrospectives de célèbres réalisateurs palestiniens comme Annemarie Jacir ou Elia Suleiman. Bénéficieront-ils du même soutien que leurs collègues ukrainiens lorsque leur pays a été brutalement attaqué ? Le drapeau palestinien flottera-t-il au Lido ? Les principaux festivals de cinéma confirmeront-ils que la nouvelle guerre au Moyen-Orient nous concerne tous, que nous vivons tous dans « un seul monde » ? Cela reste une question ouverte. En prévision, les spectateurs feraient bien d’observer les festivals d’un œil critique, conscients de l’influence qu’ils exercent, mais aussi de l’influence qui s’exerce sur eux, et de se rappeler qu’ils représentent des maillons puissants dans le processus de construction de la mémoire culturelle sur les enjeux les plus importants de notre passé et de notre présent. Et aussi notre avenir.
Cet article a été développé dans le cadre du projet de recherche CBA TRIESTE (The Cinematic Battle for the Adriatic: Films, Frontiers, and the Trieste Crisis, 1945-1954), qui a reçu un financement du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne dans le cadre du programme Marie-Curie. Convention de subvention Skłodowska-Curie n° 101020692 (MSCA-IF-EF).
Traduction Michel Ouaknine
- Alternator est une revue professionnelle en ligne slovène rédigée par des chercheurs de tous pays pour tous les lecteurs intéressés par la science (nature, société et technologie) dans le but de rapprocher recherche et chercheurs et de briser la dichotomie qui existe entre sciences sociales et humaines et les sciences naturelles[⇧]