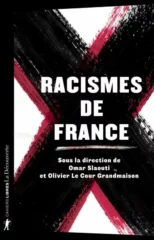Ce texte est tiré d’une communication de Selim Nadi, lors du lancement (book launch) de l’ouvrage de Brendan McGeever Antisemitism and the Russian Revolution (Cambridge University Press, 2019) — à l’occasion de la conférence annuelle « Historical Materialism », à l’université SOAS de Londres. La discussion devait initialement se tenir entre Stephen Smith, auteur de Pétrograd rouge. La Révolution dans les usines (1917-1918) (Les Nuits Rouges, 2017), et d’Eric Blanc, auteur de Revolutionary Social Democracy : Marxist Politics Across the Russian Empire (1882–1917) (Brill, 2019). Cependant, Eric Blanc étant malade, il a été remplacé, au pied levé par Selim Nadi, dont nous publions la brève communication ci-dessous.
« Le nationalisme [anticolonial] ouvre la voie au communisme »
Claude McKay (1920)
Lorsque Brendan m’a demandé de remplacer Eric, j’étais à la fois très content et très hésitant. J’ai immédiatement répondu que je ne suis pas historien de la Révolution russe — même si, bien évidemment, cet événement est un événement central selon moi. Brendan s’est empressé de me répondre qu’il n’avait pas écrit ce livre pour les seuls spécialistes. Je vais donc tâcher de me concentrer sur quelques aspects politiques — qui font écho à des questions tactiques et stratégiques toujours extrêmement brûlantes aujourd’hui. En tant que jeune historien, je suis bien évidemment conscient des risques qu’il y a à calquer l’analyse d’un événement passé sur notre présent. Toutefois, je reste persuadé de l’importance qu’il y a pour les militants à discuter ce type de livre pour réfléchir à nos propres errements politiques. Ici, je ne vais donc pas tellement discuter la place qu’occupe cet ouvrage dans l’historiographie de la Révolution russe — je laisse cette tâche à Stephen, dont je respecte beaucoup les travaux. L’objectif de cette communication est de souligner l’importance d’une telle étude pour les non-spécialistes mis également pour tous ceux qui souhaitent se pencher sur les contradictions raciales qui traversent les processus révolutionnaires.
Le livre de Brendan offre une analyse précise de l’entremêlement complexe entre la politique révolutionnaire des bolcheviks, entendant abattre l’exploitation, mais également les différents types d’oppression et le fort antisémitisme que l’on pouvait trouver chez les paysans et les ouvriers russes de l’époque. Il me semble que c’est là un premier point important à discuter : la contradiction entre l’organisation révolutionnaire et le sujet révolutionnaire. Le fait que, comme le montre brillamment Brendan, les rapports de classe sont toujours déjà racialisés — et que le processus révolutionnaire ne peut ignorer cette racialisation.
Le livre de Brendan met particulièrement en avant « l’impureté » des processus révolutionnaires, à travers l’étude du cas concret de la Révolution russe. Ainsi, la force de l’antisémitisme au sein des masses paysannes et ouvrières a mis les bolcheviks à l’épreuve non seulement en 1917, mais surtout au moment de la guerre civile et de son extension en Russie occidentale et en Ukraine. Comme l’écrit Brendan dans son introduction : « [s]ur le terrain, les catégories de la lutte des classes se sont parfois développées sous des formes sur lesquelles les bolcheviks n’avaient aucun contrôle. » L’exemple le plus parlant réside sans aucun doute dans le récit que fait Brendan des pogroms commis par l’armée rouge, bien que celle-ci soit l’armée qui ait commis le moins de pogroms. Brendan décrit notamment, sans jamais sombrer dans l’anticommunisme le plus schématique la difficile intégration des recrues juives de l’armée rouge et le parcours que celles-ci devaient traverser.
La Révolution russe constitue donc un cas d’école d’une révolution dont les sujets — les masses ouvrières et paysannes russes, mais également les minorités nationales — n’étaient pas « politiquement pures ». Mais au-delà de ce seul cas historique, cette étude questionne plus largement l’attitude du parti — ou du moins du mouvement — qui entend lutter pour et avec ce sujet révolutionnaire. Cela pose la question de savoir comment la gauche radicale ou l’antiracisme politique doivent lutter avec des personnes qui peuvent être : racistes, sexistes, être imprégnées de sentiments chauvins, etc. Pour prendre un exemple contemporain – même si je ne compare, bien évidemment, pas cet événement à la Révolution de 1917 – j’ai été extrêmement marqué par le fait qu’une large partie de la gauche française n’ait pas immédiatement soutenu les Gilets Jaunes, ceux-ci étant principalement perçus comme racistes ou réactionnaires, mais pouvait-il en être autrement dans un pays aussi raciste que la France ? La question majeure qui se pose est donc toujours la même : que faire ? Faut-il tout simplement ignorer ces manifestations spontanées de racisme ? Faut-il, au contraire, éduquer les masses, leur apporter la conscience politique de l’extérieur ? Ou faut-il, percevoir la politisation comme un processus complexe, se formant et évoluant par la lutte (bien que cette évolution n’ait aucunement un caractère mécanique) ?
Cette question n’est bien sûr pas neuve. Il suffit de se remémorer ce qu’écrivit Lénine en octobre 1916 :
Quiconque attend une révolution sociale « pure » ne vivra jamais assez longtemps pour la voir. Il n’est qu’un révolutionnaire en paroles qui ne comprend rien à ce qu’est une véritable révolution.
(…)
La révolution socialiste en Europe ne peut pas être autre chose que l’explosion de la lutte de masse des opprimés et mécontents de toute espèce. Des éléments de la petite bourgeoisie et des ouvriers arriérés y participeront inévitablement — sans cette participation, la lutte de masse n’est pas possible, aucune révolution n’est possible — et, tout aussi inévitablement, ils apporteront au mouvement leurs préjugés, leurs fantaisies réactionnaires, leurs faiblesses et leurs erreurs.
L’autre aspect extrêmement pertinent dans le livre de Brendan est qu’il montre que cet antisémitisme n’était pas seulement accidentel chez les ouvriers et paysans – en d’autres termes, que l’antisémitisme pouvait être perçu comme anti-hégémonique en temps de crise – mais que celui-ci a, dans certains cas permit de consolider le pouvoir des bolcheviks localement. C’est là l’un des intérêts majeurs du livre le fait de souligner, via une étude historique des plus concrètes, la manière dont une politique révolutionnaire authentique peut se mêler à des préjugés réactionnaires.
Pour prendre un autre exemple, dans son excellent livre Racism, Class, and the Racialized Outsiders, Satnam Virdee montre parfaitement à quel point la formation de la classe ouvrière anglaise a également été une racialisation de la classe ouvrière anglaise. Virdee s’intéresse ainsi aux rapports entre le mouvement ouvrier anglais et ces « parias racialisés » — catégorie qui ne renferme pas seulement les personnes à la peau non blanche, mais également les Irlandais et les Juifs, soulignant ainsi le fait que la race est un rapport social et non un concept figé et anhistorique. J’ai particulièrement en mémoire le récit que fait Virdee de ces immigrés Juifs fuyant les pogroms de Russie — au 19e siècle — et devant faire face à un mouvement ouvrier britannique aux forts relents racistes.
Enfin, le 3e aspect qui m’a particulièrement marqué à la lecture de l’ouvrage de Brendan — c’est également un point qui ressort de certains travaux d’Eric Blanc sur les « marges » de la Révolution russe — est l’importance des minorités nationales en tant que sujets politiques et pas seulement que victimes. La question de la réponse apportée par les bolcheviks à l’antisémitisme est ainsi essentielle. Brendan souligne que, contrairement à ce qui est souvent présenté, cette réponse n’est pas venue de la direction du parti, mais a surtout été le fait de quelques socialistes juifs non bolcheviks. C’est un point extrêmement important que de souligner l’importance que peuvent avoir ce type de groupes — même si ce ne sont pas des mouvements de masse — dans la résolution des contradictions raciales qui traversent le mouvement ouvrier. Ces socialistes juifs, venant de traditions différentes, ont ainsi offert des ressources importantes à l’antiracisme soviétique, même s’ils étaient assez marginaux en tant que groupe. Même si ces socialistes juifs n’étaient pas totalement autonomes vis-à-vis des bolcheviks, on ne peut nier le degré d’autonomie qui leur a permis d’avoir une action efficace dans la lutte contre l’antisémitisme. Comme l’écrit Brendan dans le 6e chapitre du livre :
ces militants ont accru (…) la lutte contre l’antisémitisme de manière séparée du travail du parti
.
Je pense que cet exemple permet d’avoir un cadre historique des plus pertinents pour penser l’importance des luttes autonomes dans l’antiracisme et la différence entre l’autonomie et le séparatisme. Comprenez-moi bien : je ne pense pas que l’autonomie soit, en soi, synonyme d’avancées politiques et stratégiques ni que l’autonomie antiraciste engendre mécaniquement un affaiblissement des contradictions raciales — par ailleurs, ce serait une erreur que de considérer le concept « d’autonomie politique » comme un concept homogène —, mais je suis persuadé que, dans certaines conditions historiques, l’autonomie politique, loin de diviser la lutte, permet une avancée commune. Il est d’ailleurs intéressant que ces socialistes juifs non bolcheviks — bien que proches des bolcheviks — soient venus de la fragmentation de mouvements autonomes juifs. Un bon exemple des attaques auxquelles ont fait face certains de ces groupes est l’accusation, de certains marxistes de l’époque, envers le Bund, accusé d’organiser les travailleurs juifs de manière autonome des autres travailleurs. Loin de considérer cela comme un obstacle à la lutte, il me semble que, dans les conditions de l’époque, cette organisation autonome était une condition de possibilité d’une lutte commune et d’alliances, nécessairement conflictuelles, entre des franges du mouvement ouvrier juif et le mouvement ouvrier « traditionnel ». Comme je le disais plus haut, certains travaux d’Eric Blanc — notamment sur les débats autour de la question nationale au sein de l’Empire tsariste, donc avant la Révolution — montrent des aspects assez similaires. Eric montre très bien que nombre de figures majeures des bolcheviks — au premier rang desquelles Lénine — dont on loue souvent la clairvoyance sur la question nationale, ont été influencées par des socialistes non bolcheviks issus des pays limitrophes de l’Empire russe. Il est évident que les débats, mis en lumière par Eric, entre les bolcheviks et les minorités nationales de l’Empire, n’étaient pas un long fleuve tranquille, mais ils ont eu une réelle influence sur la pensée de nombre de leaders bolcheviks sur cette question. Je pense donc que les divergences et « conflits » qui existent entre les organisations « traditionnelles » de la gauche et certains mouvements autonomes devraient être assumés et acceptés et ne pas être réduits à un obstacle contre une potentielle lutte commune. L’expérience de la Révolution russe nous offre, à cet égard de nombreuses ressources historiques et le livre de Brendan apparaît comme essentiel non seulement aux historiens, mais également aux militants antiracistes comme aux militants de gauche.
Pour conclure, je souhaiterais simplement citer ce que Brendan écrit en guise de conclusion, car je ne vois pas de meilleure manière d’exprimer ce point de vue :
La rencontre des bolcheviks avec l’antisémitisme en 1917 offre une illustration saisissante du fait que l’antiracisme ne découle pas automatiquement d’une politique socialiste (…) La réponse bolchevik à l’antisémitisme a été bien plus efficace lorsque les voix de ces « autres » racialisés de l’intérieur ont été amplifiées et écoutées. Un siècle plus tard, alors que nous faisons face aux dommages causés par le racisme à une politique de classe, la Révolution russe pourrait avoir quelque chose à nous dire quant à la manière dont des idées réactionnaires peuvent s’implanter, mais également comment elles peuvent être combattues.
Salim Nadi