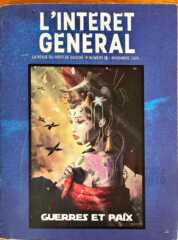Les origines
Mes parents sont nés tous les deux en 1917 dans un pays qui n’existe plus : la Bessarabie. Cette région peuplée en majorité de Roumains avec des minorités turques et juives (séfarades) a été ottomane jusqu’à la conquête russe de 1812. Le tsar a fait venir des populations russophones. C’est ainsi que des Juifs ashkénazes venus des pays baltes et de Biélorussie se sont installés. Pour les attirer, on leur a permis la possession de la terre (ce qui n’existait nulle part ailleurs dans l’empire russe) et l’exemption du service militaire (qui durait à l’époque 25 ans pour les aînés).
L’antisémitisme est une politique d’État dans l’empire russe. Les pogroms débutent en 1881. L’émigration vers l’Europe occidentale et l’Amérique commence. C’est ainsi que mon père aura des cousins aux États-Unis et d’autres en Argentine. Ma famille maternelle vivait dans un shtetl (ces bourgades juives où l’on parlait yiddish) au bord du Dniestr. Ils étaient paysans mais très pauvres. Ma grand-mère paternelle a été une survivante du pogrom de Kichinev (1903).
Comme dans beaucoup de régions de l’empire russe, l’antisémitisme et la prolétarisation des masses juives ont provoqué une perte massive de religion et un engagement assez répandu dans les différents mouvements révolutionnaires. Mon père a été conçu à Saint-Pétersbourg pendant la révolution de février 1917. Sa famille était russophone. Il est né à Akkerman, au bord de la Mer Noire dans une ville où vraisemblablement les Juifs venus du nord s’étaient mélangés à des Juifs ottomans (d’où mon nom : Stambul). Il était l’arrière petit-fils du grand rabbin Rabinovitz d’Odessa, mais mes grands-parents étaient athées.
Au moment de la révolution d’octobre, la Bessarabie est conquise par les troupes roumaines.
Le communisme et le génocide
Entre les deux guerres, la Roumanie est un royaume. Les Juifs forment environ 5% de la population. L’antisémitisme s’exprime de façon décomplexée.
Dans la famille de ma mère, les parents sont religieux et les cinq frères et sœurs sont communistes et bien sûr athées. Leur village, Vertujeni, est situé juste en face du « paradis » : l’URSS de l’autre côté du fleuve. Ma mère quittera l’école assez tôt pour l’usine où elle deviendra une militante active du parti communiste roumain. Elle a fréquenté Olga Bancic (décapitée à la hache en 1944), Ion Maurer (le futur président de la république roumaine) et sans doute Ceaucescu. C’est le parti qui décide son émigration vers la France en 1938. Et c’est parmi les Juifs immigrés du parti qu’elle va trouver son insertion sociale à Paris. Elle parlait yiddish et roumain. Elle comprenait le russe et à peine le Français.
Mon père, fils unique, a été un élève brillant. Il a fait ses études à Galati, au bord du Danube puis, après le baccalauréat, à l’école polytechnique de Bucarest où il étudie la chimie. Politiquement, il passe de l’Hashomer Hatzaïr (un mouvement de jeunes « sionistes de gauche ») au parti communiste, ce qui était à l’époque une évolution classique. Il affronte parfois violemment les fascistes de la « garde de fer ». Son groupe communiste est démantelé par la police roumaine en 1938. Pour lui éviter la prison, mon grand-père achète le juge et tout le groupe est expulsé en France où mon père poursuit ses études de chimie.
En France, l’émigration juive bessarabienne va plonger dans la clandestinité dès le début de l’occupation. Ma mère sera agent de liaison de la MOI (Main d’Oeuvre Immigrée, bras armé des étrangers du PC) à Paris sous un pseudonyme qui n’aurait trompé personne en cas d’arrestation vu son accent.
Mon père sera recruté par le groupe Manouchian. Le groupe était organisé en triangles. Il y a eu un « triangle » Boczor-Glasz-Stambul. Les deux premiers ont été fusillés au mont Valérien, ils sont sur l’affiche rouge. Mon père participera à des actions de déraillement de trains. Le groupe tombe en novembre 1943. Mon père est torturé par la police française et condamné à mort. Il a subi un simulacre d’exécution et a été livré à la Gestapo. Déporté à Compiègne-Royallieu, il a réussi à convaincre les Nazis que Stambul était un nom roumain et que sa circoncision était due à une opération médicale. Il sera déporté à Buchenwald. Sa compagne de l’époque sera gazée dès son arrivée à Auschwitz. Les conditions de Buchenwald étaient très dures, mais mon père n’a livré que des bribes de récit. Il perdra 25 kg en 18 mois de détention.
En mai 1945, ma mère est chargée par le parti d’accueillir les rescapés des camps à l’hôtel Lutétia. C’est ainsi qu’elle connaîtra mon père.
En Europe Orientale, au moment de l’offensive allemande, mes grands-parents paternels auront le temps de partir en Union Soviétique et de fuir (à pied, en charrette, en train, en bateau) jusqu’en Ouzbékistan où ils passeront la guerre. La famille de ma mère (parents, frères, sœur) a disparu sans qu’on sache où et comment : les Nazis ? Les Roumains ? Le shtetl est devenu un camp de concentration, c’est peut-être là qu’ils ont disparu. Le seul qui n’était pas là s’est engagé dans l’armée rouge, a été grièvement blessé à Stalingrad et est mort peu après.
La transmission
Comme beaucoup de rescapés du génocide, mes parents après guerre n’ont eu qu’une idée : se reconstruire, essayer d’oublier, se fondre dans la population française. Les nouvelles reçues d’URSS, le fait que de nombreux résistants qu’ils avaient côtoyés, avaient été arrêtés ou exécutés dans les « démocraties populaires » les ont éloignés progressivement du communisme. Ils ont accueilli avec enthousiasme la création de l’État d’Israël où une partie de la famille s’est établie, certains avant guerre, d’autres à la libération. Mes parents seront opposants à la guerre d’Algérie. Mon père sera au PSU avant de virer à droite en 1967.
J’ai eu une éducation pas seulement athée mais profondément antireligieuse. Je ne suis pas circoncis. Je savais que j’avais des grands-parents soviétiques et que mes parents parlaient parfois des langues bizarres à la maison, mais je ne savais pas que j’étais juif. Un jour (je dois avoir 8 ans), je rentre de l’école et je raconte des choses que j’ai entendues sur les Juifs dans la cour de récréation. Mes parents sont bouleversés. Ils me prennent dans une chambre, rideaux baissés. En une heure, on m’explique tout : l’antisémitisme, les pogroms, les camps d’extermination … Je suis devenu juif.
Ma famille parlait politique sans arrêt et j’ai commencé très tôt à lire Le Monde et Le Canard Enchaîné. Enfant, je suis allé à deux reprises visiter mes grands-parents en Union Soviétique. J’y ai découvert un antisémitisme décomplexé et une société qui n’avait pas grand-chose à voir avec le socialisme.
Mes parents parlaient très souvent des Juifs. Tous les grands scientifiques, écrivains, cinéastes, artistes, journalistes étaient juifs. Mes parents avaient même annexé Charles Chaplin au judaïsme. Ma mère savait même débusquer les Juifs qui avaient francisé leurs noms. Parmi les livres que j’ai lus, il y a « Le dernier des Justes » d’André Schwartz-Bart qui commence au pogrom d’York au Moyen-Âge et se termine à Auschwitz.
Le sionisme
À l’âge de 14 ans, je prends pour la première fois l’avion … pour Israël. Séjour familial au Club Méditerranée. Voyage d’une semaine dans le pays et visites familiales. Je trouve ça superbe : Le Néguev, la Mer Morte, Eilat et la Mer Rouge, Jérusalem. On visite des kibboutz qui (surtout en comparaison avec l’URSS), nous apparaissent comme le vrai socialisme avec leurs cantines collectives et la forme d’éducation des enfants. Le discours sur la beauté du pays, les slogans « du désert nous avons fait un jardin » me plaisent.
Je ne verrai pas d’Arabes. Je verrai un peu les régions frontalières et je partagerai l’admiration pour l’héroïsme des gens qui se défendent contre un ennemi qui veut les jeter à la mer. On ne voit quasiment pas de religieux, sauf à Méa Sharim à Jérusalem et je partage le mépris de mes parents à leur égard.
J’ai 16 ans au moment de la guerre des 6 jours (juin 1967) et je suis en train de passer le baccalauréat. Toute la famille vit cette guerre comme une menace d’anéantissement, une malédiction sur les Juifs, l’idée que les Arabes poursuivent l’œuvre des Nazis.
Sitôt mon bac passé, je pars travailler au kibboutz, à Sde Boqer, le kibboutz de Ben Gourion (que je ne verrai pas) dans le nord du Néguev.
Je suis bluffé. Il me faudra des décennies pour découvrir que les terres de ce kibboutz ont été volées à des Bédouins expulsés.
C’est un kibboutz athée, où je vais dépecer un sanglier (pas vraiment casher) et où on travaille le samedi. Il n’y a pas d’argent. Au magasin, on peut prendre ce qu’on veut, mais on ne prend que ce dont a besoin. Je monte fièrement la garde en pleine nuit (la première frontière est très loin). Je tiens à travailler jusqu’à 13 h alors que la chaleur du désert est déjà terrible.
Bien sûr, je ressens une gène quand un volontaire français qui a émis des critiques est expulsé. Je ne vois pas d’arabe, il n’y en a pas.
Pendant mes courtes permissions, je voyage. Je vois Jérusalem Est et Béthléem qui viennent d’être conquis. Je sens bien que les habitants sont mécontents mais j’évacue ces sensations de ma pensée : ces territoires vont forcément être rendus en échange de la paix, c’est ce que j’imagine.
Je viens à Tel-Aviv pour la bar-mitsva d’un cousin. En fait, avec mon éducation antireligieuse, j’ignore ce qu’est une bar-mitsva. Le père de ce cousin est un général de l’armée de l’air qui a été attaché militaire de l’ambassade d’Israël en France et qui sera plus tard (avec le criminel de guerre Rafael Eitan) un des deux députés du Tsomet, un parti de l’extrême droite « laïque ». Yoash m’explique tranquillement : « nous n’étions absolument pas menacés. Les plans d’attaque étaient prêts depuis longtemps. C’est moi qui ai fait les plans de bombardements de Bagdad et Khartoum. » Et il ajoute : « et tu vas voir, la colonisation va commencer » (je rappelle a posteriori que c’est le travailliste « de gauche » Yigal Allon qui a fait les plans – toujours appliqués – de la colonisation). Dans ma tête, un univers commence à s’effondrer. Moi qui étais venu « sauver mon pays » pour être solidaire contre ce que je croyais être un anéantissement programmé.
La bar-mitsva a lieu à Tsahalla, la banlieue « militaire » de Tel-Aviv. Je serre la main de Mordekhai Hod, général en chef de l’armée de l’air (qui vient de montrer son « efficacité »), d’Ezer Weizman (qui sera plus tard Président de la République). Je serre la main d’un petit gros (probablement Sharon). Et très probablement Eitan et Rabin étaient aussi là.
La fêlure
J’étudie au lycée Louis-le-Grand en plein Quartier Latin en 1968. Je participerai aux « événements » comme on les a appelés : occupation de mon lycée, comité de grève, Assemblées générales, manifestations, barricades, enthousiasme et désillusion. En un temps très bref, politiquement, je passe du « mendésisme » au communisme libertaire. La révolution est devenue à la fois possible et indispensable.
J’avais prévu avant mai 68 de repasser l’été au kibboutz. J’y retourne, mais cette fois le goût est plus qu’amer. Je suis dans un kibboutz capitaliste au pied du Golan occupé. Rien n’a le goût ou l’odeur des barricades parisiennes. J’entends des propos militaristes, racistes, colonialistes, réactionnaires. En plus pendant l’été, l’invasion de la Tchécoslovaquie me pousse un peu plus à croire que l’avenir, c’est la révolution partout : à l’Ouest, à l’Est, en Israël et dans les pays arabes. Je vais sur le Golan et un peu en Cisjordanie, toujours incapable de « voir » l’autre : le Palestinien. Jamais je n’avais apprécié la mentalité israélienne : la « chutspah, » ce mélange d’insolence et de sentiment de supériorité. Même mes parents, devenus depuis la guerre des 6 jours de fervents sionistes (surtout mon père qui a donné beaucoup d’argent à Israël) n’ont jamais supporté cette mentalité et ne se sont jamais posé la question d’émigrer.
La déception fera que je mettrai 26 ans avant de retourner en Israël. Mais la rupture n’est pas vraiment faite. Je constate que, dans tous les combats que je soutiens : au Viêt-Nam, contre l’apartheid sud-africain, contre les dictatures sud-américaines, Israël est dans le mauvais camp. Je soutiens les mouvements révolutionnaires, donc bien sûr je me sens solidaire du FPLP et des Palestiniens massacrés par le roi Hussein lors de « septembre noir ». Je ne saurai que bien plus tard qu’un pont aérien israélien en faveur de ce roi a été décisif. Je suis révulsé quand le Mossad assassine impunément en France Mahmoud Hamchari, représentant de l’OLP. J’aime à me présenter comme « juif palestinien ». En 1973, lors de la guerre du kippour, je suis pour les armées égyptienne et syrienne puisqu’il me paraît normal qu’elles veuillent récupérer leur territoire. Les débuts de la colonisation me révulsent, mais je reste aveugle face au négationnisme d’une Golda Meir pour qui les Palestiniens n’existent pas.
Je vis la victoire électorale de Begin en 1977 comme une catastrophe, oubliant que c’est la « gauche sioniste » qui a expulsé les Palestiniens en 1948 et initié la colonisation. Pour moi, Begin est un fasciste. Mais j’accorde encore plein d’excuses à la pseudo « gauche sioniste ».
Un « outing » qui a tardé.
En 1982, Begin et Sharon lancent leurs troupes sur le Liban. Il s’agit d’écraser l’OLP et de soutenir les fascistes des Phalanges Libanaises. Juste avant les massacres de Sabra et Chatila, j’envoie à une revue culturelle juive nommée « Traces » un texte de colère intitulé « Que reste-t-il du judaïsme ? » que je qualifierais aujourd’hui de « naïf » voire d’aveugle. Je commence par renvoyer dos-à-dos Israéliens et Palestiniens à propos de la guerre de 48. Je pose la question : « comment les Juifs peuvent-ils se conduire comme cela après ce qu’ils ont subi ? » Grossière erreur : les soudards de Tsahal ressemblent plus à ceux qui ont commis le génocide qu’à ceux qui l’ont subi. C’est plus tard que je découvrirai que pas mal de sionistes ont collaboré pendant le génocide nazi.
Mais je souhaite déjà dans ce texte un judaïsme sans sionisme. Je me réclame d’un judaïsme minoritaire et universaliste et je fustige ceux qui (déjà) traitent de « Juifs de la honte » ceux qui critiquent Israël.
C’est l’époque où la colonisation s’accélère. Je soutiens sans réserve Yasser Arafat contre les « extrémistes » de son camp. À partir de 1989, j’écris tous les mois les « brèves internationales » dans la revue « L’École Émancipée » puis, à partir de 2004 dans la revue « Émancipation ». Beaucoup de ces brèves ou des articles plus longs abordent la question juive, l’antisémitisme et la guerre au Proche-Orient. Leur mise bout à bout montre, documents à l’appui, comment a fonctionné le rouleau compresseur colonial.
En 1993, je me réjouis de la signature des accords d’Oslo. En même temps, je fais un voyage familial en Israël/Palestine à l’été 1994 et de façon prémonitoire, je prédis l’échec du « processus ».
Je suis horrifié lors de l’assassinat de Rabin. C’est pourtant lui qui vient d’installer 60 000 nouveaux colons et qui a amené l’armée pour protéger les « fous de Dieu » d’Hébron.
Qu’est-ce qui m’a manqué dans toute cette période ? Je gardais l’idée qu’Israël avait été un « havre de paix » pour les Juifs persécutés. Je ne faisais pas encore la distinction entre les Juifs qui sont arrivés là parce qu’ils ne savaient pas où aller et le sionisme qui, 40 ans avant Auschwitz, a commencé à mettre en place les structures qui allaient expulser les Palestiniens de leur propre pays.
Je ne mettais pas en cause la « légitimité » de l’État d’Israël. Il m’apparaît aujourd’hui clairement qu’on peut le tourner de tous les côtés : la Nakba, l’expulsion préméditée des Palestiniens, l’interdiction qu’ils reviennent et la destruction de leurs villages sont illégitimes.
Il me manquait encore quelques éléments d’histoire : le fait qu’à l’évidence les Juifs d’aujourd’hui ne sont pas les descendants de ceux de l’Antiquité. Ils sont des descendants de convertis de différentes époques et de différentes régions et les descendants des Judéens d’autrefois sont les Palestiniens. Il n’y a pas eu d’exil et il n’y a pas de retour. Il me manquait la compréhension du colonialisme particulier qui a été à l’œuvre.
L’antisionisme
En 2002, c’est la deuxième Intifada. Sharon lance ses soudards sur Ramallah et Jénine. Je décide de faire une conférence intitulée « Les Juifs, le sionisme et Israël ». Je m’attends à une assistance confidentielle et la salle est trop petite. Je croyais dire des choses connues de tout le monde et j’observe la stupéfaction de l’auditoire. Dans mon discours, j’ai une intuition : « pour fabriquer l’Israélien nouveau, il a fallu détruire patiemment le « Juif », l’étranger, le cosmopolite, l’universaliste, l’exilé … » ce qu’on traduit aujourd’hui par « le sionisme est un crime contre les Palestiniens et un suicide pour les Juifs ».
Il me faudra encore un peu de temps pour adhérer à l’UJFP, c’est le J qui m’embête. Au début de mon adhésion, l’idée dominante est « pas de crimes en notre nom », une façon assez narcissique de dire : « nous on est des Juifs propres ». La découverte du Palestinien, de la Nakba, de l’occupation, de l’apartheid, de la cage de Gaza, ce sera plus tard.
Tout le monde n’était pas antisioniste dans le mouvement de solidarité. Je me souviens d’une conférence sur « antisionisme, antisémitisme » en 2006. Des amis avaient affirmé que ce que je disais sur le sionisme était juste, mais que c’était une question d’histoire, sans grand intérêt puisque l’État d’Israël existe.
C’est Michel Warschawski qui conteste cette idée dans la préface de mon livre « Israël/Palestine, du refus d’être complice à l’engagement ». Le sionisme est bien la question centrale. Ce qui est à l’œuvre explique l’écrasement de la Palestine et la destruction de sa société. Si on pense qu’il n’y a pas d’alternative au « vivre ensemble dans l’égalité des droits », on ne peut que refuser une théorie de la séparation et la mise en place d’une société où, selon ses origines ou son identité supposée, les uns ont tous les droits et les autres n’en ont aucun.
Pierre Stambul