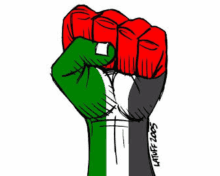Il peut être légitime de se dissimuler derrière un déni de la réalité, le temps de reprendre son souffle après avoir trébuché sur les difficultés de la vie, tant que cette attitude reste temporaire.
Ce déni est un comportement naturel dans lequel se réfugient de temps à autre beaucoup de personnes, même parmi les plus intelligentes. C’est le cas parfois de sociétés entières, quelles qu’elles soient.

Ce déni est un comportement naturel dans lequel se réfugient de temps à autre beaucoup de personnes, même parmi les plus intelligentes. C’est le cas parfois de sociétés entières, quelles qu’elles soient.
Sous l’ombre menaçante du COVID-19, certains à travers le monde ont tout simplement nié l’existence du virus. D’autres ont nié son effet mortel sur l’humain ; des raisons multiples expliquent cela. Car, en plus du besoin d’alléger le sentiment de menace, certains ont préféré leurs intérêts et confort personnels au détriment de ceux de la société. On voit ces personnes nier ou diminuer l’importance de tout ce qui peut entraver leur désir de vivre à leur guise.
Une autre raison de ce déni pourrait être la croyance absolue dans le progrès et la technologie, supposés résoudre n’importe quelle difficulté pouvant surgir.
Malgré le nombre effrayant de personnes contaminées par le virus, la proportion d’êtres humains touchés par la maladie reste limitée. Nous trouvons des quartiers entiers, des villes, qui n’ont pas été touchés et n’ont pas à déplorer un seul décès. Cela procure un faux sentiment de sécurité et d’innocuité de l’épidémie.
Ajoutons à cela la faible confiance dans les gouvernements qui poussent certains à douter de l’importance d’appliquer les gestes préventifs pourtant établis sur des bases scientifiques. Nous les voyons au contraire accorder une confiance absolue à des vidéos Youtube, des images Instagram qui n’ont aucun fondement scientifique.
Sur un plan plus personnel, je ne crois pas m’associer aux gens qui sont dans ces types de déni, malgré ma fatigue et mon épuisement face à la situation sanitaire actuelle.
Je rentre chez moi après des jours de travail exténuants dans les centres d’isolement sanitaire des districts de Cisjordanie, où je soutiens psychologiquement les équipes médicales mises sous forte pression et qui traitent les malades du COVID-19. Je les forme à intégrer et prodiguer le soutien psychologique comme une partie essentielle des soins médicaux destinés aux malades.
Les circonstances sont devenues effrayantes et décourageantes depuis le mois de juin, lorsque les gens ont commencé à éprouver un faux sentiment de soulagement à la fin du confinement. Et l’épidémie a commencé à se répandre de façon transversale, atteignant des chiffres qui se multipliaient d’un jour à l’autre sans que l’on puisse identifier un épicentre de la contagion.
Il ne s’agissait plus d’un voyageur ou d’un ouvrier revenant de l’extérieur – sur lequel nous n’avons aucun contrôle – vers les zones palestiniennes ; revenant à son village, son camp ou encore dans un quartier surpeuplé, où peut se créer un point de départ clair de contamination, facile à circonscrire. Au contraire, le virus est devenu comme un feu d’herbe sèche qui flambe lors d’un mariage ou de funérailles.
Qu’est-il arrivé en Palestine ?
Nous avons traversé la première période aisément. Puis nous avons perdu les rênes lors de l’Aïd al-Fitr, au moment où les recommandations de confinement du gouvernement devenaient plus strictes, mais en même temps incompréhensibles pour les gens, parce que précédées d’un déconfinement complet à la fin du mois de ramadan. Nous avons perdu notre confiance en nous-mêmes et dans les autres lorsque se sont produits des affrontements au Camp de Dheisheh, dans lesquels ont été blessés deux jeunes gens lors de manifestations contre la fermeture des villes et des camps pendant cette fête.
Et se sont alors répandues les théories du complot nourries des menaces israéliennes d’annexer la Cisjordanie, ainsi que le renforcement du déni de la réalité sanitaire et l’indifférence à l’égard des gestes barrières.
Quelqu’un m’a confié : « Le coronavirus est une part importante du ‘deal du siècle’ ». D’autres expliquaient que la distanciation physique avait été imposée pour empêcher les manifestations contre les projets d’annexion de la Cisjordanie, ou pour faire oublier l’arrêt du versement des salaires, ou encore pour pouvoir supplier et obtenir des dons internationaux. Et aussi, que fermer les mosquées était un complot contre les Musulmans dans le but de faciliter la mainmise israélienne sur les deux mosquées : al-Aqsa et al-Ibrahimi.
Et face à cela, les blâmes, les étiquettes et les accusations se sont multipliées contre des groupes bien précis. « Le district d’al-Khalil (Hébron) est dans la provocation », et c’est pourquoi on l’a traité de « Wuhan de la Palestine » ou encore d’ « épicentre de la propagation du virus ». « Les Jérusalémites et les Palestiniens de 48 ont été contaminés et sont donc responsables de la contamination de la Cisjordanie ».
J’ai un ami de Haïfa qui vit à Ramallah et qui transforme son accent lorsqu’il parle aux gens afin de ne pas être rejeté ou harcelé.
La particularité de la situation politique en Palestine occupée alimente le manque de confiance et la théorie du complot dans tous les domaines, et notamment dans la situation sanitaire actuelle. Ce sentiment de malaise généralisé et les aspects contraignants du confinement ont encouragé la dissimulation ou le déni des cas d’infection par le virus et de leurs symptômes, parce que l’on craint de perdre son travail, son business et son argent, ce qui a décuplé la contagion dans l’obscurité.
Là-bas, dans les centres d’isolement que je visite, impossible de nier quoi que ce soit !
Du centre de Dura, par exemple, sortent dans des sacs les dépouilles des pères et des mères, tous les jours. Et il est interdit aux enfants de voir leurs parents, ou de pratiquer les rites funéraires. Ils en sont séparés à l’apparition des symptômes, leur disent adieu en les confiant aux services d’isolement sanitaire, mais espérant les revoir prochainement. Puis les symptômes s’aggravent rapidement chez les plus âgés et les plus fragiles, et pour finir, ils rendent l’âme loin de leurs familles et de leurs amis chers, dans des scènes exceptionnellement douloureuses et bouleversantes.
Je passe un long moment à me laver et à me désinfecter avant de rentrer chez moi et d’être en contact avec mes parents âgés. Et je maintiens avec eux la distance nécessaire. Mais je ne peux maîtriser toutes les causes de mon angoisse.
La contagion peut arriver non seulement par mon lieu de travail dans l’épicentre du COVID-19, mais récemment, la proximité avec le virus a atteint nos cercles sociaux plus intimes : la famille élargie, les amis et le voisinage.
J’écoute tous les matins les statistiques et les nouvelles des recherches sur cette épidémie, espérant la découverte d’une nouvelle piste de vaccin qui annonce la fin de ce fléau.
Depuis le début de cette pandémie, je travaille toute la journée à lutter contre son impact psychologique et à développer un plan national pour répondre aux besoins de santé mentale pendant cette crise. Je traite, en plus du déni du COVID-19, les reproches, les blâmes, les accusations, les colères, l’angoisse et la grande inquiétude dans les centres de quarantaine.
Je soigne aussi les cas de delirium dans les salles de soins intensifs.
Ajoutons à cela la lourde tâche qui m’incombait déjà dans le domaine de la santé mentale avant l’épidémie.
Cette affaire est devenue un défi personnel entre le virus et moi ! Surtout depuis que les aéroports ont fermé leurs portes et que je n’ai plus pu retrouver les gens que j’aime à l’extérieur du pays. Nous approchons aujourd’hui des six mois d’isolement et d’éloignement : sans retrouvailles, sans embrassades, sans rapprochement. Les rencontres par écrans interposés n’étanchent pas ma soif et l’éloignement contribue à ma fatigue émotionnelle actuelle.
La pandémie occupe la plus grande partie de mon temps et de mon esprit, et cela depuis la première semaine de mars. Les douleurs des malades, l’exténuation des soignant·es, l’éloignement des êtres chers ont failli éteindre la flamme dans mon cœur et me réduire aux comportements automatiques et à un état d’anesthésie
Des collègues m’ont raconté aujourd’hui, au centre d’isolement médical de Dura, l’histoire de ce jeune homme d’al-Khalil, Jihad al-Souaiti, qui a grimpé au dernier étage de l’hôpital pour voir partir par la fenêtre sa mère, frappée par le virus, et lui dire adieu dans ce qui sera les derniers moments de sa vie.
Ce récit a profondément touché ma conscience et m’a libérée de mon état d’anesthésie.
Je comprends le besoin, parfois, de nier en partie les situations les plus sombres, et je réalise qu’une petite lueur ou un peu d’espoir sont capables de nous transporter de la situation de déni vers l’acceptation et l’action intelligente et responsable face à la réalité que nous vivons.
Tout s’éclaire à nouveau, et l’espoir renaît grâce à ces récits qui nous réchauffent le cœur, comme celui évoquant l’histoire d’amour entre Jihad et sa maman.
Et je suis certaine que l’amour entre nous, humains, survivra au néant de cette épidémie.