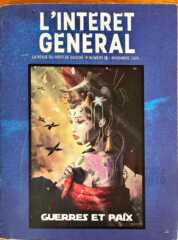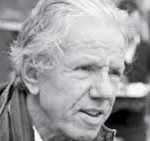Texte de Jean Moïse Braitberg
« Piotcouf ». J’entends encore mon père prononcer ce nom sonnant comme un éternuement. Le train de Varsovie a mis deux heures pour s’y rendre. Un vrai train avec des compartiments mais pas de voiture bar. Les autorités savent trop à quoi peut s’adonner le Polonais quand, de sa fenêtre il voit défiler l’armée triste des bouleaux sur la plaine gelée. « Piotrkow Trybunalsky ». Tout est gris dans la ville où est né mon père : le ciel, le ciment gercé des trottoirs, les façades lépreuses, la mine des gens, l’odeur âcre de coke qui minéralise l’atmosphère.
Tout est de ce gris qui se faufile entre le noir des nuits de cauchemars et la cruelle lumière que jette la mémoire partout où se posent les yeux. Sur les murs de la ville, les membres d’un club de supporters ont tagué des étoiles juives qu’accompagnent des initiales que je ne comprends pas. A la synagogue, transformée en bibliothèque depuis 1967, une souriante jeune femme m’ a dit qu’elle avait honte. Mais il paraît que ça n’a rien d’antisémite. Ces inscriptions seraient l’oeuvre de supporters de foot en bisbille avec un club rival dont le fondateur aurait eu des origines juives. Je voudrais tant croire que les Polonais d’aujourd’hui ne sont plus ces incorrigibles antisémites catholiques fanatiques brutaux et stupides auxquels mon père a préféré la légion étrangère quand on lui a demandé de rejoindre l’armée polonaise en exil en France. Même si je reconnais que le pape polonais a fait beaucoup pour que ses compatriotes aient un autre regard sur les juifs, cela me fait drôle de voir ces graffitis sur les façades d’immeubles ruinés où mes oncles, mes tantes et mon grand-père ont été parqués dès octobre 1940. Ce fut le premier ghetto juif de Pologne. Les allemands y avaient parqués les 15 000 juifs de Piotrkow, rejoints par plus de 10 000 autres, raflés dans les villages environnants. Ma famille a pu survivre jusqu’à la liquidation du ghetto en juillet 1943, avant d’être expédiée vers les hauts lieux du tourisme nazi : Buchenwald, Auschwitz, Ravensbrück… Plusieurs ont survécu parce que c’étaient de « bons travailleurs » aurait dit ma tante qui sans le vouloir avait adopté la terminologie de ses bourreaux. Parce qu’aussi l’un de mes oncles était dans la police juive. Parce que l’officier allemand chargé des sélections aimait bien ma tante qu’il aurait voulu emmener en Allemagne avec lui…
Derrière les façades de l’ancien ghetto juif de Piotrkow vit à présent une population misérable d’éternels déplacés, déclassés, dépassés. La mondialisation, le capitalisme, la modernité, l’Europe se heurtent ici au mur invisible de la terreur et de la mort : une muraille de cris, de sanglots, de respirations courtes, de sueurs froides, de soupirs, de frissons, de hulements nocturnes, de souffles retenus, d’expirations dernières dans laquelle peut-être s’ouvrirait une brèche si un monument rompait le silence. Mais la ville de Piotrkow qui se mure dans le non dit est comme un violon sans âme. Elle ne résonne plus, ne vibre plus. L’absence des juifs est sa substance même. Sauf à l’étage de la bibliothèque où, entre les rayonnages un pan de mur conserve le décor de l’arche sainte criblé d’impacts de balles. Dans un silence assourdissant, le souffle du Peuple du Livre hante ici tous les livres.
Pour me rendre au cimetière juif, rue Spacerowa, je marche interminablement dans un paysage lunaire de façades décrépies, de trottoirs défoncés, de fenêtres obturées par des briques ou des planches. Je croise les silhouettes sans regard d’âmes mortes fondues dans l’épaisse grisaille d’un temps qui, ici ne passe pas. Un jour à l’haleine froide s’effiloche en vapeur nacrée teintée de sang sur la crête sombre des toits. Normalement le cimetière ferme à 16 h. Mais à 15h il est déjà trop tard. Décidément ils n’ont rien perdu de leurs habitudes communistes ces incapables ! Et puis qu’est-ce qu’ils en ont à faire des juifs ? Et puis qui peut bien venir ici ? Une pancarte, sur le portail indique un numéro de téléphone. Tant pis, ça va me coûter encore la peau du cul, mais j’appelle avec mon portable. Une voix de femme m’apprend dans un mauvais anglais que le cimetière ferme à 15h en hiver. Je m’emporte, l’engueule. Elle me dit de revenir demain. Demain ? Mais je pars demain. Ne comprend-elle donc pas que je suis venu spécialement de France pour voir la tombe de ma grand-mère ? Je ne crois même pas à ce que je dis mais j’y suis tout de même devant ce cimetière. Ca doit bien vouloir dire quelque chose. Je raccroche. Mon regard tente de percer l’ombre. Derrière la grille je ne reconnais pas grand-chose. Ce que je vois me semble plus étriqué que lorsque j’étais venu avec mon père voici vingt ans. Il avait cherché la tombe de sa mère. En vain. Mais il s’était arrêté devant une stèle portant les noms de ses copains, massacrés dans un bois à l’orée de la ville. C’était le jour de Pourim, le carnaval des juifs durant lequel on célèbre la ruse de la belle Esther qui permit à son peuple d’échapper au génocide que projetait l’infâme Aman pendant l’exil à Babylone. Entre les barreaux mon regard se porte vers une triste masure qu’une clôture grillagée sépare partiellement du cimetière. Derrière une fenêtre, près d’un pan de rideau, il me semble voir comme une silhouette. Elle m’observe. Alors je me souviens qu’il y a vingt ans cette maison était habitée par une vieille femme qui faisait office de gardienne. A quelques mètres, dans le mûr de clôture il y a une porte en bois couleur brique. En tournant le loquet je déclenche un concert d’aboiements. Au fond d’une allée, sur le seuil, il y a une silhouette encapuchonnée drapée dans une sorte de peignoir. C’est une femme. Ou plutôt un fantôme de femme. Jadis, le vendredi , le Shabbes goy, le goy du shabat venait allumer les lampes que les juifs n’avaient pas le droit de toucher jusqu’au samedi soir. Cette femme est la veilleuse goy du shabbat éternel des juifs morts de Piotrkow Trybunalsky. A force de les fréquenter elle en a pris le teint. Ses traits doux, pleins de finesse, presque élégants, tranchent avec la misère de son accoutrement. Je lis de la sympathie dans ses yeux. Sa maison est comme un sas entre la vie et la mort. Une sorte de tunnel spatio-temporel entre l’avant et l’après-guerre. Une odeur d’urine, de crasse, de poussière, de graisse froide enveloppe un empilement de valises. Je pense au « Canada », l’entrepôt où l’on entassait les affaires de ceux qui partaient à la chambre à gaz. La veilleuse me tend un papier pour écrire le nom que je recherche. Dans la pénombre il y a un homme. Une trace d’homme. Le fils de la maison sans doute. La cinquantaine sale, édenté, hirsute, pas rasé, il s’habille en bougonnant. Assis à une table qu’éclaire encore un jour mourant j’écris Brajtberg et Guterman. Je ne sais si ma grand-mère , morte d’une obscure maladie à 56 ans un mois après l’arrivée des allemands a été enterrée sous le nom de son mari ou celui de son père. Mais voici une liste. Le papier est maculé de toutes sortes de traces sans être si vieux que ça. Quand j’étais venu avec mon père, en le voyant si triste de ne pas trouver la tombe de sa mère, je m’étais dit qu’il ne serait pas bien difficile de passer une semaine dans ce cimetière pour faire le relevé de toutes les tombes. D’autres que moi l’on fait. Des américains sans doute. Fébrilement je vais à la lettre « B ». B-a, B-e, B-o, B-i, B-r, B-r-a, Brejtberg ! Même mal orthographié, le nom est là. Mon nom. Pour être sûr qu’il s’agit bien de ma grand-mère je vais voir à Guterman. Il n’y a personne. « Jest moja Bactia ! » « C’est ma grand-mère !» Mon maigre polonais enfle sous l’émotion. « Mirek ! « Mirek ! » La femme fantôme appelle en vain son fils. Je comprends qu’il a la flemme de nous conduire à la tombe et je commence à paniquer. Alors je ne sais rien faire d’autre que répéter merci, merci beaucoup, dzenkuje bardzo . Elle comprend mon désarroi. Entre deux étouffements de toux elle dit qu’elle va me conduire. Mais il faut qu’elle s’habille. Dehors le froid nous saisit dans le soir qui s’impose. Autant le cimetière juif de Varsovie semble glorieux, prospère, avec ses stèles en marbre, ses épitaphes polonaises et mêmes ses mausolées à la mode chrétienne, autant celui de Piotrkow est grêle, décharné, venteux. Laissé sans soin par les hommes, oublié par l’histoire, il me paraît noyé dans l’éternité noire d’une mort qui ici est tout sauf paisible. Quant elles ne sont pas brisées, éparpillées, mise en tas, les stèles semblent trembler de froid, si ce n’est de terreur parmi les herbes hirsutes brûlées par le gel. Nous partons vers le fond de l’enclos qui sombre dans la nuit. Ma guide trottine en toussant. Son Mirek, derrière moi, nous a rejoint après avoir bouclés les chiens. Voilà, c’est ici. Enfin, pas tout à fait. Il y a au bout d’une allée un alignement de cinq tombes. Je retiens mon souffle tandis qu’en se baissant la pauvre femme peine à trouver le sien. Elle s’accroupit. Non ce n’est pas celle là… Celle là non plus. Et puis voilà c’est celle-ci ! Ce qui se passe est à peine croyable. La vieille polonaise effleure du doigt, une à une, les lettres hébraïques en saillies dans la pierre, ânonnant en partant de la droite : « Bé-erré-é- i- té-bé-é-erré-gué ». Je suis submergé par un flot de questions. Où cette vieille polonaise a-t-elle appris à lire l’hébreu ? Qui le lui a appris ? Y a-t-il encore des juifs à Piotrkow ? Quelle âge avait-elle pendant la guerre ? Le son qu’elle déchiffre dans la pierre donne quelque chose comme « Brrailletéberrgué ». Mais est-ce vraiment la bonne tombe ? J’ai un doute. Elle me désigne les lettres mais, honteux, je lui fais comprendre que je ne sais pas lire l’hébreu. A nouveau elle se penche pour lire ce qui ressemble au prénom et il en sort un chuintement hésitant entre Hanna et Sarah.
« Channa ? »
-Oui, c’est ça répond-elle.
Je suis arrivé. Le train de mon doute n’ira pas plus loin. Il faut faire quelque chose. Alors je prends photos sur photos. Et chaque clic instille en moi un sentiment d’évidente impuissance mêlée de nostalgie. Une évidence on ne peut plus biblique. Moïse est mort avant de fouler le sol de la terre promise, mais Josué son successeur y a conduit son peuple. Mon père m’avait montré le chemin du cimetière juif de Piotrkow mais c’est moi qui ai trouvé la tombe de sa mère.
Je me suis baissé. Sous les feuilles mortes j’ai ramassé une poignée de cailloux que j’ai posés sur la stèle. Je ne connais pas vraiment le sens de cette tradition juive mais j’imagine que les morts préfèrent la compagnie de pierres qui ne meurent jamais à celle de fleurs qui périssent. La veilleuse a gentiment souri en opinant sous son fichu. Moi qui ne crois en rien j’ai reçu ça comme une bénédiction. Quand nous sommes retournés vers la maison il faisait tout à fait nuit. Elle avait peine à marcher, toussait, s’est arrêtée un instant, souffle coupé, un mouchoir sur la bouche. Je ne savais rien dire d’autre que merci en polonais.
Ce soir j’ai visité la cathédrale Sainte-Marie de Cracovie. Comme dans toute la catholicité les crucifix sont surmontés de l’inscription INRI qui signifie Jesus Nasareti Rex Iudeorum : « Jésus de Nazareth, roi des juifs ». Les Polonais adorent les juifs mais ne le savent pas.