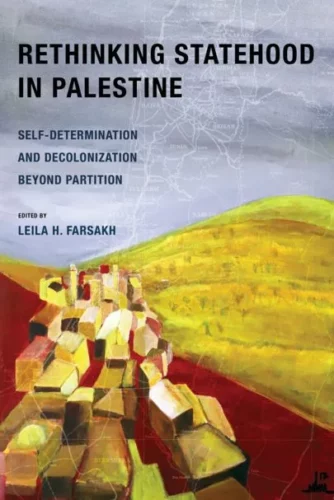Par Leila Farsakh, le 4 mai 2022

Dans son nouvel ouvrage, Rethinking Statehood in Palestine: Self-Determination and Decolonization Beyond Partition, (Repenser la question étatique en Palestine : autodétermination et décolonisation au-delà de la partition), Leïla Farsakh, politologue de Al-Shabaka et professeure associée d’économie politique à l’Université du Massachusetts à Boston, réunit une diversité d’intellectuels qui s’engagent dans la réflexion sur la signification de l’État palestinien. En dépassant la partition, qui est fondamentalement sous-jacente à la solution à deux États, Farsakh et les contributeurs montrent que les composantes de l’État de Palestine dont la citoyenneté, la souveraineté et le statut de nation, doivent être replacés dans le contexte de la colonisation.
Comme l’argumente Farsakh dans l’introduction de l’ouvrage, « décoloniser la Palestine nécessiterait de mettre en place les composantes d’un nouveau cadre politique qui reconnaisse la violence et les injustices du passé et du présent tout en donnant la priorité aux droits attachés à la citoyenneté sur la souveraineté territoriale ». Mais comment l’autodétermination palestinienne peut-elle être envisagée en dehors de la notion de souveraineté territoriale et du statut de nation ? Cela, souligne Farsakh, est une question pendante à laquelle les Palestiniens, où qu’ils soient, vont continuer à faire face.
Avec la mort de la solution à deux États, et l’échec de l’Autorité Palestinienne (AP) à faire triompher la libération et la justice, comment les Palestiniens de Cisjordanie, de Gaza, des territoires de 1948 et de la diaspora peuvent-ils ré imaginer leur autodétermination hors du cadre étatique ? Quelles alternatives existent et quels sont les défis qu’elles peuvent présenter ?
Al-Shabaka a rencontré Farsakh pour échanger sur les conclusions de son ouvrage révolutionnaire et pour creuser ce à quoi ressemble le fait de repenser le statut de nation palestinienne.
Votre livre examine la trajectoire de l’attachement palestinien au modèle étatique comme moyen de libération. Pourquoi cet attachement a-t-il persisté et pourquoi le modèle étatique est-il finalement incapable de faire advenir l’autodétermination palestinienne ?
La façon dont les Palestiniens sont attachés au statut étatique vient du fait que ce statut affirme le droit à l’autodétermination et donc le droit des Palestiniens à définir leur destin politique et à affirmer leur existence en tant que nation. Israël nie ce droit depuis 1948. Le statut d’État est devenu un objectif central du mouvement national palestinien après la guerre de 1967 et la résolution 242 de l’ONU de novembre 1967. Cette résolution, qui est devenue la base du processus de paix entre Israël et ses voisins, stipulait le retrait d’Israël « des territoires occupés lors du récent conflit » en échange de « la reconnaissance de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique de chaque État de la région ». Mais la résolution ne mentionnait pas les Palestiniens ni aucun de nos droits qui sont protégés par les résolutions 181 et 194 de l’ONU.
Puis, en 1971, l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP) a défini ses objectifs d’établissement d’un État palestinien inclusif pour les Chrétiens, les Juifs et les Musulmans dans la Palestine historique. Ce faisant, elle postulait que la seule façon pour les Palestiniens de rentrer chez eux et de libérer leur terre du colonialisme de peuplement sioniste passait par la création d’un État-nation palestinien. À cet égard, l’OLP ne se distinguait pas de la plupart des mouvements de libération du vingtième siècle qui associaient la libération du colonialisme à la création d’États-nation indépendants.
La revendication palestinienne du statut d’État a été soutenue par la Ligue Arabe depuis 1974. Et aussi bien l’Initiative Arabe de Paix de 2002 que la Feuille de Route pour la Paix de 2003 ont affirmé que la création d’un État palestinien indépendant dans les territoires occupés en 1967 était non seulement légitime mais le seul moyen de mettre fin au soi-disant conflit israélo-palestinien.
Mais l’échec du projet d’État palestinien à apporter la libération vient principalement de deux faits. Le premier est l’acceptation par l’OLP du paradigme de la partition, promu par la communauté internationale depuis 1947, comme le seul moyen de résoudre le conflit. En 1988, l’OLP a abandonné son objectif de création d’un État démocratique sur toute la Palestine, au profit d’un État palestinien en Cisjordanie et à Gaza comme déclaration symbolique d’indépendance. Le second facteur est l’acceptation palestinienne de négociations avec Israël sur la base des Accords d’Oslo de 1993, au lieu de se confronter au sionisme et d’exiger, au moins, le retrait complet des territoires occupés par Israël.
Ce “« Processus de Paix » a reformulé plutôt que mis fin à la structure coloniale de domination d’Israël. Il a permis à Israël de placer Gaza sous un siège qui dure depuis 15 ans et de presque tripler la population de colons en Cisjordanie, Jérusalem Est incluse, de 250 000 Israéliens juifs en 1992 à près de 700,000 en 2020. Il a aussi fragmenté l’entité politique palestinienne avec la création de l’AP qui a de fait supplanté l’OLP, compromettant, dans ce processus, la libération palestinienne et le droit au retour. L’État palestinien était alors réduit à n’être ni viable ni souverain, en dépit de sa reconnaissance par 138 États.
Les différents chapitres offrent des alternatives au projet d’État. Quels sont quelques-uns des défis que les Palestiniens doivent surmonter afin d’apporter une alternative viable à la partition ?
Mon livre avance que les Palestiniens doivent s’écarter du paradigme de la partition, de la solution à deux États, dans toute tentative d’accéder à leurs droits. Quelques Palestiniens croient que la poursuite du statut étatique devrait être complètement abandonnée, puisque l’État reste, par essence, une entité politique violente et répressive. Leur argument est qu’au contraire, la politique de sumud (résilience sur le terrain) et de mobilisation à la base affirment l’indigénéité palestinienne. D’autres, dont moi, défendent l’idée que l’alternative se trouve dans la redéfinition de l’État plutôt que d’imaginer qu’il puisse être transcendé. Il faut le comprendre en le rendant démocratique, inclusif et responsable devant ses citoyens.

Le défi auquel sont confrontés les Palestiniens réside dans la définition de la forme de l’État démocratique qu’ils veulent créer et dans la conception d’une stratégie politique qui puisse être soutenue aux niveaux local, régional et international. Le défi, à cet égard, est non seulement juridique et constitutionnel, pour définir si l’État démocratique dans la Palestine historique sera un État fédéral, confédéral, binational ou unitaire, mais, c’est avant tout politique. C’est-à-dire que les Palestiniens doivent formuler comment nous allons élaborer une nouvelle stratégie politique qui unifie notre communauté, y compris les réfugiés et ceux qui vivent à l’intérieur des territoires de 1948. Nous devons aussi articuler les étapes économiques, politiques et juridiques qui doivent être accomplies pour démanteler la structure coloniale d’apartheid qu’Israël a créée, en vue de construire une nouvelle donne politique.
Cela signale la nécessité pour les Palestiniens de se confronter à la question du sionisme, plutôt que d’en faire abstraction comme ce fut le cas avec le processus d’Oslo, et d’expliquer comment Israéliens et Palestiniens peuvent être des citoyens égaux dans un État démocratique. Il y a beaucoup à apprendre de l’Afrique du Sud à cet égard, même si elle n’a pas résolu le problème persistant de l’inégalité économique. Construire un avenir libéré pour la Palestine implique de démanteler les privilèges coloniaux et les structures de domination tout autant que cela implique de définir les droits des Juifs ou des Israéliens qui veulent rester en Palestine comme citoyens égaux, sans les priver de leur identité ni compromettre le droit au retour palestinien qui est protégé dans le droit international.
Dans votre chapitre, vous insistez sur l’importance de réarticuler la relation entre la nation et l’État. Pourquoi pensez-vous que c’est important et qu’est ce que cela signifierait pour l’État dans la Palestine historique ?
Depuis 1918, lorsque Woodrow Wilson a internationalisé le concept d’autodétermination et a jeté les bases d’un ordre mondial composé d’États-nation dans ses Quatorze Points, la nation et l’État sont intrinsèquement liés, alors qu’en fait ce n’est pas nécessaire. L’État-nation s’est avéré problématique, étant donné qu’il est contraint à exclure ceux qui n’appartiennent pas à la nation. Il est inévitablement discriminatoire, en particulier quand il n’est pas démocratique et quand il définit la citoyenneté sur la base de l’ethnicité plutôt que sur les droits résidentiels sur le territoire. Comme le défend Mahmood Mamdani, l’État- nation est partie intégrante du colonialisme. Il produit inévitablement des natifs et des colons, des nationaux et des étrangers, inégaux en droits et en pouvoir.
L’État est fondamentalement un ordre juridique et politique délimité territorialement. La Nation, d’un autre côté, est un terme plus ouvert utilisé pour définir un corps de personnes partageant des caractéristiques, qu’elles soient historiques, ethniques, culturelles ou autres. Le terme de nation comporte aussi le droit d’un peuple donné à l’autodétermination. Ce droit ne nécessite pas de s’inscrire dans un territoire, puisque la souveraineté repose sur le peuple.
La seule façon de décoloniser la Palestine est donc de s’écarter de l’État-nation come modèle d’État ou comme but de la libération. Comme l’a démontré l’expérience des 30 dernières années, la création d’un État palestinien tronqué dans le cadre de la partition a exclu les réfugiés palestiniens et les citoyens palestiniens d’Israël de la définition de la nation palestinienne. En même temps, un tel État n’est pas démocratique et ne peut pas protéger les droits de citoyenneté des Palestiniens de Gaza ou de Cisjordanie. Ce n’est qu’en constituant collectivement un État démocratique qui assure des droits égaux à tous ses citoyens, quelle que soit leur ethnicité, que nous pourrons garantir que les droits des personnes soient protégés et leur liberté assurée.
Vous avez aussi insisté sur le rôle central que pourraient jouer les citoyens palestiniens d’Israël dans un futur projet de libération. Pourquoi pensez-vous qu’il est temps particulièrement pour les citoyens palestiniens d’Israël de prendre la direction du mouvement de libération ?
Le stade auquel se trouve la cause palestinienne aujourd’hui suggère que les citoyens palestiniens d’Israël sont bien placés pour jouer un rôle central dans la direction de la lutte de libération, tout comme les réfugiés aux lendemains de la guerre de 1967 et comme les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza avec la première Intifada en 1987 et lors du processus d’Oslo. Les citoyens palestiniens d’Israël peuvent remplir ce rôle surtout à cause de l’échec de la solution à deux États et parce que l’alternative qui avance est celle de la création d’un État unique démocratique dans la Palestine historique, indépendamment de savoir si ce sera ou non un État binational. Ce sont eux qui peuvent le mieux comprendre les réalités des structures politiques israéliennes. Ils peuvent ainsi combler le fossé entre les Palestiniens et les Israéliens en avançant vers la solution d’un État unique.
Cela étant dit, je ne sais pas si les citoyens palestiniens d’Israël vont prendre ou vouloir prendre la direction du projet de libération. Il est important de se souvenir que tous les Palestiniens ont un rôle à jouer dans leur lutte pour la justice et l’égalité, comme l’a clairement démontré l’Intifada de l’Unité en cours .
Votre livre montre finalement que les Palestiniens de la Palestine historique et en diaspora doivent être d’accord sur un projet national nouveau et collectif. À quoi ressemblerait ce projet et qu’impliquerait-il pour la direction palestinienne actuelle ?
Les Palestiniens de la Palestine historique et dans toute la diaspora sont d’accord sur l’échec de la solution à deux États. Tandis que certains arguent encore que le projet d’État palestinien peut être sauvé en réformant l’AP, il est clair maintenant que le projet d’État en Cisjordanie et à Gaza ne peut pas protéger les droits des Palestiniens et ne sert que les intérêts d’un petit groupe de Palestiniens comprenant l’AP et ses acolytes ainsi que des investisseurs capitalistes internationaux.
Le défi auquel sont confrontés les Palestiniens qui avancent réside dans l’approbation d’un nouveau projet national collectif qui transcende la partition et qui soit politiquement acceptable. Un tel projet ne peut cependant pas être produit sans que d’abord ne soit revitalisée l’OLP et ses institutions, étant donné que c’est la seule structure politique représentative de tous les Palestiniens à l’intérieur et à l’extérieur de la Palestine historique. Pour que cela advienne, une nouvelle génération de Palestiniens doit prendre la place dirigeante de l’OLP et se confronter à l’AP qui a marginalisé l’OLP et abandonné le projet de libération.
Politologue d’Al-Shabaka, Leïla Farsakh est professeure associée et présidente du département de science politique de l’Université du Massachusetts à Boston. Elle est l’auteure de Palestinian Labor Migration to Israel: Labour, Land and Occupation (Routledge, 2012) (la migration de travail en Israël : le travail, la terre et l’État en Palestine) et de Rethinking Statehood in Palestine: Self-determination beyond Partition (California University Press, 2022) (Repenser la question de l’État en Palestine : l’autodétermination au-delà de la partition). Elle a travaillé avec un grand nombre d’organisations, dont l’OCDE, l’Organisation de Coopération et de Développement, à Paris et avec MAS à Ramallah (Institut Palestinien de Recherche en Économie Politique). Elle est responsable de recherches à l’Université de Birzeit depuis 2008. En 2001, elle a remporté le prix Paix et Justice de la Commission pour la Paix de Cambridge.
Source : Al-Shabaka
Traduction SF pour l’Agence média Palestine