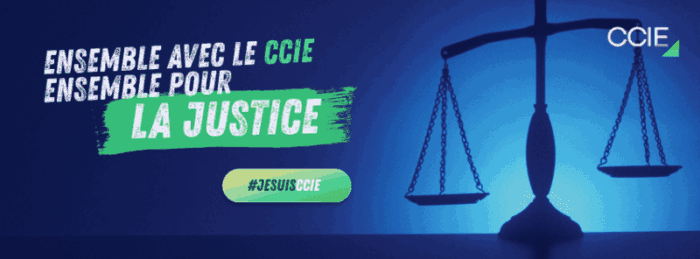5 décembre 2020
Enzo Traverso, historien spécialiste des totalitarismes et du fascisme, revient dans cet entretien sur l’intensification de l’offensive islamophobe et interroge la notion d’ « islamo-gauchisme », utilisée pour délégitimer par avance toute solidarité de la gauche vis-à-vis des musulman·e·s, telle qu’elle avait pu se manifester lors de la manifestation du 10 novembre 2019. Il revient enfin sur les caractérisations des extrêmes droites européennes et du terrorisme djihadiste, en posant la question de l’adéquation du concept de fascisme.
Enzo Traverso est historien, professeur à l’université Cornell aux États-Unis et l’auteur de nombreux ouvrages – dont La violence nazie (La Fabrique, 2002), Mélancolie de gauche (La Découverte, 2016), Les Nouveaux visages du fascisme (Textuel, 2016) – et articles, dont plusieurs sont parus sur Contretemps.

Comment analysez- vous les réactions diverses que l’on observe depuis l’assassinat ignoble de Samuel Paty au sein de la classe politique française ? Alors que Macron avait semblé relativement modéré sur la question de la laïcité lors de la campagne présidentielle en 2017, son gouvernement semble aujourd’hui pris dans une délirante fuite en avant islamophobe, qui se traduit très concrètement avec la dissolution de Baraka City, du CCIF et d’autres associations… Comment expliquez-vous cela ?
Enzo Traverso : Macron est un pur produit de notre époque, l’âge du néolibéralisme « post-idéologique ». Son tournant islamophobe n’est pas le résultat d’une évolution idéologique, simplement un choix lié à des convenances politiques.
En 2017, il est apparu comme l’homme providentiel capable de renouveler un pays paralysé par des vieux clivages obsolètes — c’était son discours modernisateur — et donc de rassembler des forces venant aussi bien de gauche que de droite. Pendant la campagne électorale, lorsque la rhétorique xénophobe était incarnée par Marine Le Pen, il semblait même incarner une nouvelle politique susceptible de rallier au libéralisme — un libéralisme « anglo-saxon », plus multiculturaliste que national-républicain — une large partie des classes moyennes « progressistes » et même un secteur de la jeunesse d’origine postcoloniale.
Aujourd’hui, le contexte a changé radicalement. Le mise en œuvre d’une politique sociale très antipopulaire et la répression brutale des mouvements sociaux — notamment les Gilets jaunes et le mouvement contre la réforme des retraites — lui ont aliéné le soutien de l’électorat de gauche. Du coup, il n’est plus l’homme qui veut dépasser le clivage droite-gauche, mais plutôt l’homme qui veut renouveler la droite. D’où sa nouvelle posture de Bonaparte incarnant la loi et l’ordre et sa nouvelle rhétorique xénophobe : deux messages qui s’adressent, au-delà de la droite traditionnelle, aux électeurs du Rassemblement National.
Une fois épuisée la mythologie de 2017 autour de l’homme de culture à l’Élysée, le philosophe, l’ami de Paul Ricœur, etc., Macron se dévoile maintenant pour ce qu’il est : un politicien qui navigue en pratiquant un machiavélisme de bas étage, en modelant un discours qui change selon ses convenances. Le seul ancrage idéologique solide chez Macron c’est sa foi en l’économie et en la société de marché. Pour le reste, il peut très bien passer de l’antiracisme à l’islamophobie, de la « société ouverte » à l’« ordre républicain », de la France cosmopolite à la France fière de son histoire et de son « identité », de la repentance coloniale à la fierté du passé colonial, comme il vient de faire.
Le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a récemment dénoncé vigoureusement « l’islamo-gauchisme » qui sévit supposément au sein des départements universitaires de sciences humaines en France. Comment interpréter l’essor de cette catégorie, mais aussi un certain nombre de réponses d’intellectuels de « notre camp » qui se défendent de tout islamo-gauchisme ?
Enzo Traverso : Ne vivant pas en France, je ne connais pas toutes les facettes de ce débat. Le concept d’« islamo-gauchisme »a été forgé, il y a quelques années, par le politologue conservateur Pierre-André Taguieff ; il vise à dénoncer une supposée collusion entre l’islam et la gauche radicale antiraciste et pro-palestinienne.
Les médias ont évidemment propagé ce label afin de criminaliser toute politique antiraciste. Il convient parfaitement à un discours xénophobe et autoritaire qui vise à présenter l’islam et la gauche radicale comme les complices objectifs sinon les alliés du terrorisme islamiste. Aujourd’hui, on a franchi un seuil supplémentaire avec le ministre de l’Éducation Nationale qui se fixe comme objectif l’épuration de l’université en donnant la chasse aux « islamo-gauchistes ». L’Europe ne connaissait plus de tels propos depuis les années 1930.
Pour un historien, la notion d’« islamo-gauchisme » rappelle de près celle de « judéo-bolchevisme », qui était un des piliers de la propagande fasciste et nazie pendant les années 1930. Alors comme aujourd’hui, il s’agissait de frapper les ennemis de l’ordre, d’une culture et d’une « identité » nationales définies en termes ethnico-religieux. Les bolcheviks voulaient renverser les institutions, les juifs incarnaient un corps étranger au sein de la nation. Aujourd’hui, les gauchistes s’attaquent aux institutions et l’islam remet en cause l’héritage culturel de la nation.
L’analogie va plus loin. Dans les années 1930, il y avait un grand nombre d’intellectuels juifs dans la gauche radicale, marxiste et communiste, qui avaient perdu tout lien avec le judaïsme en tant que religion. Aujourd’hui, il y beaucoup d’intellectuels et d’activistes d’origine musulmane, dans les mouvements antiracistes et dans la gauche radicale, qui n’ont aucune pratique religieuse, ou qui se reconnaissent comme musulmans — comme le faisaient beaucoup de « juifs athées » dans les années 1930 — par réaction au racisme ambiant.
La pétition parue dans Le Monde contre l’« islamo-gauchisme » dénonce les pernicieuses influences du multicultiralisme anglo-saxon au sein de l’université française. Cette poussée d’antiaméricanisme reproduit un autre cliché du discours raciste des années 1930. A l’époque, on dénonçait l’Amérique cosmopolite, « judaïsée » et corrompue par les cultures noires. Aujourd’hui, on agite le spectre du communautarisme, de l’intersectionnalité et de Black Lives Matter. L’antiaméricanisme est un des traits majeurs des cultures conservatrices européennes. Je ne suis pas un partisan du linguistic turn, mais la façon avec laquelle il est caricaturé par le discours néoconservateur français est assez révélatrice.
Les études postcoloniales apparues avec le tournant linguistique ont déconstruit les Lumières, non pas d’un point de vue réactionnaire, pour les rejeter, selon la tradition du légitimisme européen, mais du point de vue des sujets colonisés. Il s’agissait de remettre en cause l’eurocentrisme et le colonialisme implicites dans la culture occidentale, que le postcolonialisme a étudié essentiellement dans ses dimensions esthétiques et littéraires.
Cette exigence me semble fructueuse, même si je suis loin de partager toutes les conclusions que certains auteurs en ont tirés. Or, le postcolonialisme suggère que pour combattre le terrorisme djihadiste il ne suffit pas d’en dénoncer l’horreur et la violence, il faut comprendre d’où il vient. Certes, il n’y a rien à défendre dans le terrorisme djihadiste, mais il trouve une de ses racines, sous des formes paroxystiques et effrayantes, en ce que Aimé Césaire appelait « un choc en retour » en parlant du colonialisme.
Aujourd’hui, nous sommes confrontés au « choc en retour » d’une trentaine d’années d’occupations et de guerres néocoloniales dans le monde arabe, et aussi au « choc en retour » des politiques de ségrégation sociale et ethnique que la France a pratiqué à l’égard de ses minorités postcoloniales, les Français éternellement « issus de l’immigration ». Or, pour les pourfendeurs de l’« islamo-gauchisme », il est beaucoup plus simple d’affirmer que l’islam incarne l’obscurantisme, que la France est la cible du terrorisme djihadiste car elle est la « patrie des Lumières », et que « expliquer s’est déjà excuser ».
On a vu resurgir, y compris au sein de notre camp, l’emploi du terme islamo-fascisme ou celui de « fascisme islamique ». Est-ce que cela vous semble une catégorie pertinente non seulement pour analyser la réalité du terrorisme islamique contemporain mais aussi pour redéfinir un antifascisme à la hauteur des enjeux actuels ?
Enzo Traverso : Je ne récuse pas la notion d’« islamo-fascisme », mais je pense qu’il faudrait l’utiliser en prenant certaines précautions. D’abord, elle ne s’applique pas au terrorisme islamiste dans le monde occidental. Qualifier de fascistes les massacreurs de Charlie Hebdo et du Bataclan ou l’assassin de Samuel Paty est parfois une réaction spontanée et compréhensible, mais dans ce cas l’adjectif « fasciste » a une signification banale et approximative : le fasciste est un fanatique qui tue et met en spectacle sa violence. Or, le fascisme classique, aussi bien le fascisme italien que le national-socialisme allemand, n’a jamais pratiqué le terrorisme individuel. Leur violence était celle d’un mouvement de masse qui ne se cachait pas.
La comparaison serait plus pertinente entre les fascismes des années 1930 et Daesh avant son anéantissement militaire. Les fascismes sont nés d’une Europe ravagée et brutalisée par la Grande Guerre, dans des pays disloqués, en proie à des guerres civiles, où la politique se faisait dans les rues, avec un langage et des moyens d’actions hérités de la guerre, où chaque parti politique disposait de sa milice et les idéologies se radicalisaient. L’islamisme radical armé est né, depuis les années 1990, dans un monde arabe dévasté par les guerres occidentales et il s’est développé dans certains pays comme une forme de nationalisme sunnite radical. De ce point de vue, la terreur pratiquée par Daesh en Syrie et en Iraq pourrait se comparer à celle des régimes fascistes européens pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Certains analystes (Raymond Aron dès les années 1940) soulignent que les fascismes classiques étaient des « religions séculières », c’est-à-dire des mouvements qui, inspirés par des idéologies laïques, fonctionnaient sur un mode religieux : le soutien qu’ils demandaient à leurs adeptes était davantage comparable à un acte de foi qu’à une adhésion rationnelle. Cela est vrai, mais l’Europe a connu aussi des formes de « clérico-fascisme », comme le régime de Dolfuss en Autriche en 1933, le franquisme en Espagne, dont l’idéologie officielle était le « national-catholicisme », ou encore le salazarisme au Portugal.
Dans tous ces cas, il ne s’agissait pas de « religions séculières » mais de religions traditionnelles qui prenaient une forme politique nationaliste et radicale. Au début des années 1980, dans le Guatemala de Ríos Montt, l’évangélisme a été instrumentalisé au point de devenir l’idéologie d’un régime génocidaire. Donc, pourquoi ne pas reconnaître l’existence d’un « islamo-fascisme » ? Il est une dérivation de l’islam parmi d’autres qui n’ont rien de fasciste, au même titre que la « théologie de la libération » latino-américaine et le « national-catholicisme » franquiste sont deux dérivations antinomiques du christianisme. Si on accepte cette interprétation, on peut par exemple parler d’antifascisme à propos des combattants kurdes du Rojava qui luttent contre Daesh. En Europe, en revanche, la catégorie d’« islamo-fascisme » risque de donner une caution « antifasciste » aux lois spéciales de Manuel Valls et de Gérard Darmanin. Pour résumer ma pensée en une phrase : j’aime les photomontages antifascistes de John Heartfield ; je n’aime pas les caricatures racistes de Charlie Hebdo.
Dans vos textes récents, vous employez la catégorie de postfascisme, comment cela permet-il d’éclairer et d’agir dans la situation actuelle ?
Enzo Traverso : Je ne sais pas jusqu’à quel point la catégorie de « postfascisme » permet d’agir, mais elle me semble utile afin d’appréhender un phénomène nouveau de portée globale : la montée d’une extrême droite autoritaire, raciste et xénophobe qui ne se réclame plus du fascisme. Je l’appelle « postfascisme » car, d’une part, il vient après le fascisme et, d’autre part, il est autre chose. Il s’agit d’un phénomène qui prend des formes très diverses, de l’Europe occidentale aux nouveaux pays de l’UE, des États-Unis à l’Inde et au Brésil, et qui ne s’est pas encore cristallisé en un courant idéologique au profil cohérent et bien défini.
La notion de postfascisme saisit le caractère transitoire de cette constellation hybride et inédite. Elle rassemble des mouvements hétérogènes pour lesquels la définition de fascisme apparaît désormais inadéquate mais qui, en même temps, ne peuvent pas être analysés sans les comparer en permanence à une sorte de paradigme fasciste, celui de l’Europe du XXe siècle. Dans certains cas ils peuvent s’accommoder des institutions actuelles et absorber les forces politiques traditionnelles (en France, les passerelles sont nombreuses entre le Rassemblement National, la droite classique des Républicains, et même plusieurs figures de LREM ; aux États-Unis, Trump a réussi à phagocyter le Parti républicain, etc.).
En cas de crise majeure — par exemple une décomposition de l’UE — ces mouvements pourraient cependant se radicaliser, élargir leur base et obtenir le soutien des élites dominantes. Dans ce cas, ils deviendraient des forces subversives susceptibles de rappeler les fascismes classiques. Nous ne connaissons pas encore leur issue, mais ils contiennent les prémisses d’un fascisme du XXIe siècle.
Propos recueillis par Lucio Nanni.
Voir en ligne : l’article sur le site de Contretemps