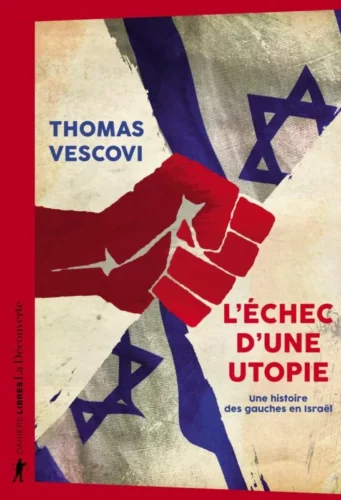Thomas Vescovi est interviewé par Pierre Stambul
Lire sur notre site la présentation de cet ouvrage
Dans ton livre, tu parles de colonialisme, d’apartheid, de suprématisme. Et en même temps, tu utilises le terme « sionisme de gauche ». Il y aurait un apartheid de gauche ou un colonialisme socialiste ?
Le sionisme n’a jamais été monolithique. Dès sa fondation, il a été traversé par plusieurs tendances. Pour certains, le sionisme devait s’allier au capitalisme occidental, obtenir des appuis diplomatiques et se focaliser sur l’achat de terres afin de fonder un État sur des bases libérales.
Pour d’autres, si le sionisme est l’unique moyen de se libérer de l’antisémitisme, l’émigration loin de ces sociétés européennes intrinsèquement antisémites pour s’émanciper doit être l’occasion de réaliser une révolution nationale. Cet idéal d’émancipation et de révolution croise logiquement d’autres idées en Europe, à commencer par le marxisme ou le socialisme. Ainsi va se constituer un projet politique bien singulier : fonder un État pour les juifs sur des bases socialisantes en mêlant nationalisme et socialisme. Sternhell a bien expliqué ce sionisme de gauche : « un nationalisme enrobé de socialisme ».
Sauf que ce projet émancipateur et de gauche n’en n’était pas moins colonial. C’est le cœur de mon récit : au moment où le projet s’enracine en Palestine, lorsque la colonialité est flagrante, comme en 1948 ou en 1967, notamment, comment ces militants ont-ils pu continuer à se définir comme de « gauche » ? Que signifiait pour eux ce qualificatif de « gauche » ?
Le mot « socialisme » est souvent accolé aux kibboutz et au syndicat Histadrout. En quoi ces structures étaient-elles des instruments de la conquête ?
Dans le contexte de l’implantation sioniste en Palestine dans la première moitié du XXe siècle, chaque nouvelle arrivée d’immigrés juifs était une opportunité pour les différentes tendances du mouvement de se renforcer. Si dès les années 1920, le sionisme dit de gauche parvient à contrôler toutes les principales instances juives et sionistes en Palestine (Vaad Leoumi et Agence juive), c’est surtout parce qu’il a su prendre en main et offrir un cadre d’intégration et de travail à ces nouveaux arrivants, grâce notamment à la Histadrout et aux réseaux de kibboutzim.
Le kibboutz a été pensé dès la deuxième moitié du XIXe siècle, lorsqu’un sionisme socialiste est théorisé : libérer les Juifs de l’antisémitisme en les installant sur une terre où ils vivraient en collectivité de manière autogérée. Pris hors sol, le kibboutz peut paraitre un modèle de vie collectiviste fondé sur l’égalité et le partage. Un état d’esprit par essence de gauche. Mais pris dans son contexte en Palestine, le kibboutz devient éminemment colonial : seuls les Juifs y étaient acceptés et leur développement visait à accaparer davantage de terrains.
La Histadrout, pour Association générale des travailleurs d’Eretz Israel, est fondée en février 1919 et organisée en différentes fédérations représentant tous les secteurs d’activités. Il s’agit d’unir l’ensemble des travailleurs juifs de Palestine, mais pas uniquement dans un objectif de défense des droits des travailleurs. L’organisation développe ses propres réseaux d’éducation, ses banques, ses coopératives, ses assurances maladies… La Histadrout permet aux sionistes de gauche de mettre en place toutes les structures fondamentales du futur État et de pouvoir organiser les travailleurs vers un seul objectif : la création de l’État. Ainsi, lorsque l’arrivée d’immigrés juifs dépasse ce que la communauté peut absorber, provoquant la hausse du chômage et des pénuries de logements, une campagne est lancée pour le « travail juif » ou « travail hébreu » afin de faire exclure la main d’œuvre arabe des entreprises juives.
L’étude du vocabulaire est aussi significatif. La dualité n’est pas entre les bourgeois et les prolétaires, mais plutôt entre les « productifs » et les « improductifs », c’est-à-dire ceux qui ralentissent la construction de l’État et sont considérés comme des encombrants, des superflus, voire des parasites. De plus, comme les kibboutz, la Histadrout demeure exclusivement juive. Il faut attendre 1965 pour que les travailleurs palestiniens d’Israël soient acceptés au sein de l’organisation.
Enfin, j’évoque dans le livre un point important. La Histadrout comme les kibboutz ont été des instruments politiques du projet sioniste, afin de s’attirer le soutien et la sympathie des socialistes du monde entier. D’une certaine manière, la direction du mouvement sioniste recevait des fonds provenant du capitalisme occidental, mais la base mobilisait toute son énergie pour camoufler son colonialisme derrière des prétentions socialistes et révolutionnaires, incarnées par l’expérience kibboutznik ou la puissance syndicale de la Histadrout. J’estime que ces deux structures intéressaient moins les dirigeants travaillistes pour les expériences sociales imaginées en leur sein que pour leur capacité à souder et à organiser les Juifs de Palestine. D’autant plus que ces organisations n’avaient qu’une très faible autonomie décisionnelle ou gestionnaire.
À partir de quelle période l’idée qu’il faudrait « transférer » les autochtones a-t-elle émergé chez les sionistes ?
En tant que projet colonial, le sionisme n’avait aucun mal à imaginer des transferts de population. Je date le premier débat « public » à ce sujet, au sein du sionisme de gauche, au moment des émeutes arabes qui secouent la Palestine dans les années 1920. Pour les dirigeants de ce courant, la colère palpable de la population arabe doit faire taire toutes les voix qui, au sein de la gauche juive, appellent à des projets binationaux.
Quelqu’un comme Berl Katznelson, principale figure intellectuelle du sionisme de gauche, débarque en Palestine en 1909 à l’âge de 22 ans. Il commence par défendre la possibilité d’une coexistence avec les Arabes de Palestine. Pour autant, cette vie commune ne peut se faire qu’à condition que ces derniers acceptent le projet sioniste. Pourquoi devraient-ils l’accepter ? Parce qu’il estime que le sionisme est un projet moderne et progressiste dont les Arabes profiteraient. Ceux qui ne le veulent pas seront « invités » à rejoindre les pays arabes voisins.
Au sein du Mapaï, le premier parti uni du sionisme de gauche, créé en 1930, son principal dirigeant, Ben Gourion, défendait l’impossibilité d’un transfert de population, d’une part pour des raisons pratiques (les sionistes demeurant minoritaires) et d’autre part à cause des risques diplomatiques qu’un tel projet pourrait causer.
Par la suite, les propos vont se faire de plus en plus affirmatifs. La Grande révolte arabe de 1935-1936 accélère la conversion des plus indécis vers l’idée d’un transfert des populations. La commission Peel, de 1937, évoque cette idée pour « résoudre » la crise en Palestine. Dans la foulée, le XXe congrès sioniste affirme sans ambigüité qu’un État juif ne peut être viable qu’avec un nombre minime d’Arabes. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le projet est clair : aux diplomates et militants sionistes qui s’interrogent sur la faisabilité d’un État juif dans un territoire majoritairement peuplé de « non-juifs », Ben Gourion répond : « Le sionisme est un transfert des juifs. En ce qui concerne le transfert des Arabes, il est beaucoup plus simple que n’importe quel autre transfert. Il y a des États arabes dans les environs. »
Tu parles dans le livre d’autres forces politiques : les communistes, les partisans du binationalisme. Peux-tu en dire plus ?
L’originalité de mon récit est de prendre en compte l’ensemble des gauches juives en Palestine, sionistes comme non-sionistes.
Les binationalistes représentaient une part non négligeable du mouvement sioniste, et ce jusqu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Leur projet était de prendre en considération les aspirations de la population locale et de penser un projet en commun. Le « foyer national juif » n’est pas envisagé comme un État juif exclusif, mais de faire de la Palestine un centre spirituel d’où le judaïsme pourrait vivre et rayonner.
Les binationalistes ne sont pas parvenus à changer le rapport de force, pour au moins trois raisons. D’abord, Ben Gourion et les sionistes de gauche s’appuyaient sur les informations provenant d’Europe et faisant état de massacres contre les juifs ainsi que sur la colère de la population arabe pour maintenir la communauté juive de Palestine dans un état d’alerte et d’urgence permanent : construisons l’État avant qu’il ne soit trop tard. Deuxièmement, les cadres du mouvement sioniste étaient prêts à s’entendre entre les différentes tendances, dès lors que l’objectif final demeurait l’établissement de l’État juif, sans que cela ne concerne les binationalistes qui vont se trouver, peu à peu, isolés. Enfin, les principales figures binationalistes formaient surtout une élite intellectuelle, sans réel ancrage militant au sein de la communauté juive ni auprès des Palestiniens, rendant leur projet peu crédible.
L’Hachomer Hatzaïr se distingue en rassemblant les militants les plus radicaux et attachés aux principes marxistes au sein du mouvement sioniste. Même après 1945, ses près de dix mille militants, dont deux tiers de kibboutznikim, restent de fervents soutiens du binationalisme. Les choses changent lorsqu’en 1947 l’URSS se rallie au projet sioniste et que l’ONU prévoit le vote du partage de la Palestine. Les différents groupes de la gauche sioniste opposés à Ben Gourion se rassemblent au sein du Mapam (Parti unifié des ouvriers) pour constituer une force alternative. Cette alliance est très hétéroclite et oblige les militants et cadres à s’accorder sur un minimum d’éléments, à commencer par le soutien au projet d’État juif. Cependant, l’organisation reste symptomatique du sionisme de gauche : en pleine Nakba, la direction du parti dénonce certaines expulsions, alors que sur le terrain, les principaux généraux à la manœuvre sont issus de ses rangs : Yigal Allon en Galilée, Moshé Carmel en Haute Galilée, Yitzhak Rabin à Lydda et Ramle.
Pour les communistes, il s’agit principalement de militants qui ont rejoint la Palestine animés par l’esprit du sionisme de gauche. Sauf qu’entre la théorie et la pratique, ils constatent le fossé et refusent l’idée d’un État juif imposée par la force et au détriment de la population locale. Ils vont s’employer à développer des cadres de discussion arabo-juif, avec une volonté de s’extirper d’un statut de colon qui les empêche de faire pénétrer leurs idées au sein de la population arabe. Malgré de nombreuses divisions et fusions, que j’évoque dans le livre, il existe toujours un Parti communiste en Israël, actuellement membre de la coalition Hadash (Front démocratique pour la paix et l’égalité) et de la Liste unie qui compte six députés à la Knesset. C’est une force marginale mais toujours active dans de nombreuses luttes et qui a pu, à certains moments de l’histoire, mettre en marche l’ensemble de la gauche israélienne : lutte contre l’occupation et la colonisation, dénonciation de la guerre au Liban…
Le discours officiel en Israël dit qu’en 1948 « les Arabes sont partis d’eux-mêmes » et que c’était la « guerre de David contre Goliath ». Pour 1967, le discours dit « qu’Israël était menacé d’anéantissement ». Que s’est-il réellement passé ? En 1948, la Haganah et les milices d’extrême droite ont-elles eu des comportements différents ?
Pour 1948, les travaux des « nouveaux historiens » israéliens suffisent pour battre en brèche l’idée selon laquelle les Palestiniens auraient quitté leur terre de leur propre chef. Mais aussi celle, encore très répandue au sein du sionisme de gauche, qui prétend que les massacres contre les populations palestiniennes n’ont été le fait que de groupes juifs dissidents à la Haganah.
Pour 1967, il faut reprendre les propos d’Yitzhak Rabin, alors chef d’état-major. À la veille de la guerre, il affirme qu’elle fera « plusieurs dizaines de milliers de morts » côté israélien, faisant craindre une menace existentielle sur le pays. Et ce alors même que la CIA communique sur un rapport de force défavorable aux armées arabes. Au lendemain de la guerre, le Premier ministre travailliste, Levi Eshkol continue d’affirmer que l’existence d’Israël « ne tenait qu’à un fil ». Il faudra attendre plusieurs années pour que les dirigeants israéliens avouent, à l’instar de Rabin : « Nous n’étions pas menacés de génocide à la veille de la guerre […], et nous n’avons jamais pensé à une telle possibilité. »
La communauté internationale ne porte pas le même jugement sur 1948 et 1967. Elle a légalisé le nettoyage ethnique de 1948 et considère officiellement comme « illégales » les conquêtes de 1967. Ces deux événements sont-ils vraiment de nature différente ?
En 1948, un État d’Israël est créé à partir d’une base très limitée (7 % du territoire de Palestine) mais bien réelle. Un an avant, l’ONU a voté la partition et accordé 45 % à l’État juif. Les troupes sionistes, puis israéliennes, parviennent à conquérir bien davantage de terres dans le cadre de la Première guerre israélo-arabe. Au terme de celle-ci, Israël est malgré tout accepté au sein de la communauté internationale à la suite de la Conférence de Lausanne de 1949, sans pour autant que des frontières ne lui soient attribuées et sans mettre en application son engagement d’autoriser le retour des réfugiés palestiniens. Les pays occidentaux ferment les yeux sur ces violations des résolutions onusiennes pour espérer « réparer » le génocide des juifs sur leurs territoires. En 1967, il s’agit de conquérir les 22 % restants de la Palestine. Si lors des deux guerres la finalité demeure : conquérir, coloniser et occuper, elles ne sont pas de même nature.
En 1948, les combattants sionistes pensent que leur projet d’État est en jeu. Bien qu’ils soient militairement et numériquement supérieurs aux armées arabes, de réelles craintes traversent la communauté juive au moment du déclenchement de la guerre. Il y a aussi un sentiment d’une guerre qui se prolonge : de l’Europe au Proche-Orient, les Juifs doivent se battre pour assurer leur sécurité. Au sein des gauches juives, il y a l’union autour de la guerre. Même les communistes, du fait notamment du soutien soviétique, participent et sont animés du sentiment d’être du bon côté de l’histoire, celui de la révolution progressiste.
En 1967, les opérations ont été longuement préparées et il ne s’agissait aucunement d’une « lutte pour l’existence », à la rigueur une forme de guerre préventive contre des pays voisins aux velléités trop prononcées. D’où les premières formes de condamnation et de critiques, dès la fin de la guerre, au sein de la communauté internationale et en Israël même avec les prémices de groupes anti-occupation.
Concernant les gauches, la guerre des Six Jours place les questions de colonisation et d’occupation au cœur des débats. Peu à peu, ces problématiques remplacent celles liées à 1948, notamment le droit au retour des réfugiés ou les expulsions et les massacres commis contre les populations civiles. À partir de 1967, quiconque maintient dans ses priorités la question des réfugiés se voit pointer du doigt comme un radical ou un extrémiste. L’ensemble de la gauche sioniste, et avec elle une partie des communistes, se met à croire que la paix passera essentiellement par la fin de la colonisation et de l’occupation.
Le sionisme « socialiste » a été hégémonique jusqu’en 1977. Comment et pourquoi est-il devenu de plus en plus minoritaire. Pourquoi a-t-il été incapable de capter le vote des Juifs orientaux ?
Dans les années 1950 et 1960, Israël accueille des centaines de milliers de Juifs dits orientaux, originaires de pays arabes : Irak, Maroc, Yémen… Ben Gourion et les sionistes de gauche veulent les « révolutionner culturellement », à savoir les détacher de leur culture arabe, maitriser leur pratique religieuse et les convertir à un mode de vie proche de ceux des Juifs européens.
Arrivés dans un pays qu’on leur présente comme celui des « Juifs », ces nouveaux immigrés n’ont pas la même conception du judaïsme que la majorité juive ashkénaze, pour qui la synagogue doit être séparée de l’État. À cette première incompréhension s’ajoute les humiliations subies : de nouveaux vêtements, « occidentaux », leur sont imposés, et ils sont entassés dans des camps de transit aux conditions de vie dégradantes, et situés bien loin des zones d’emplois. Des milliers d’enfants yéménites sont séparés de leurs parents, au motif de vaccination, puis déclarées morts. Si certains sont effectivement décédés, la majeure partie est placée au sein de familles juives ashkénazes.
Pour accéder à l’emploi et bénéficier d’une stabilité sociale, les immigrés sont « invités » à adhérer à la Histadrout. Étrangers à ces pratiques, les Juifs orientaux sont pour la première fois discriminés non du fait de leur religion, mais du fait de leur culture, leur couleur de peau ou leur origine. Dès lors, ils vont cultiver une rancœur contre les « laïcs » du sionisme de gauche au profit d’un ralliement massif à la droite nationaliste représentée par le Herout (Liberté), ancêtre de l’actuel Likoud. Ainsi, c’est notamment grâce au vote des Juifs orientaux que Menahem Begin devient Premier ministre en 1977, permettant à la droite sioniste de prendre le pouvoir.
Je reviens dans le livre sur la tentative d’une révolte de gauche des Juifs orientaux, incarnée par les Blacks Panthers d’Israël au début des années 1970. L’échec et la répression du mouvement par le pouvoir travailliste a aussi participé à la rancœur de cette communauté contre la gauche.
Yitzhak Rabin a signé avec Yasser Arafat les accords d’Oslo en 1993. S’agissait-il d’un compromis fondé sur la justice et l’égalité des droits ? Ces accords impliquaient-ils la fin de l’occupation et de la colonisation ? Ou ont-ils été une mystification ?
Ces accords n’impliquaient pas la création d’un État palestinien indépendant au côté d’Israël. La première intifada fit prendre conscience aux dirigeants israéliens de l’impossibilité pratique de maintenir un contrôle et une occupation au sein d’immenses villes palestiniennes, comme Gaza, Ramallah ou Naplouse. Dès lors, l’objectif était de déléguer certaines compétences à une autorité palestinienne, sans pour autant perdre la gestion globale. Aux Israéliens, il a été vendu le projet d’une séparation à l’amiable : « Eux chez eux, nous chez nous. ». Là où Arafat espérait qu’au terme de ces accords il dirigerait un État en pleine possession de ses moyens, il se retrouve à jouer le rôle de proxy pour l’occupant israélien. À ce titre, je recommande la lecture du livre de Khalil Tafakji, géographe et membre de la délégation palestinienne lors des négociations, sorti l’an dernier chez La Découverte.
J’évoque assez longuement dans le livre les débats au sein de la gauche sioniste qui conduisent à accepter les négociations avec Arafat, ainsi que l’évolution de mentalité de Rabin. Cependant, cela n’est jamais allé au point de prendre en considération les aspirations du peuple palestinien. D’un intérêt exclusivement juif par tous les moyens, le sionisme de gauche est passé à un dialogue avec les Palestiniens pour assurer des intérêts exclusivement juifs.
Cela voulait-il dire que les militants du camp de la paix n’étaient pas « pacifiques » ? Je ne crois pas et je pense qu’ils y ont vraiment cru, mais à partir de leurs propres intérêts. C’est ce qu’expliquait Uri Avnery, premier israélien à avoir rencontré Arafat et électron libre de ce camp de la paix. Il percevait ses compagnons de lutte comme divisés entre deux ailes : sentimentale et politique.
L’aile sentimentale, majoritaire, rassemblait des individus focalisés sur les questions internes à Israël. Ils étaient essentiellement préoccupés par des questions morales, ils s’inquiétaient avant tout de l’image qui était donnée d’eux et de leur pays à l’étranger. Dans ce schéma de pensée, les Palestiniens ne leur servaient que d’objet de mise en valeur de leur image morale et n’ont jamais été considérés comme des partenaires égaux.
À l’inverse, l’aile politique considérait que la paix passait par une prise en compte réciproque des aspirations, des sentiments, des craintes et des espoirs du peuple palestinien.
Ainsi, dès la victoire de Rabin et l’ouverture du processus d’Oslo, l’aile sentimentale s’est mise en veille pensant que la victoire était déjà prononcée, faisant passer l’aile politique, qui continuait à militer et à faire pression sur les travaillistes, comme des radicaux. Et arrive l’assassinat de Rabin puis le déclenchement de la seconde intifada, bien plus meurtrière et militarisée, qui va traumatiser les deux sociétés.
Comment peut-on expliquer que les animateurs de « La Paix Maintenant » aient approuvé les attaques contre Gaza et le Liban ?
Il faudrait le leur demander. Pour ma part, cela rejoint l’analyse évoquée dans le livre de la secrétaire générale de La Paix maintenant, Gaby Lasky, faite au moment de la seconde intifada. Pourquoi n’arrivait-elle pas à mobiliser son organisation ? Elle parle d’une « sincère incompréhension » de ses militants face à la révolte palestinienne. Une « incompréhension » qui résultait, d’après elle, de deux choses.
D’abord, son camp était empli d’illusions au moment du processus d’Oslo : l’arrivée au pouvoir de Rabin était signe de paix et il n’y avait plus à militer, la droite avait perdu. La dégradation du contexte politique, entre attentats-suicides palestiniens et manifestations de la droite, était perçue comme une réaction de ceux qui ne voulaient pas de cette paix. Mais à cela s’ajoute le deuxième point lié à l’ignorance complète du quotidien des Palestiniens. Certains croyaient, au sein de la gauche sioniste, qu’Israéliens et Palestiniens négociaient d’égal à égal, incapables de percevoir qu’il y avait un colon et un colonisé, un occupant et un occupé, et surtout un peuple dans l’urgence. Massivement emprisonné, humilié et harcelé quotidiennement par l’armée israélienne ou les colons, le peuple palestinien voyait également sa terre davantage accaparée alors que les négociations s’appesantissaient.
Dès lors, les attentats-suicides, la révolte armée ou l’envoi de roquettes ne sont pas perçus par les Israéliens comme des « signaux d’alerte » d’une situation invivable mais des symboles d’un refus palestinien de pacifier les relations. Cela explique comment une personnalité comme Ariel Sharon parvient à s’imposer à la tête de l’État : la séparation à l’amiable n’ayant pas fonctionnée, elle sera imposée par la force et uniquement selon leurs propres intérêts.
À tout cela s’ajoute la rhétorique israélienne mise en place depuis les années 2000 : Israël ne se battrait plus pour son existence, mais serait l’avant-garde de la lutte contre le terrorisme islamiste, où le Hamas et le Hezbollah convergeraient avec Al-Qaïda et plus récemment Daesh. Cette matrice se retrouve aussi au sein de la gauche sioniste voire, à un certain degré, de La Paix maintenant pour qui l’essentiel n’est pas de proposer un discours alternatif mais de montrer aux Israéliens qu’ils restent, derrières leurs visées « pacifiques », patriotes et prêts à rentrer dans le rang lorsqu’une menace se fait sentir.
Les travaillistes qui ont initié la colonisation ne portent-ils pas la responsabilité de l’émergence du courant nationaliste religieux ?
Dans le livre, je reviens assez longuement sur les débats au sein de la gauche sioniste après la conquête des territoires. Si certains cadres proposent d’édifier un État arabe aux côtés d’Israël, ou de se retirer préventivement des territoires conquis, comme Ben Gourion, une majorité prône la politique du fait accompli : coloniser et exploiter ces terres en l’absence d’une volonté de paix des pays voisins. Les territoires conquis serviraient de « monnaie d’échange ». C’était une illusion car ces dirigeants ne mesuraient pas l’impact de cette guerre sur Israël et sa société.
Revenons d’abord sur ce qu’est Israël entre 1948 et 1967. L’économie est en grande partie contrôlée par l’État, avec un large secteur public. Le taux de syndicalisation oscille à 80%. Pour la vieille garde du sionisme de gauche, cette période correspondrait au « vrai socialisme israélien ». La guerre de 1967 amène différents changements. Économiquement, la Cisjordanie et la bande de Gaza offre à l’économie israélienne une main d’œuvre malléable et bon marché. Parallèlement, l’opposition de la France du général De Gaulle aux opérations israéliennes modifie le jeu diplomatique : les États-Unis remplacent la France comme premier partenaire et fournisseur d’armes. Ce changement d’allié accélère l’entrée de l’économie israélienne dans l’économie de marché.
L’autre bouleversement se fait dans les mentalités. La victoire sur les armées arabes et la conquête des 22 % de ce qui restait de la Palestine historique, ravive l’élan messianique chez bon nombre de Juifs, y compris à gauche. Le seul cas de Jérusalem est significatif. Le 14 juin 1967, ce sont 250 000 Israéliens qui se pressent au Mur des Lamentations pour célébrer la fête juive de Chavouot. Quel dirigeant israélien pouvait et peu après cela prétendre sincèrement être prêt à restituer totalement ces territoires aux Palestiniens ?
La colonisation des territoires conquis, qui débute en même temps que l’occupation se met en place, fait naitre une réaction anticoloniale et anti-occupation, au sein même d’Israël. Des militants et cellules politiques auparavant isolés ou divisés se rassemblent dans ce nouveau terrain de lutte qui paraît primordial : anarchistes, trotskystes, maoïstes, communistes expulsés ou en scission du Parti… Le symbole est l’Organisation socialiste en Israël, plus connu sous le nom de son journal, Matzpen. Pour ces militants, le sionisme de gauche ne peut plus se cacher derrière un paravent socialiste : alors que le colonialisme ne revêt plus le moindre caractère positif dans les milieux progressistes, la colonialité d’Israël sous l’égide du sionisme de gauche est à son paroxysme. De plus, la toute-puissance militaire israélienne pose la question de son intégration au Moyen-Orient et de ses relations avec ses voisins : tant que la guerre sera son seul outil diplomatique, Israël ne connaitra pas la paix.
Cette gauche juive anticoloniale va sévèrement être réprimée, notamment pour ses liens avec les mouvements de résistance dans les territoires occupés. Il faut attendre l’arrivée au pouvoir de la droite, en 1977, pour qu’au sein de la gauche sioniste se libère un discours critique contre la colonisation et l’occupation, avec la création de La Paix maintenant en 1978. Dès lors, la gauche sioniste se recompose, peu à peu, autour d’un nouveau vocable prônant une « solution à deux États dans les frontières de 67 ». Je suis critique de ces historiens ou universitaires qui traitent du « camp de la paix » en se cantonnant à sa partie sioniste, oubliant que les précurseurs étaient de l’autre gauche, celle anticoloniale.
Ceci dit, en se centrant sur une volonté d’accord de paix avec les Palestiniens, la gauche ouvre la voie à un retrait des territoires et à des négociations avec l’ancien ennemi. À l’inverse, la droite nationaliste se construit en totale opposition appelant à une poursuite de la colonisation considérant les territoires conquis en 1967 comme des « terres juives libérées », et de l’occupation pour des raisons de stratégie militaire.
Mais qui a conquis ? Qui a organisé l’occupation ? Qui a colonisé ? Lorsque Begin arrive au pouvoir en 1977, il y a déjà (ou seulement) 4 400 colons en Cisjordanie, et d’autres centaines dans le Sinaï. La droite va ouvrir les vannes en lançant la construction d’une centaine de nouvelles colonies dans les semaines qui suivent sa prise de pouvoir, coopérant avec les organisations religieuses et messianiques.
De plus en plus, les opposants à la colonisation et à l’apartheid en Israël rompent avec le sionisme, à l’image d’Abraham Burg. La marginalisation des héritiers de Ben Gourion ou du Mapam est-elle définitive ? Le basculement majoritaire de l’opinion israélienne vers le colonialisme et le racisme est-il inéluctable ?
Si je conclus à l’échec du sionisme de gauche, c’est parce que j’estime qu’il y a des raisons structurelles à la droitisation de la population juive. Dans une enquête de l’Institut pour la Démocratie en Israël, réalisée en février 2020, 69,9% des Juifs israéliens âgés de 18 à 25 ans se définit comme « de droite ». En septembre 2019, seuls 41% des enfants israéliens ont fait leur rentrée dans une école publique laïque, alors qu’ils étaient encore majoritaires, il y a moins de dix ans. Électoralement, la gauche sioniste a réalisé les pires scores de son histoire, avec sept députés en 2020 et treize en 2021. Comprenez : en 1949, la première Knesset compte 71 députés de gauche, quand celle de 2021 dénombre 72 députés de droite ou d’extrême droite. Je ne crois pas que ce basculement puisse s’inverser.
Désormais, Israël est un État profondément libéral, avec une large partie de la population qui place la défense des valeurs religieuses et de l’État juif au sommet de ses priorités.
Dans ce contexte, il me semble qu’il ne reste à la gauche israélienne comme issue qu’une réinvention au profit d’une alliance avec les Palestiniens. Tant qu’elle refusera cette mutation, elle devra, à chaque élection, combiner avec l’extrême droite pour former un gouvernement et se cantonner à un rôle de variable d’ajustement gouvernemental, juste bon à soutenir un candidat du centre pour être Premier ministre.
Pour cela, il faudra à cette gauche sioniste dépasser son attachement presque viscéral à la défense de l’État juif au profit d’un État pour tous ses citoyens. Sinon, les débats continueront à se focaliser sur la forme de l’État juif, à savoir laïcs ou religieux, où le centre rassemble désormais une large part du camp juif progressiste désireux de chasser les religieux du pouvoir. Si vous étudiez une carte électorale, vous verrez que les bastions historiques de la gauche sioniste tendent de plus en plus vers le centre, à l’instar de Tel-Aviv et de certains kibboutz.
Enfin, il faut constater la synergie de l’ensemble des organisations sionistes concernant la Palestine. Si des oppositions persistent sur l’annexion, seul le Meretz continue d’incarner une parole hétérodoxe au sein du champ sioniste qui s’est complètement rallié à l’idée que la colonisation peut progresser et que l’occupation demeurera. Dès lors, pourquoi l’électeur israélien interrogerait l’idée d’une Cisjordanie désormais israélienne ? Aucun discours alternatif au tout colonial et sécuritaire n’est porté par la gauche travailliste. Pis, elle continue d’espérer récolter des voix parmi les 660 000 colons alors qu’ils constituent la principale réserve de voix de l’extrême droite, au détriment d’une volonté de comprendre les aspirations du peuple palestinien.