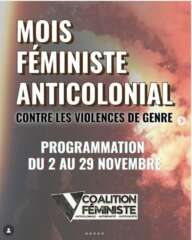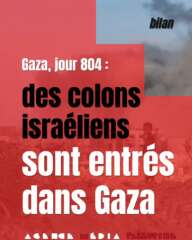Il n’y a qu’un 8 mai 1945 : une date unique, mais dont l’histoire s’écrit en plusieurs récits. Si, en France et dans la plupart des pays d’Europe, le 8 mai marque la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin des combats en Europe, célébrée chaque année par des hommages officiels et des commémorations publiques, cette date revêt une tout autre signification pour d’autres populations, notamment en Algérie, alors colonie française.
Dès 1939, la France mobilise massivement les hommes issus de son empire colonial pour combattre l’Allemagne nazie. Près de 340 000 soldats coloniaux sont affectés aux armées françaises au début du conflit, dont 70 000 d’Afrique du Nord et entre 40 000 et 65 000 d’Afrique subsaharienne engagés lors de la campagne de France en 1940. Les troupes coloniales sont composées de tirailleurs sénégalais, maghrébins, malgaches, indochinois, antillais, réunionnais, et d’autres originaires de l’ensemble de l’empire français. L’armée coloniale représente alors plus d’un quart des effectifs français mobilisés pendant la guerre.
Mais le 8 mai 1945, alors que l’Europe exulte, une autre histoire se joue en Algérie. Ce jour-là, des manifestations pacifiques sont organisées à Sétif, Guelma, Kherrata et dans la région par des militants nationalistes algériens, notamment les Amis du Manifeste et de la Liberté (AML) et le Parti du Peuple Algérien.

À Sétif, la police tire sur les manifestants qui brandissent le drapeau algérien, interdit à l’époque, tuant un jeune homme, Saal Bouzid, et déclenchant une vague de violence.
La répression qui s’ensuit est d’une violence extrême : l’armée française, soutenue par des milices locales, mène une véritable opération de guerre contre des civils, utilisant l’aviation, l’artillerie et des exécutions sommaires. Les estimations du nombre de morts algériens varient de 1 165 (chiffre officiel) à 15 000, 30 000 ou 45 000 selon les historiens, en raison de la dissimulation et de la destruction des corps.
Le retour des soldats algériens, après avoir combattu pour la France, est un choc : beaucoup retrouvent des familles décimées et une société traumatisée. La répression du 8 mai 1945 à Sétif joue un rôle majeur dans la radicalisation du mouvement nationaliste et marque une rupture profonde avec la France coloniale.
Ce crime colonial est souvent considéré comme le point de départ de la guerre d’indépendance algérienne, déclenchée neuf ans plus tard. Il illustre l’incapacité du système colonial à répondre aux aspirations d’émancipation des peuples colonisés.
Après la guerre, la démobilisation des troupes coloniales touche tout l’empire. Les soldats coloniaux découvrent que leurs pensions sont bien inférieures à celles de leurs camarades européens, parfois réduites du tiers ou de la moitié.
Au mois de novembre 1944, les tirailleurs africains sont ramenés au Sénégal. Ils sont regroupés au camp de Thiaroye, près de Dakar, et désarmés. N’ayant reçu aucune solde durant la guerre, on ne leur versera qu’une petite partie de leurs indemnités. Ils réclament alors le paiement du complément qui leur est dû. Ils seront massacrés par surprise, au petit jour, par les troupes coloniales et la gendarmerie française le premier décembre 1944. Le nombre de morts est évalué à plusieurs dizaines ou plusieurs centaines suivant les sources.
Le 23 novembre 1946, l’armée française va bombarder Haiphong, au Viêt-Nam, suite à l’indépendance proclamée par Ho Chi Minh. Ce sont les paillotes où vivent des civils qui seront particulièrement visées par les obus des navires de la marine française. Le nombre de morts est évalué entre plusieurs centaines et vingt mille suivant les sources.
Au mois de mars 1947, à Madagascar, éclate une révolte contre l’ordre colonial. Les soldats qui avaient participé aux combats aux cotés des français, croyaient aux promesses d’indépendance. Pour le peuple malgache il n’y a eu aucun changement : travail forcé, code de l’indigénat, justice coloniale arbitraire, racisme d’Etat …
Suite au soulèvement, l’armée française va procéder à un massacre de masse. Le nombre de morts est évalué entre 40 000 et 100 000, suivant les sources. Depuis 1967, le 29 mars est décrété jour de deuil national.
Le 8 mai 1945 porte donc deux significations majeures et très différentes selon les perspectives historiques et géographiques : un jour de victoire et de fête pour certains, et, l’autre 8 mai 1945, un jour de tragédie et de mémoire douloureuse pour d’autres. Cette date illustre la complexité de l’histoire : une même journée peut être vécue et commémorée de façon radicalement opposée, selon les regards portés sur le passé.