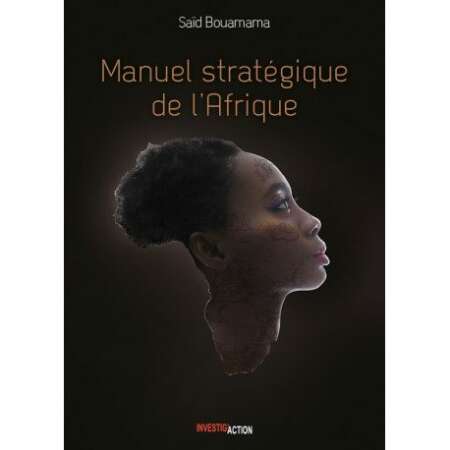Nous publions notre interview pour le numéro daté du premier trimestre 2019 de la revue « les autres voix de la planète » ayant pour titre « Dettes coloniales et réparations ». Les questions étaient formulées par Robin Delobel, Jérome Duval et Milan Rivié. Il s’agit ici de la version longue, les dernières questions n’ayant pas pu être publiées faute de place.
Plusieurs pays africains (Côte d’Ivoire, RDC, Guinée, à compléter, etc.) ont récemment demandé la restitution de leurs biens culturels pillés durant l’époque coloniale. La Belgique et la France, deux des acteurs majeurs de la colonisation, sont particulièrement concernés au travers notamment de la réouverture du musée de Tervuren et du récent « rapport Savoy-Sarr ». En quoi cela constitue aujourd’hui une question essentielle ?
Répondre à cette question suppose de prendre la mesure de ce qu’est la colonisation dans son essence. Elle est, selon nous, un processus de spoliation total c’est-à-dire touchant l’ensemble des sphères de la vie d’un peuple. Si la spoliation terrienne et plus largement la mainmise sur la sphère économique (agricole et minière) en est l’objectif premier, celui-ci ne peut être atteint qu’en produisant une aliénation du colonisé dont une des dimensions est la dépossession de son histoire, de son patrimoine et en définitive de son identité. Amilcar Cabral soulignait à juste titre que la colonisation était l’interruption de l’histoire des colonisés et la libération nationale sa remise en marche. Ce redémarrage historique suppose logiquement une réappropriation identitaire et une désaliénation dont une des dimensions incontournables est la réappropriation culturelle et identitaire. Bien entendu cette réappropriation ne se limite pas, ni ne nécessite absolument le retour des œuvres spoliées. Ce retour est cependant un facilitateur et un symbole de la désaliénation dans la mesure où il est un des marqueurs d’une histoire autonome redémarrée ou d’une rupture avec la séquence de dépossession coloniale.
La fréquence de la revendication de restitution est, à elle seule, un analyseur de l’enjeu sous-jacent : de la Grèce exigeant la restitution des frises du Parthénon, à l’Egypte réclamant celle de la pierre de Rosette ou le buste de Nefertiti en passant par le Pérou revendiquant celle des œuvres Incas volées dans la citadelle du Machu Picchu. Les revendications africaines qui se multiplient ces dernières années s’inscrivent ainsi dans un mouvement plus ample reliant restitution et réappropriation culturelle. Car tel est en effet, selon nous l’enjeu central. Si l’esclavage et la colonisation nécessite pour s’installer dans la durée une « honte de soi », l’émancipation suppose une réappropriation de soi et une fierté de soi. La restitution des œuvres culturels spoliées est un des outils de ce processus de réappropriation de soi.
La réappropriation de soi (dont les œuvres culturelles sont une des dimensions) comme phase nécessaire de l’émancipation est l’objet une longue littérature produite par les penseurs et les acteurs du combat contre l’esclavage, la colonisation et le racisme et par les pratiques culturelle populaires des dominés d’autre part. Sur le plan des pratiques on peut citer pêle-mêle les esclaves révoltés d’Haïti réinvestissant le culte Vaudou, la pratique clandestine des cultes indigènes dans l’Amérique colonisée par les espagnols ou la sauvegarde et la cache des manuscrits musulmans de Tombouctou à Alger pour les soustraire au colonisateur. Sur le plan de la pensée on pense bien sûr à Césaire et à la négritude, à Fanon et aux « masques blancs », à Malcolm X et sa redécouverte de l’histoire et des civilisations africaines, à Cabral et à la « culture comme noyau de résistance », etc. La restitution des œuvres culturelles spoliées est une des dimensions de cette résistance et réappropriation culturelle.
Que l’on ne se trompe pas. Ce dont il s’agit ici n’est pas une affaire du passé mais bien une exigence du présent et de l’avenir. Il n’est pas question ici seulement d’une récupération nostalgique de traces d’un passé révolu. Nous sommes en présence d’un moment de la lutte pour une culture vivante sans laquelle l’indépendance nationale est un leurre ou une imitation du modèle jadis imposé par la force militaire coloniale. Cette culture ne peut fleurir qu’en se ré-enracinant dans le terreau nié et/ou détruit et/ou dévalorisé et/ou folklorisé par le colonialisme puis par le néocolonialisme, non pas pour tenter de reproduire nostalgiquement cet héritage mais pour ouvrir et créer de nouveaux possibles. Loin de se réduire au retour à une origine, cette culture signe surtout la possibilité d’un nouveau commencement ou d’une reprise de l’histoire propre. La restitution des œuvres culturelles spoliées apparaît dès lors comme une des phases de la lutte de libération nationale qu’il faut entendre comme un long processus dont l’indépendance politique n’est qu’une des premières étapes en appelant d’autres : combat pour l’indépendance économique, lutte pour la désaliénation culturelle et identitaire.
Dans un récent article du politologue camerounais Achille Mbembé paru dans AOC https://aoc.media/analyse/2018/10/05/a-propos-de-restitution-artefacts-africains-conserves-musees-doccident/, celui-ci considère que la restitution des biens culturels africains doit aller de paire avec une reconnaissance des pays colonialistes de l’ensemble de leurs méfaits à cette époque. Que penses-tu de cette position ?
Je partage entièrement cette position pour deux raisons au moins. La première est que la « mission civilisatrice » de la colonisation est en fait un projet de dé-civilisation. Elle suppose une chosification de l’autre soulignera Césaire, une déshumanisation intégrale précisera Cabral. En détruisant les modes d’être au monde de peuples entiers, elle les plonge dans la désintégration, l’incohérence et le non-sens. En imposant la propriété privée de la terre et les rapports sociaux capitaliste, elle sape l’ensemble des repères moraux et sociaux. En dévalorisant comme « sauvages » tous les héritages issus des histoires pluriséculaires, elle confisque le passé et rend indisponible les liens de cohérence entre passé et présent. La violence physique de masse accompagne, on le voit, une violence encore plus ample, plus profonde, plus destructrice et aux effets plus durables. Le dépassement d’un tel crime contre l’humanité est-il possible sans sa reconnaissance ? J’ai tendance à penser qu’une page scandaleuse de l’histoire ne peux se dépasser qu’en se lisant jusqu’au bout à haute voix.
La seconde raison est la prise en compte des conséquences sur la longue durée d’une telle violence à la fois systémique et atmosphérique étalée sur plus d’un siècle et se surajoutant pour de nombreux territoires à plusieurs siècles d’esclavage. Une telle intrusion marquée du sceau de la violence ne peut pas ne pas avoir de conséquences « traumatiques » sur les victimes, qui sont ici des peuples entiers. Il se trouve que nous savons désormais que la disparition totale des conséquences d’un trauma suppose et nécessite qu’il soit nommé et reconnu dans son intégralité. Se débarrasser de ces conséquences suppose la reconnaissance des victimes qui nécessite elle-même au minimum la fin de la négation du crime. La restitution des œuvres culturelles spoliées est ainsi un des moyens de ce dépassement mais pas le seul. Sans être exhaustif d’autres moyens peuvent être cités : la reconnaissance de la réalité pour ce qu’elle a été réellement mais aussi des réparations collectives pour les destructions matérielles et humaines.
La querelle sémantique qui secoue les organismes internationaux est significative du lien nécessaire entre restitution des œuvres culturelles spoliées et reconnaissance du crime colonial. Les anciennes puissances coloniales n’aiment pas le concept de « restitution » et lui préfère celui de « retour ». La France en particuliers mais aussi l’Allemagne sont montées au créneau lors de la conférence de Venise de 1976 sur cette question. L’enjeu était la dénomination du comité en charge de la question de la restitution. Sur la pression de ces actuelles puissances néocoloniales le comité s’appelle désormais « comité intergouvernemental pour la promotion du retour des biens culturels à leurs pays d’origine ou leur restitution en cas d’appropriation illégale ». Ce qui est refusé dans le terme restitution c’est son implicite d’illégalité c’est-à-dire la caractérisation de vol pour désigner la présence de ces œuvres dans les grands musées occidentaux. L’utilisation du concept de « restitution » n’est acceptée qu’en l’accolant de l’expression réductrice « en cas d’appropriation illégale ». Les querelles de mots dans les instances internationales ne sont jamais anodines. Ce qui est refusé dans le terme « restitution » c’est une caractérisation de la période coloniale. Ce qui est apprécié dans le terme « retour » c’est sa neutralité c’est-à-dire son silence sur la caractérisation.
Soulignons au passage l’hypocrisie de ceux qui au sein des anciennes puissances coloniales s’opposent à une telle reconnaissance de la colonisation comme crime contre l’humanité. Celle-ci nous-dit-on relèverait de la « repentance », ouvrirait à un processus de « honte de soi », voire de « haine de soi » c’est-à-dire exactement ce qu’a produit l’esclavage et la colonisation. La négation du statut de responsables et de coupables pour les Etats colonisateurs signifie dans le même temps la négation du statut de victimes pour les peuples colonisés.
Bien que la colonisation est – officiellement – révolue, certains pays comme la France garde sous leur contrôle de nombreux territoires dit « d’Outre-mer » (Nouvelle-Calédonie, Guyane « française », La Réunion, Mayotte, etc.). Pour toi, les questions de la restitution des biens culturels africains et d’une éventuelle indépendance de ces territoires, sont-elles liées ?
Commençons par souligner l’importance de la dimension culturelle et identitaire dans la lutte des organisations indépendantistes des colonies françaises pudiquement appelées « Outre-mer » en nous appuyant sur l’exemple Kanak. C’est ainsi un festival culturel en 1975 (« Mélanésia 2000 ») qui marque l’affirmation et les progrès du mouvement nationaliste contemporain en Kanaky. Réaffirmation culturelle et nationalisme politique sont ainsi étroitement liés dans l’histoire politique de la colonie. Rappelons également l’attachement des militants et organisations Kanak à la « coutume », nom par lequel ils désignent la « tradition » c’est-à-dire leur culture. Toutes les initiatives et mobilisations politiques Kanak débutent par l’acte de « faire la coutume ». Comme en Afrique la dépossession culturelle a rimé avec la domination et la lutte pour l’émancipation nationale avec la réaffirmation culturelle et identitaire. En témoigne l’insistance des indépendantistes pour que la reconnaissance de l’identité Kanak figure explicitement dans les accords de Nouméa en 1998. Ces mêmes accords prévoient d’ailleurs le « retour d’objets culturels Kanak » se trouvant dans des musées métropolitains. En Kanaky comme dans les autres colonies la spoliation des biens culturels a été massive. La spoliation s’est même étendue aux traces de l’histoire Kanak comme en témoigne le maintien dans un musée de la métropole du crane du chef des insurgés de la révolte de 1878 Ataï, ainsi que celui de son sorcier. Il faudra attendre 2014 pour ces cranes soient enfin rapatriés.
Cette mutation des positions de l’Etat français est à la fois le résultat de la lutte Kanak et une stratégie de sa part visant à susciter un abandon de la revendication indépendantiste en échange d’une reconnaissance culturelle. Plus largement cette stratégie consiste à affirmer la volonté et la possibilité d’une décolonisation sans indépendance nationale. Outre les concessions que constituent la reconnaissance de l’identité Kanak et le « retour » de certains biens culturels, cette stratégie prend aussi la forme du soutien à certaines ONG revendiquant non plus l’indépendance mais le respect des droits des peuples autochtones. Alors que les indépendantistes saisissent le « comité spécial des Nations Unies sur la décolonisation », ces ONG s’adressent elles à « l’Instance permanente des Nations unies sur les questions autochtones ». Si la restitution des biens culturelle est un élément de l’émancipation nationale, elle peut aussi être mise en avant pour freiner ou détourner le combat pour l’indépendance vers une impasse. Nous parlons d’impasse car la restitution de ces biens n’est émancipatoire que si elle s’inscrit dans une logique de réappropriation d’une souveraineté économique, politique et culturelle. Sans cette dimension elle tend à se réduire à une reconnaissance dans la domination, à un respect dans la soumission, à une réduction à un folklore non vivant.
En revanche la restitution des biens culturels pour les pays africains corsetés dans les rapports néocoloniaux prend un sens plus large. Elle s’inscrit dans la logique d’un combat pour une indépendance réelle et prend de ce fait plus facilement et plus fréquemment le sens d’une remise en cause du néocolonialisme. Elle ne peut qu’encourager d’autres combats allant dans le même sens : contre la dette, contre le franc CFA, contre les accords de coopération, etc. Autrement dit le lien entre la restitution et l’indépendance réelle est posé logiquement dans le cas des pays néo-colonisés. Une dynamique de lutte africaine imposant la restitution aidera à reposer celle-ci dans son véritable cadre, celui du combat contre la dépendance, le néocolonialisme et les indépendances et souverainetés en carton. Un tel recadrage ne peut qu’être positif face aux stratégies étatiques françaises dans ses dernières colonies visant à faire des concessions pour garder l’essentiel en promouvant une illusoire décolonisation sans indépendance.
L’écho des actions de ces différents mouvements dépasse largement les frontières du continent africain. Comment les différentes diasporas africaines, personnes et organisations présentes en Europe dénonçant les mécanismes néocoloniaux peuvent-ils leur apporter un soutien ? Quelles actions préconiserait-tu ?
Elles peuvent jouer un rôle important en reliant la revendication de la restitution à la revendication plus large d’abolition du néocolonialisme. Pour le comprendre, il convient de ne pas oublier que le colonialisme n’a pas eu qu’un impact sur les pays colonisés et sur leurs peuples. Il a également travaillé en profondeur et impacté les pays colonisateurs et leurs peuples. Pour que l’esclavage et la colonisation soient possibles, il faut que ces crimes apparaissent comme justifiés, légitimes et en conséquence souhaitables. Le racisme en tant qu’idéologie de hiérarchisation de l’humanité connait son âge d’or dans la même ère historique où se déploient l’esclavage et la colonisation. L’esclavage et la colonisation ne sont pas possible sans racisme et inversement le racisme nécessite une base économique (l’esclavage et le colonialisme hier, le néocolonialisme aujourd’hui). Une société qui en domine d’autres ne peut être que raciste.
L’héritage colonial et le présent néocolonial est banalisé dans la quotidienneté des sociétés européennes. On en trouve des traces dans les biens culturels entreposés dans les musées mais aussi dans le nom des rues, avenues et places, dans les images et représentations de nos concitoyens noirs, arabo-berbères ou musulmans des médias, illustrations publicitaires, bandes dessinées, chansons ou blagues, etc. C’est donc une véritable décolonisation de l’imaginaire qu’il convient de mettre en action pour assécher le fertilisant idéologique du néocolonialisme que sont ces préjugés issus de notre histoire coloniale. C’est ce que nous avons proposé d’appeler la lutte contre « l’espace mental colonial » sans laquelle le racisme ne reculera pas ici et le néocolonialisme gardera ici une de ses assises idéologiques essentielles.
Quant à la question du souhaitable en terme de mobilisation nous devons le définir en gardant à l’esprit le lien entre domination et invisibilité ou entre visibilité et émancipation. Il s’agit en conséquence d’inventer des actions publiques rendant visible l’invisible. Des ballades anticoloniales permettant de visibiliser les traces de la colonisation dans nos villes, aux opérations de débaptisation des noms de rue, place ou avenue rendant hommage à des esclavagistes et assassins coloniaux, aux campagnes exigeant que les statues symbolisant la colonisation par la mise à l’honneur de ses acteurs soient démontées et exposées dans des musées (avec si le rapport de forces est réunis l’exigence d’un texte de légende condamnant la colonisation), en passant par des sit-in devant les musée en soutien aux revendications de restitution des biens culturels, etc., le point commun est de visibiliser l’invisible. Si le combat essentiel se mène dans les pays africains, ces mobilisations ici peuvent les renforcer considérablement.
Terminons en soulignant que ce combat n’est pas seulement un soutien au combat des peuples africains. Il est aussi une lutte pour le type de société dans laquelle nous voulons vivre ici. A moins de se résoudre à vivre dans une société raciste, nous avons à soutenir de manière beaucoup plus offensive qu’aujourd’hui les combats contre le néocolonialisme des peuples africains d’une part et à mener un combat radical pour décoloniser nos sociétés d’autre part.
Plus largement, où en sont les campagnes pour les réparations liées à la période coloniale et à la traite esclavagiste ? Les victoires obtenues, comme celle des Mau-Mau vis à vis de la Grande-Bretagne, la campagne initiée par la Caricom, en créant la Caribbean reparations commission,etc. ont elles entrainé une nouvelle dynamique ? Comment vois tu le lien avec les campagnes dette?
La revendication de réparation n’est pas nouvelle. Si le terme n’est pas encore utilisé pendant la période esclavagiste, la revendication est cependant présente sous d’autres dénominations : « indemnisation », « compensation », « restitution ». En témoigne des lettres, pétitions, pamphlets, etc., dont on peut se faire une idée par la lecture de l’excellent livre d’Ana Lucia Araujo ( Reparations for slavery and the slave trade. A transnational and comparative history, Bloomsbury, London, 2017). Il en est de même pour les réparations liées aux destructions et spoliations de la colonisation. On la retrouve ainsi comme revendication lors de la conférence tricontinentale de 1966 qui regroupa l’essentiel des mouvements de libération nationale et des organisations anti-impérialistes d’Asie, d’Afrique et d’Amérique Latine.
Depuis une décennie le mouvement pour les réparations connaît une nouvelle vigueur. Sans être exhaustif les repères suivants soulignent la montée en puissance de la revendication : création en 2005 en Martinique du Mouvement International pour les Réparation et plainte de 64 descendants d’esclaves contre l’Etat français ; signature en 2008 d’un traité d’amitié et de coopération entre l’Italie et la Lybie prévoyant un dédommagement à hauteur de 5 milliards de dollars sur une période de 25 ans sous la forme de construction de logements et d’infrastructures routières ; Création d’un réseau international pour les réparations relatives à l’esclavage et la colonisation d’une part et instauration d’une journée internationale pour les réparation d’autre part par l’Assemblée des mouvements sociaux du Forum Social Mondial de Tunis en 2013 ; Création d’une commission des réparation lors du sommet de la communauté des Caraïbes (CARICOM) regroupant 12 Etats membres en 2013; Plainte d’anciens Mau Mau ou de leurs descendants devant la justice britannique et victoire judiciaire en 2013 pour 5 228 personnes pour une indemnisation d’un montant de 30 millions de dollars ; dépôt de deux projets de loi en 2017 par la député verte Cécile Duflot portant pour l’un sur la reconnaissance du « travail forcé comme crime contre l’humanité» avec un principe de réparations pour les «préjudices en résultant» et portant pour le second sur la «réparation des préjudices résultant de la traite et de l’esclavage colonial». Ces moments forts s’accompagne d’une multitude d’actions plus modestes qui soulignent que la revendication est désormais inscrite à l’agenda des luttes même si le rapport des forces nécessaire pour l’emporter est encore à construire.
La revendication de réparations pour les crimes esclavagistes et coloniaux permet de resituer la question de la dette dans son véritable contexte historique et économique. Non seulement la dette des pays néo-colonisés est inique et doit tout simplement être effacée mais de surcroît une autre dette, bien réelle celle-ci, doit être remboursée par les anciennes puissances esclavagistes et coloniales : la dette négrière et coloniale.
On parle beaucoup de Françafrique dans les médias actuellement avec les propos de Luigi Di Maio (soit dit en passant hypocrites et utilisés dans un sens politique selon moi) mais aussi avec les affaires autour de Alexandre Benalla, l’acquittement de Laurent Bagbo à la CPI pour absence de preuves mais aussi bien sûr la lutte contre le Franc CFA, selon toi comment lutter politiquement et collectivement contre la françafrique ?
Je reprendrais volontiers une phrase de Marx appelant à « rendre la honte plus honteuse en la rendant visible ». Autrement dit les scandales de la Françafrique se perpétue par la chape de silence qui l’accompagne. Chaque gouvernement depuis plus d’une décennie annonce qu’il rompt avec ce système néocolonial d’ingérence tout en le perpétuant. Ce qu’il y a de nouveau c’est l’émergence de luttes en Afrique même portées par une nouvelle génération militante pour dénoncer les différents segments de ce système (mouvement pour la sortie du CFA, contre la signature des APE, contre le procès intenté à Bagbo, contre la présence militaire au Tchad, etc.). Compte-tenu des conséquences prévisibles des APE en termes de paupérisation encore accrue du fait de la concurrence « libre et non faussée » entre les petits producteurs locaux et les multinationales qu’imposent ces accords, ces mouvements ne peuvent que perdurer et se renforcer. La construction en Europe d’un mouvement de contestation pouvant faire écho aux luttes africaines, pouvant leur servir de caisse de résonance, pouvant en être les « porteurs de valises » d’aujourd’hui, etc., serait d’une utilité politique certaine. Une telle initiative est même urgente compte-tenu de l’activisme d’un Soros en Afrique offrant un financement à ces luttes pour mieux les dépolitiser et les instrumentaliser. L’organisation de la solidarité matérielle et financière semble ainsi être également de nouveau à l’ordre du jour. Soulignons enfin que nos dénonciations ne doivent pas se limiter à la Françafrique. Dans bien des domaines la sphère des responsabilités est passée à l’échelon européen même si Paris reste l’exécuteur en chef. C’est désormais l’Europe et sa banque centrale qui assure le fonctionnement du CFA. C’est également elle qui impose les contrats léonins que sont les APE. Un mouvement européen anti-impérialiste ou au moins des campagnes communes sont ainsi des directions à emprunter.
Cela pourrait passer par des condamnations de la Banque mondiale et de ces méfaits. Une de ses filiales (la SFI) fait actuellement l’objet d’une plainte pour dégâts environnementaux dans un projet indien de centrale énergétique qu’elle a financé à hauteur de 450 millions de dollars. La plainte a été déclarée recevable, le 27 février 2919, par la Cour Suprême des États-Unis. ( Info reçu vendredi, j’écris un article là-dessus pour l’envoyer demain: https://www.financialafrik.com/2019/02/28/usa-la-banque-mondiale-perd-son-immunite )
Toutes les formes possibles de luttes sont à mobiliser, y compris bien sur le combat juridique. Même non victorieuse les plaintes devant différentes juridictions contribuent à briser la chape de silence d’une part et sont des points d’appuis pour les autres formes de luttes d’autre part. La constitution d’un collectif international de juristes se consacrant à cet axe de lutte pourrait ainsi s’envisager. Il pourrait se consacrer à la fois à la défense des militants réprimés et aux dépôts de plaintes dans toutes les juridictions possibles. Sa simple existence visibiliserait plus rapidement des luttes contre les dégâts environnementaux et humains des grands projets des multinationales. Fréquemment les collectifs locaux de luttes qui se mettent en place ne savent pas vers quels acteurs se tourner pour faire connaître leurs combats ou organiser la défense de leurs militants emprisonnés. Une telle structure de solidarité dotée de moyens d’informations serait un repère d’alerte.
De nombreux mouvements sociaux émergent depuis plusieurs années en Afrique. Du « Balai citoyen » au Burkina Faso à « Y’en a marre » au Sénégal ou encore « Filimbi » et « La Lucha » au Congo-Kinshasa, ceux-ci dénoncent à la fois la corruption présente dans leurs pays respectifs ainsi que les ingérences des puissances impérialistes. Quels sont pour toi leurs forces et leurs faiblesses ?
Comme nous l’avons souligné précédemment, la force principale de ces mouvements est qu’ils sont portés par une nouvelle génération militante. Celle-ci composée de jeunes entre vingt et quarante ans se caractérise par un dynamisme militant important comme en témoigne les manifestations pour la sortie du franc CFA récentes. Ces militants maîtrisent également les réseaux sociaux et les mettent au service de ces mobilisations. Ils développent des formes de luttes alliant la contestation classique, la dimension ludique et la mobilisation citoyenne pour l’environnement (la pratique du ramassage des déchets à l’issue des manifestations apparue d’abord au Burkina a été également observée à Alger la semaine dernière). Une autre force est le refus de choisir entre dénonciation de pseudo forces internes et de pseudos forces externes. La dénonciation simultanée des ingérences impérialistes et des gouvernements africains qui les cautionnent souligne une prise de conscience réelle du caractère systémique du néocolonialisme.
Du côté des faiblesses il faut souligner la coupure (plus ou moins prononcée) avec d’autres générations militantes ou d’autres segments de protestations contre les mêmes ingérences et fréquemment avec les mêmes revendications. Le lien avec les luttes syndicales (pourtant elles aussi en développement quantitatif) reste faible. Enfin l’intervention de nombreuses ONG au sein de cette jeunesse n’est pas sans porter la dérive d’une dépolitisation par le captage des leaders que celles-ci mettent en place.
Une des questions les plus discutées aujourd’hui est aussi celle de la sortie du Franc CFA pour les 15 pays concernés (mettre une nbp avec 14 pays + Comores). Le Franc-CFA est sans aucun doute un outil néocolonial dont il faut se débarrasser, mais d’après toi, cette sortie constituerait-t-elle une fin en soi ?
Bien entendu la sortie du Franc CFA ne suffira pas à elle seule à mettre fin au développement extraverti. La question posée est celle déjà énoncée par Samir Amin depuis longtemps : la déconnexion avec un marché mondial dominé par les anciennes puissances coloniales et le recentrage des priorités sur le besoin des populations autochtones et des équilibres locaux. En témoigne les situations des pays issus des autres empires coloniaux qui disposent tous de leur propre monnaie sans que cela n’ait signifié un développement autocentré. Cela étant posé une telle perspective suppose que l’épée de Damoclès qu’est le CFA soit démantelée. En témoigne les assassinats ou les déstabilisations de la plupart des chefs d’Etat d’Afrique subsaharienne qui ont enclenchés la mise en œuvre d’une monnaie nationale. Disons pour simplifier que la sortie du CFA est une condition nécessaire mais pas suffisante pour rompre avec la dépendance néocoloniale.
Y-a-t-il pour toi une réelle différence entre les politiques dites de « Soft power » que l’on rencontre régulièrement ces derniers temps, notamment venant des pays des BRICS, et les politiques typiquement « néocolonialistes » ?
L’Afrique n’a pas à attendre son émancipation d’acteurs extérieurs. Cependant l’émergence de nouveaux acteurs est venue élargir les marges de manœuvres que peuvent mobiliser les Etats africains. Les BRICS contribuent ainsi à desserrer l’étau imposé par les pays occidentaux. Par ailleurs pour s’imposer ces BRICS doivent offrir des conditions plus avantageuses que celles offertes par les « partenaires » classiques. Enfin culturellement les liens avec les BRICS ne sont pas imbibés par la pesanteur d’un héritage colonial maintenu en vie par des réseaux humains, des procédures et habitudes héritées, des modes d’intervention directes décomplexés, des réflexes paternalistes et fraternalistes profondément ancrés, etc. Cela étant dit les accords en développement avec les BRICS ne sont pas homogènes sur le continent et dépendent en grande partie de la nature des politiques suivies par l’Etat africain concerné. Autrement dit je pense qu’il faut se méfier autant du discours de diabolisation des BRICS les présentant comme le nouveau danger en Afrique que du discours de l’attente d’une solution miracle par l’arrivée de ces nouveaux acteurs. L’essentiel reste ici l’existence ou non d’une politique de sortie de la dépendance c’est-à-dire de ce que les militants africains appellent désormais le combat pour la seconde indépendance.
Pour finir, quels sont tes actuels et futurs projets d’ouvrages ?
Je viens de publier en septembre 2018 aux éditions Investig’action un « manuel stratégique de l’Afrique » en deux tomes restituant toutes les ingérences militaires occidentales (leurs motivations, causes et conséquences) depuis les indépendances.
Je sors début avril un ouvrage aux éditions Syllepses portant pour titre « « Planter du blanc ». Chroniques du (néo-)colonialisme français »
Publié le 9 avril 2019 sur le blog de Saïd Bouamama