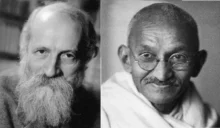Dernière mise à jour : il y a 1 jour
Par Thomas Vescovi
Ce texte devait initialement être présenté à Bruxelles, le 14 octobre 2023, dans le cadre d’un colloque sur la lutte contre l’antisémitisme. Reporté au 2 mars 2024, il m’est désormais impossible d’y participer. Cet article doit permettre d’annoncer cet évènement auquel Nitzan Perelman de Yaani participera, et d’entamer la réflexion.

pendant la contestation contre la réforme judiciaire du gouvernement Netanyahu.
Photo : Haggai Matar, +972mag.com
« N’est-ce pas anachronique d’être antisioniste ? Comment peut-on être sioniste et de gauche ? » Aussi légitimes soient-elles, ces interrogations illustrent plusieurs présupposés. D’abord, que le sionisme se soit pleinement réalisé dans la création et l’enracinement de l’État d’Israël au Proche-Orient, sans jamais connaitre d’évolutions particulières. Mais aussi que l’antisionisme ne se résumerait qu’à une volonté de voir l’État d’Israël disparaitre. Ou encore que jamais des organisations n’aient pu être à la fois de gauches et coloniales.
Répondre à une urgence vitale
L’apparition simultanée en 1897 du mouvement sioniste et du Bund (Union générale des travailleurs juifs de Lituanie, de Pologne et de Russie) illustre l’urgence pour une partie des juifs européens à se libérer de l’antisémitisme. Si à l’Est, où vit à cette époque plus de 60 % de la population juive mondiale, celle-ci est confrontée à des persécutions alimentées par un racisme d’État, à l’Ouest les juifs obtiennent progressivement des droits qui leur permettent de vivre comme des citoyens à part entière et de s’assimiler aux sociétés où ils évoluent. Toutefois, le congrès fondateur de Bâle ne créé pas le sionisme, il l’institutionnalise en développant un « nationalisme juif ». En effet, tout au long du XIXe siècle, de nombreux actes, publications et projets se sont succédés pour appeler les juifs d’Europe de l’Est à émigrer, notamment vers la Palestine, terre des Hébreux dans la tradition biblique.
Le sionisme politique repose sur trois principes. Premièrement, il considère impossible l’intégration des juifs à leurs sociétés. Ces derniers seraient pris en étau entre des courants appelant à leur destruction physique et une volonté dans leurs rangs de s’intégrer pleinement aux sociétés européennes par l’assimilation en se détachant de la religion, voire de toute appartenance communautaire. Or, cette dernière perspective n’empêche pas l’antisémitisme de se diffuser et de menacer la sécurité des juifs, à l’instar de la campagne antisémite à l’encontre du capitaine Dreyfus en France, à laquelle le journaliste austro-hongrois Theodor Herzl a assisté. C’est à partir de ce constat que le sionisme revendique la création d’une entité politique où les juifs seraient majoritaires dans l’espoir d’y vivre en sécurité. En d’autres termes : l’édification d’un État juif, comme l’explique Herzl dans son ouvrage éponyme publié en 1896.
À cela s’ajoute un second principe : l’existence d’un « peuple juif ». Théorisé dans le contexte de la montée des nationalismes en Europe et de la formation des États-nations, l’affirmation d’un « peuple juif » permet au mouvement sioniste de revendiquer un droit à disposer d’un État. Or, et c’est le troisième principe, cette aspiration se fonde également sur le lien prétendument originel des juifs à la « Terre sainte » où le « peuple juif » disposerait de droits historiques et quasiment exclusifs. Si d’autres territoires ont été envisagés pour la réalisation du projet sioniste, aucun ne possédait une symbolique aussi forte que la Palestine. Dès lors, imprégné des idées coloniales et orientalistes européennes, le sionisme ne se voit pas autrement que comme propriétaire de la Palestine, lui valant de nombreuses critiques d’intellectuels juifs issus de l’humanisme libéral ou du marxisme. Ces derniers s’opposent logiquement à la construction d’un État pour les juifs sur une terre peuplée très majoritairement par des populations non juives, considérant les injustices qu’un tel projet implique.
Le mouvement sioniste n’est pas monolithique, plusieurs tendances coexistent. Les rapports de force dans l’Entre-deux-guerres permettent à l’aile gauche, dite travailliste, de s’imposer à la tête de l’Agence juive, l’organisation pré-étatique juive en Palestine. Pour les sionistes de gauche, les accusations de soutenir un projet raciste ne tiennent pas : ils se perçoivent comme les défenseurs d’un idéal qui ne peut être qu’antiraciste par essence, puisqu’il vise à émanciper les principales victimes du racisme. Surtout, ils dépassent la contradiction entre les valeurs de gauche et les aspirations nationalistes et coloniales du sionisme, en revendiquant une « colonisation ouvrière », fondée sur des valeurs socialisantes. Enfin, par leur confrontation avec le Royaume-Uni, puissance mandataire de la Palestine, le sionisme de gauche revendique même sa place au sein des mouvements décoloniaux post-1945. Le ralliement de l’URSS au partage de la Palestine, puis à la création de l’État d’Israël via l’acheminement d’armes pendant la guerre de 1948, conforte l’aile gauche du sionisme : si le pays qui est l’étendard de la révolution socialiste en Europe, principal acteur de la défaite du fascisme, les soutient, alors la création d’un État juif ne peut qu’être du bon côté de l’histoire des peuples.
Des années 1930 aux années 1940, le ralliement des populations juives européennes au sionisme est progressif mais réel. Entre l’arrivée au pouvoir de régimes antisémites, puis le génocide des juifs, la réponse des organisations antiracistes n’était plus à la hauteur. Ceux qui subissaient l’antisémitisme et sa violence au quotidien, et à qui toute forme de reconnaissance sociale était refusée, ne pouvaient ni faire confiance aux sociétés qui avaient permis voire soutenus l’accession d’antisémites au pouvoir, ni se satisfaire d’une libération amenée par le triomphe d’une hypothétique révolution marxiste. Si jusqu’à la veille de la Seconde Guerre mondiale seule une minorité de juifs européens ont opté pour un exil vers la Palestine, la donne change après 1945 : l’utopie de fonder un État juif sur des bases de dignité et de justice, quand bien même situé sur un autre continent, devient un idéal attractif et mobilisateur, par défaut. Lors de son audition en 1947 par le Comité spécial des Nations unies sur la Palestine (UNSCOP), Ben Gourion déclare : « Qui veut et peut garantir que ce qui nous est arrivé en Europe ne se reproduira pas ? [...] Il n’y a qu’une sauvegarde : une patrie et un État. »
En plus des calculs impérialistes ou intérêts propres à chaque vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, la culpabilité européenne et le choc devant l’ampleur du génocide ont conduit au vote de l’ONU en 1947 qui a donné à l’État d’Israël une légitimité et aux populations juives un début de réparation. Mais au détriment des Palestiniens, dont les trois quarts sont chassés de leur terre et contraints à un exil forcé. Ils sortent de l’histoire au moment où les juifs y entrent en tant que peuple disposant d’un État. L’historienne israélienne Idith Zertal parle de la création d’Israël comme d’un « évènement extra-historique », dans le sens où « le premier évènement – la Shoah – a blanchi d’une certaine manière le côté sombre du second, c’est-à-dire les conditions et les conséquences de la victoire israélienne en 1948. » Dans Vaincre Hitler (2009), le responsable politique israélien Avraham Burg soutient cette réflexion dans le sens où « face à la Shoah, tout est insignifiant, néant, et donc permis, […] tout est possible, puisque nous avons survécu à la Shoah, et surtout… qu’on ne nous fasse pas la morale. »
Un mouvement colonial et ethnique, donc raciste et ethniciste
Les sionistes avaient bien conscience de la présence d’une population arabe sur la terre qu’ils convoitaient, mais ils souhaitaient la remplacer. Ainsi, systématiquement pendant la période mandataire, la violence arabe à l’encontre des immigrés juifs ne précède pas la séparation des communautés, elle en découle. Les organisations juives marxistes qui œuvraient à des structures fondées sur des critères de classe, et non pas ethniques, ont été marginalisées par la ligne ethnique tracée par le mouvement sioniste, mais aussi par l’amalgame que la population arabe faisait entre ces juifs marxistes originaires d’Europe et les tenants d’un projet colonial qui aspirait à les déposséder. Dans l’optique d’assurer l’immigration de nouvelles populations juives et leur intégration rapide, les sionistes se sont employés à développer un « travail juif » (« Avoda ivrit ») imposant aux entreprises juives de ne pas employer d’arabes. Il s’agissait évidemment de parvenir à une autosuffisance et aux bases d’un futur État, ce à quoi ils sont parvenus.
Le colonialisme reposant sur un fondement raciste, le sionisme, en tant que projet colonial, produit naturellement à son tour du racisme. La littérature sioniste d’avant comme après la création d’Israël foisonne de propos orientalistes et racistes, faisant de « l’Oriental » un être inférieur intellectuellement et matériellement. Cette pensée a permis de légitimer un certain nombre de pratiques à l’égard des Arabes de Palestine, y compris l’historique communauté juive, et d’envisager l’effacement des Palestiniens du paysage, en tant que squatteurs indésirables d’une terre qui devait, du point de vue sioniste, revenir à ses « véritables propriétaires».
À ce racisme colonial s’ajoute la complexité d’un mouvement politique national qui se veut aussi ethnique. Le sionisme ne vise pas à la libération de l’ensemble des populations présentes sur un territoire censé accueillir le projet étatique, mais à assurer des droits et la sécurité pour un groupe particulier auquel l’intégration est impossible si ce n’est par le biais d’une complexe conversion religieuse. Ainsi, la création d’Israël ne s’est pas accompagnée du façonnement d’une nation israélienne fondée sur des droits égaux où la citoyenneté transcende les particularismes, mais d’une société coloniale marquée par des rapports de domination et la distribution de privilèges politiques, sociaux et territoriaux sur des critères ethniques.
Le principe même d’État juif et démocratique questionne, et ce dès la fondation d’Israël. Le journaliste et responsable politique juif Ilan Halevi, engagé au sein de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP), expliquait que « l’État juif, […] c’est l’État qui identifie deux catégories légales distinctes de citoyens : les juifs, et les « non juifs ». C’est donc un État qui discrimine entre ceux de ses citoyens qui sont reconnus comme juifs par l’administration israélienne […], et ses propres citoyens arabes, chrétiens ou musulmans. » Il ajoute : « Le sionisme repose sur des présupposés qui font du racisme la norme acceptable des relations entre les groupes. »
Une norme qui ne concerne pas uniquement les relations entre Arabes et Juifs, Israéliens et Palestiniens. Dans son essai Le sionisme du point de vue de ses victimes juives (2006), Ella Shohat explique que « l’anti-arabisme fait partie intégrante de la pratique et de l’idéologie sioniste ». Les juifs orientaux ont été exhortés à choisir entre une arabité perçue comme antisioniste, et une judéité qui ne pouvait qu’être pro-sioniste. Pour la première fois de leur histoire, ces populations ont subi un racisme, non du fait de leur religion, mais de leur culture et de leur couleur de peau. Le sionisme, explique Shohat, a conceptualisé l’antinomie entre arabité et judéité.
Partant de cette analyse, il n’y a rien d’étonnant à ce que les dirigeants israéliens aient toujours su se montrer complaisant à l’égard de mouvement ou régime raciste et antisémite, dès lors qu’ils étaient prêts à collaborer avec Israël dans une convergence d’intérêt. Il en a été ainsi hier avec l’Afrique du sud de l’Apartheid, et aujourd’hui l’Inde de Modi ou la Hongrie d’Orban.
Une politique qui menace la sécurité des juifs
Si le sionisme a atteint son objectif nationaliste, via l’enracinement de l’État d’Israël, les Palestiniens n’ont pas disparu, sont revenus dans l’Histoire et contestent à présent démographiquement la légitimité d’un État à majorité juive entre la mer Méditerranée et le fleuve Jourdain. Cela d’autant plus que la politique israélienne de colonisation de la Cisjordanie occupée depuis 1967 a effrité les espoirs de voir naitre un État palestinien aux côtés d’Israël . Dans cet espace vivent aujourd’hui autant d’Arabes que de Juifs, soit autour de 7 millions. Comment un État qui s’affirme comme « Juif » peut-il subsister sans édifier un régime qui prend la forme d’un apartheid ?
Fondé par un mouvement aux principes ethniques et coloniaux, l’État d’Israël est naturellement devenu un régime annexionniste, ethniciste et suprématiste, bien loin des prétentions collectivistes ou socialisantes des tenants d’un sionisme de gauche. En 2018, le gouvernement israélien a fait voter la loi dite d’État-nation du peuple juif, institutionnalisant l’apartheid, tandis qu’en Cisjordanie les colons sionistes-religieux agissent en sachant que leur judéité leur garantie au regard du droit israélien l’impunité et le privilège de vivre sur des terres spoliées aux Palestiniens.
Prétextant vouloir lutter contre l’antisémitisme, certaines organisations s’emploient depuis les années 2000 à limiter le droit à la critique d’Israël, voire même à censurer le questionnement sur la légitimité à maintenir un « État juif », et donc non égalitaire, dans un espace où précisément la population juive n’est pas majoritaire. Tout en condamnant l’importation du mal nommé « conflit israélo-palestinien », ces organisations multiplient aussi les appels adressés aux juifs à se tenir aux côtés d’Israël, à marteler que l’antisionisme est un antisémitisme déguisé. Elles participent ainsi à l’amalgame dangereux entre juif et Israélien faisant de chaque juif le potentiel porteur d’une responsabilité dans le drame palestinien . Or, c’est précisément parce que l’idéal d’un État pleinement égalitaire au Proche-Orient contrevient fondamentalement aux principes du sionisme, que certains groupes juifs en Israël ou en Occident s’affirment comme « antisionistes ». Surtout, pour paraphraser Sylvain Cypel, dans son ouvrage L’État d’Israël contre les Juifs (2020) : ce n’est pas la divulgation des images sur les tueries de jeunes Palestiniens qui alimentent l’antisémitisme, ce sont les tueries elles-mêmes pratiquées au nom de la sécurité d’un État prétendant agir au nom de tous les Juifs.
Le nettoyage ethnique de 1948, le statut de sous-citoyen des Palestiniens d’Israël, le racisme subi par les juifs orientaux, l’occupation et la colonisation des territoires conquis en 1967, l’illégalité du blocus sur la bande de Gaza et du Mur en Cisjordanie, les rapports des ONG faisant état d’un régime d’apartheid, les guerres multiples menées au nom de la « sécurité d’Israël » prenant aujourd’hui la forme d’actes génocidaires à Gaza : autant de politiques qui empêchent d’imaginer une sécurité pour les juifs au Proche-Orient, puisque celle-ci ne se construit qu’au détriment du sort des Palestiniens. Le 7 octobre a, de la plus cruelle des manières, rappelé cette réalité. Dès lors, si le fléau de l’antisémitisme ne puise pas ses racines dans la politique israélienne ou les actes du gouvernement Netanyahou, il devient indéniable que la lutte antiraciste contre l’antisémitisme perd de sa crédibilité en fermant les yeux, ou en bégayant, sur le respect des droits des Palestiniens face au drame sans précédent qu’ils traversent.