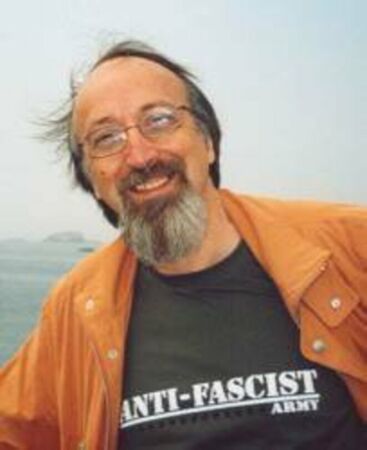« Bons Juifs », « mauvais Juifs », « Juifs d’exception », une curieuse stigmatisation de l’antisionisme
Dans leur Petit manuel de la lutte contre l’antisémitisme1, Jonas Pardo et Samuel Delor critiquent « la posture d’exceptionnalité » qui serait adoptée par les Juifs antisionistes et la manière dont elle permettrait à une partie de la gauche d’éviter toute remise en question – et donc, poursuivons le raisonnement pervers, qui serait complaisante avec l’antisémitisme supposé de l’extrême gauche.
Selon le courant sioniste de gauche qu’ils incarnent, les Juifs antisionistes, « chouchoutés » par les Arabes qui soutiennent la Palestine, mériteraient la sollicitude pendant que la majorité des Juifs attachés à Israël, n’auraient droit qu’à la réprobation et d’être livrés à un légitime antisémitisme.
À l’heure où le génocide se poursuit à Gaza, on aurait aimé que Jonas Pardo prenne le temps d’évoquer l’enfer de Gaza. Ce n’est pas son combat. Ne l’intéresse pas plus l’usage d’une caractérisation des Palestiniens par l’État génocidaire : pas vraiment de « bons Palestiniens » − à part peut-être quelques miliciens stipendiés −, toute la population – femmes et enfants, soignants et secouristes, journalistes… − est constituée par les « mauvais Palestiniens » du Hamas.
Les « bons Juifs », solidaires du génocide ?
En considérant que les Juif.ves antisionistes, par leur soutien au peuple palestinien contre Israël seraient évidemment complaisants avec l’antisémitisme, ces défenseurs particuliers d’un antiracisme judéocentré créent de fait une catégorie de « mauvais Juifs », Juifs d’une exception mauvaise.
Et par conséquent, une catégorie de « bons Juifs », ceux qui sont « attachés à l’État d’Israël » est fabriquée logiquement par ledit Pardo. Et naturellement, dans une période marquée par des crimes de guerre et un génocide, cet attachement à l’État d’Israël laisse le champ libre à un rattachement automatique à la guerre coloniale.
Comment sortir du pot de glu quand on y a plongé ses mains ?
Les « Juifs d’exception »
La notion de « Juifs d’exception », nous rappellent nos camarades de Tsedek, a été « forgée par Hannah Arendt en 1946 et s’appliquait initialement à la bourgeoisie juive assimilée, désireuse de démontrer à l’ordre racial que ses membres avaient intégré les valeurs de la blanchité et s’étaient débarrassés des stigmates antisémites dont le reste des Juif.ves demeurait marqué. »2
En tentant d’appliquer cette notion à Tsedek et à l’UJFP, Jonas Pardo veut créer une délimitation chez les Juifs.ves, non sur une prise de position politique, mais sur une posture.
Nous ne sommes pas de « bons Juifs » !
À l’UJFP, nous n’avons jamais prétendu incarner la « véritable judéité » et en exclure les autres Juifs.ves. Nous avons même documenté la variété des positions antisionistes3 depuis celle des Juifs anglais qui refusaient le sionisme pour conserver leurs privilèges de Juifs intégrés à la bourgeoisie, voire à l’aristocratie, anglaise, jusqu’aux militants du Bund, antisionistes quoique partisans de l’émergence d’une nationalité juive non territorialisée, en passant par les rabbins antisionistes en attente de Messie.
Nous nous adressons à tous les Juifs.ves et soutenons ceux qui, en France comme en Israël-Palestine, s’opposent aujourd’hui au génocide. C’est une position politique et non la définition de l’appartenance à un groupe ainsi privilégié. De même, une prétendue lutte contre l’antisémitisme… à gauche, est selon nous un épouvantail agité pour dissimuler une autre position politique, non dite.
Le courant juif dans lequel nous nous positionnons existe depuis au moins le début du 20e siècle et comporte des figures majeures de la judéité. Cela ne signifie pas que nous nous considérions comme les seuls Juif.ves dans le vaste monde.
Le « Mal absolu » ?
La journaliste Élishéva Gottfarstein, de son côté, reproche à Tsedek et à l’UJFP de considérer le sionisme comme le Mal absolu4.
Les catégories du Bien et du Mal sont pourtant absentes de nos publications, car ces notions sont bien peu politiques. L’idée qu’il y aurait une morale universelle et intemporelle repose sur l’idée d’un « sens moral absolu qui n’est que le timide pseudonyme philosophique de Dieu »5. Or, ni Tsedek, ni l’UJFP ne pratiquent le « Gott mit uns » !
On voit bien cependant comment le sionisme réclame lui-même d’être placé dans une « posture d’exceptionnalité » basée sur l’exceptionnalité de la Shoah – qui ne peut être que le seul, exceptionnel et incomparable génocide – et cette posture traverse les écrits de ceux qui, au nom de la lutte contre l’antisémitisme, refusent que la nature de l’État colonial israélien puisse être interrogée. L’exceptionnalité est ainsi inscrite dans la Loi fondamentale : Israël en tant qu’État-nation exclusif du peuple juif (2018).
Quand la Palestine flambe, Jonas Pardo et ses acolytes montrent l’UJFP et Tsedek.
Parias conscients
Plutôt que reprendre en inversant le stigmate la notion de « Juifs d’exception », il vaudrait mieux se référer à la catégorie du « paria conscient » ou « rebelle », mise en avant par Hannah Arendt6 qui s’inspirait de Bernard Lazare.
Oui, nous sommes les « parias conscients » de ce qui se passe en Palestine. Et cette conscience manque à certain.es Juifs.ves, mais la conscience cela se construit à l’épreuve de la réalité, comme nous le montre les mouvements d’opinion, partout dans le monde, dans les communautés juives de la diaspora comme dans une partie de la jeunesse en Israël même.
Notre attachement aux Juifs, Israéliens compris, va jusqu’à souhaiter qu’un processus comparable de décolonisation à celui de l’Afrique du Sud après l’Apartheid, tranche le nœud gordien qui attache encore le char de guerre israélien, comme il attachait celui du roi de Phrygie. La conscience peut rendre leur dignité à ceux qui ont soutenu le processus répressif et génocidaire. Nous ne les désignons pas comme de « mauvais Juifs », mais ils s’inscrivent dans le colonialisme qui entache leurs esprits dans la posture de domination coloniale, comme l’étaient majoritairement les Français d’Algérie au temps de la Guerre d’indépendance.
Nous n’avons aucune complaisance avec l’antisémitisme que nous combattons quotidiennement, même si nous ne tombons pas dans le piège de la confusion antisionisme/antisémitisme ni dans celui de l’instrumentalisation de l’antisémitisme dans le projet raciste de l’extrême droite.
L’existence même de l’UJFP est un outil puissant de lutte contre l’antisémitisme, car elle montre, avec en particulier le travail de notre équipe à Gaza, qu’il est possible de construire, avec d’autres parias, un monde sans suprémacisme juif, sans mépris du droit international, sans racisme.
Note-s
- paru aux Éditions du commun.[↩]
- Tribune de Tsedek parue dans L’Humanité, 18 février 2025.[↩]
- Voir Béatrice Orès, Michèle Sibony, Sonia Fayman, Antisionisme, une histoire juive, Syllepse, 2023.[↩]
- Tsedek – Neturei Karta : les Juifs préférés des antisémites, par Élishéva Gottfarstein, 6 mars 2024, sur le site Akadem.org.[↩]
- [Léon Trotski, Leur morale et la nôtre, 1938.[↩]
- Hannah Arendt décrit les Juifs qui, refusant de s’assimiler ou de se soumettre aux normes de la société dominante, choisissent de revendiquer leur identité et leur différence, devenant ainsi des « parias conscients » dans Les Origines du totalitarisme, 2e partie intitulée L’impérialisme.[↩]